Jean Rodes (1867-1947)
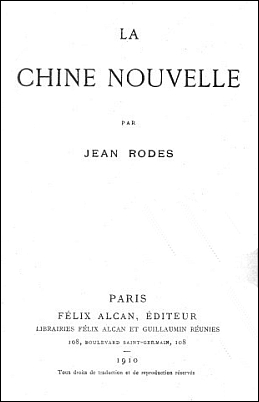
Dix ans de politique chinoise
LA CHINE NOUVELLE
Librairie Félix Alcan, Paris, 1910, 330 pages.
- Avertissement de l'auteur : "On a beaucoup parlé, ces dernières années, de l'évolution de la Chine. Il semble en effet que ce grand empire soit désormais entré dans la voie du progrès et de la civilisation occidentale. La manifestation la plus éclatante de cette orientation nouvelle de la cour de Pékin a été l'envoi, aux États-Unis et en Europe, des deux missions chargées d'étudier les divers systèmes de gouvernement des grandes nations étrangères et dont on se rappelle la venue en France, il y a trois ans. Depuis lors, des dépêches d'Extrême-Orient nous avaient fait connaître des projets de réformes et de Constitution parlementaire qui ne tendraient à rien moins, s'ils étaient réalisés, qu'au bouleversement des séculaires institutions chinoises."
- "Qu'y avait-il derrière cet engouement soudain pour des innovations auxquelles les Fils de Han paraissaient jusqu'alors si violemment réfractaires ? Quelles réalités correspondaient exactement à tous ces décrets qui prétendaient faire, en si peu de temps, du vieil Empire Céleste, une nation moderne ? Il importait d'autant plus d'être fixé à cet égard que l'on sent bien quelles conséquences incalculables ne manquerait pas d'avoir une telle transformation de «l'autre moitié du monde»."
-
Les trois premières missions en Chine de J. Rodes. Hervé Bouillac : "1904-1913... C'est durant cette décennie que Jean Rodes effectue
l'essentiel des voyages en Asie qui fourniront les matériaux des six premiers essais sur la Chine... Jean Rodes va faire ces voyages quasiment toujours par mer, en partant de Marseille, sur
les bateaux des Messageries maritimes. C'est avec une excitation non dissimulée qu'il s'embarque au printemps de 1904 pour sa première mission pour laquelle il fait deux voyages. Le 8 mai il
se trouve à Shanghaï [...Pékin, Chan-Hai-Kouan, Niou-Chouang, Pékin, Tientsin, Chéfou]. Le 11 décembre, il fait ses premiers adieux à la Chine... Début janvier, il se trouve à Paris. Il...
repart rapidement mais cette fois-ci en direction de Saint-Petersbourg, le but étant d'obtenir toutes les autorisations nécessaires pour aller sur le front. Cela étant fait, c'est la
traversée de l'immense empire russe à bord du Transsibérien qui l'attend. Il peut alors suivre les opérations auprès des chefs de l'armée russe. Il est de retour à Paris le 27 juillet. Les
premières « observations sur les Chinois » sont effectuées dès ce premier contact avec l'Asie et consignées dans le carnet consacré à cette première mission.
Le troisième voyage a lieu deux ans après. Jean Rodes part de Marseille sur l'Australien le 29 avril 1907 selon le trajet classique. À son retour, en novembre,... "
Extraits :
L'abolition des privilèges des Mandchous - Les déclarations de Sun Yat-sen, chef des révolutionnaires chinois
Feuilleter
Télécharger / Lire aussi
Une autre réforme destinée à calmer l'opinion publique et à faire disparaître la haine générale contre la race conquérante, consistait dans la suppression de la barrière qui séparait les Chinois
des Mandchous et l'abolition des privilèges dont ceux-ci jouissaient depuis les premiers temps de la conquête. Voici quelle était en effet leur situation :
Tous les Mandchous appartenaient en principe aux Huit Bannières, c'est-à-dire aux troupes chargées spécialement de protéger la dynastie. Il leur était de ce fait interdit d'exercer une profession
ou de travailler la terre et ils vivaient d'une solde que leur versait le Trône. Il n'existe en réalité qu'une division organisée de ces troupes, la 1e division de la nouvelle armée chinoise,
mais les autres Mandchous, répandus dans l'empire, n'en étaient pas moins considérés comme soldats, à la disposition des maréchaux tartares, et empêchés d'exercer aucun métier. Ils ne pouvaient
en outre contracter mariage avec des Chinoises, pas plus que les Chinois avec les femmes mandchoues. Ils étaient enfin soumis à une juridiction spéciale. Une barrière infranchissable séparait
ainsi les deux races et, dans cette position respective, les Chinois restaient bien les vaincus.
Dans les hautes classes, les avantages des Mandchous étaient bien plus considérables encore. Presque toutes les grandes charges leur étaient réservées. Le Grand Conseil, la présidence de tous les
ministères, tous les postes de maréchaux et de généralissimes et la plupart des vice-royautés et gouvernements étaient occupés par eux. Cette prépondérance excessive était l'un des principaux
griefs du nouveau parti révolutionnaire et l'une des causes de ses progrès dans l'empire. De plus, elle était l'un des thèmes favoris de la presse moderniste, dont l'audace ne faisait que croître
et qui usait de ce prétexte pour attaquer avec violence le gouvernement. Ce mouvement purement chinois devint tel que la cour prit peur et que les souverains, pour calmer cette effervescence,
annoncèrent, au cours de 1907, l'intention de mettre fin à cette irrégularité choquante.
Un premier décret parut, ordonnant aux vice-rois et gouverneurs de rechercher les meilleurs moyens pour supprimer cette barrière, et promettant de répartir plus équitablement les fonctions entre
les deux races. Tous les rapports, émanant de Chinois, vice-rois, gouverneurs et censeurs, furent favorables à cette suppression. Chose curieuse, le moins favorable de ceux-ci fut celui de
Yuan-Chi-Kaï qui, encore en disgrâce, travaillait à reconquérir la faveur impériale, avec l'appui du prince Tsing. Il approuvait bien au fond l'unification, mais il s'élevait surtout avec
véhémence contre les révolutionnaires qui, en attaquant la dynastie, font le plus grand mal à la Chine, disait-il, au profit des étrangers. Les Mandchous progressistes, notamment le duc Tsai-Tsé,
le prince Sou et le vice-roi Toan-Fang se déclarèrent nettement pour l'abolition de la barrière. Mais le groupe des Mandchous irréductibles, avec à leur tête le ministre Tié-Liang, s'y opposèrent
vivement. L'un deux, le gouverneur du Kiangsi, Choei-Liang, donna, comme motif de son hostilité, que cette mesure serait contraire aux décisions et à la volonté des anciens empereurs. Et
l'impératrice douairière pleura beaucoup, dirent les journaux, avec leur habituelle exagération puérile, en lisant ce rapport contraire.
La presse suivait avec une attention extrême le développement de cette question qui passionnait à juste titre la « Jeune Chine ». Le Tongvenhoupao observait avec amertume que, malgré les
promesses, les dernières nominations ministérielles comprenaient une forte majorité de Mandchous. Le même journal attaquait plus tard avec violence le rapport hostile du gouverneur du Kiangsi, en
faisant ressortir que les Chinois sont assez nombreux pour anéantir les Mandchous. Le Tchongvaijepao remarquait qu'au ministère des Finances, un ministre et deux vice-ministres étaient Mandchous
; qu'au ministère de la Guerre, les trois ministres étaient encore de cette race et qu'à l'Instruction publique, il n'y avait qu'un Chinois. Il faisait observer aussi que, dans les provinces
centrales, les plus importantes, sur sept vice-rois, quatre étaient Mandchous.
La crainte grandissante de la révolution confirmait cependant la vieille souveraine dans son intention première. Elle commençait du reste à l'exécuter, en appelant, au mois d'août, au Grand
Conseil, Yuan-Chi-Kaï et Tcheng-Che-Tong. Les Chinois n'avaient jusqu'alors pu faire partie de cette assemblée suprême. Un mois après, le 27 septembre 1907, un décret supprimait officiellement la
fameuse barrière.
Cet arrêté licenciait les anciennes troupes provinciales des Huit Bannières et non seulement autorisait les Mandchous à commercer et à cultiver la terre, mais invitait les mandarins à s'assurer
des professions qui leur convenaient et à leur en faciliter la pratique. L'argent nécessaire à leur établissement ou à l'achat des terres, et à la construction des maisons devait être prélevé sur
les sommes qui servaient auparavant à payer leur solde. Il leur était interdit de revendre les terres ainsi acquises. Ils rentraient aussi dans le droit commun et relevaient désormais pour leurs
différends ou leurs délits, de la même justice que les autres Chinois.
« En agissant ainsi, disait le texte impérial, nous voulons montrer à notre peuple que nous nous efforçons d'abolir la différence qui pourrait exister entre Chinois et Mandchous, afin que les
populations de ces deux races marchent, pour la concorde, sur un même pied d'égalité. »
Un nouveau décret du 9 octobre ordonnait, au ministère des Rites et aux commissaires chargés de l'amélioration des lois, de se concerter pour fixer les rites cérémoniaux et les lois pénales qui
devaient être à l'avenir les mêmes pour les Chinois et les Mandchous. Seuls, les parents et proches de la famille impériale continueraient à être soumis à des lois particulières.
Ces édits, qui supprimaient leurs antiques privilèges, furent très mal accueillis par les Mandchous, surtout par ceux du petit peuple que la mesure atteignait surtout. Leur mécontentement fut
d'autant plus vif que si, conformément à ces décisions impériales, leur solde fut supprimée, par contre les mandarins les aidèrent d'une manière très insuffisante à se créer une nouvelle
situation et, de leur côté, les Chinois ne mirent aucun empressement à les accueillir et à leur faciliter la condition commune. Ils se trouvèrent même de ce fait dans une telle détresse que des
suicides se produisirent parmi eux et qu'en plusieurs endroits, ils menacèrent de se soulever. La presse chinoise annonça même qu'ils avaient envoyé, de toutes les provinces, des délégués à
Pékin, pour prier le Trône de rapporter ce décret si désastreux pour leurs intérêts.
Il semble en effet qu'on n'ait tenté quelque chose en leur faveur que dans leur pays d'origine, en Mandchourie. Outre que l'abondance des terres libres dans ces régions pouvait y rendre leur
établissement plus facile, les rapports des gouverneurs de cette province indiquent que l'on s'est efforcé, en ouvrant des écoles et des ateliers spéciaux, d'améliorer leur sort. Enfin, par un
décret du 26 décembre 1908, le régent montrait toute sa sollicitude pour ce berceau de sa race, en ordonnant aux fonctionnaires de continuer à payer l'ancienne solde aux hommes des Huit Bannières
de Mandchourie et de Mongolie.
Comme cela se passe aussi trop souvent dans d'autres pays où ce sont surtout les basses classes qui font les frais de certaines réformes, les Mandchous de haute caste n'ont eu guère à souffrir de
cette prétendue égalité avec les Chinois. Ils n'en ont pas moins continué à encombrer toutes les avenues du Trône et à occuper, dans l'empire, le plus grand nombre de fructueux emplois. Si,
durant l'année qui s'écoula entre son retour en faveur et la mort des souverains, Yuan-Chi-Kaï a pu faire nommer, à beaucoup de postes importants, des Chinois qui étaient ses créatures, les
choses ont, après sa disgrâce retentissante, repris leur ancien cours. Les Mandchous prédominent de nouveau absolument avec les tout puissants ministres, Tié-Liang et Na-Tong.
Il est donc à craindre que cette réforme, destinée à réconcilier définitivement les deux races et à enlever, aux révolutionnaires, leur argument favori, non seulement n'atteigne pas son but, mais
aggrave au contraire la situation générale, en grossissant le parti des mécontents d'un misérable prolétariat mandchou.
*
Les déclarations de Sun Yat-sen,
chef des révolutionnaires chinois,
à notre correspondant spécial. - Le Temps, 10 juin 1907.

J'ai pu avoir, en juin 1907, une longue conversation avec Sun Yat-sen. Je ne l'ai pas vu à Hong-Kong, comme le souci de ne pas révéler sa véritable résidence m'a contraint de le dire alors, dans
le journal Le Temps, mais à Hanoï, dans une maison, entourée de jardins, du boulevard Gambetta, où il se cachait soigneusement. Averti de mon désir d'avoir, avec lui, une entrevue, il me
fit savoir qu'il me recevrait volontiers. Je fus conduit à son habitation, un soir, par un Chinois de ses amis.
D'apparence très jeune, bien qu'ayant atteint la quarantaine, vêtu à l'européenne, les cheveux coupés court, il ressemblait, avec ses pommettes saillantes et sa tête un peu forte, bien plus à un
Japonais qu'à un Céleste. Sa physionomie frappe tout de suite par une extraordinaire impassibilité, une extrême condensation de ténacité et d'énergie. C'est un de ces visages impénétrables, comme
murés, derrière lesquels on sent une pensée que rien ne peut distraire d'elle-même et un de ces caractères de dur métal qu'aucun acide ne peut mordre.
Dans une vaste pièce, aux murailles tapissées de cartes de Chine, à peu près vide de meubles — campement de nomade qui ne sait où il sera le lendemain, bien plus que logis de sédentaire —, nous
nous assîmes autour d'une petite table. Un boy apporta des tasses de thé et tout de suite je commençai mon interview. Les yeux baissés, regardant obstinément la table, il laissait tomber toutes
mes phrases sans répondre. Je n'avais visiblement aucune prise sur lui et je désespérais d'amorcer la conversation. Il paraissait absent et en réalité il m'observait et m'étudiait. Et ce n'est
que lorsqu'il fut bien convaincu que je n'étais pas un ennemi, un de ces agents internationaux au service de toutes les polices politiques que l'on rencontre sur toutes les grandes routes du
monde, qu'il répondit à mes questions. Et voici quel fut, d'après mes notes, l'essentiel de notre entretien :
— Les rebelles d'Amoy, de Swatow et de Pakhoï, qui viennent de se soulever, sont-ils de vos partisans ?
— Très probablement.
— Irez-vous en Chine, prendre la tête de l'insurrection ?
— Oui, mais le moment n'est pas encore venu. Du reste, le grand mouvement ne partira pas du Sud, mais du Centre.
— Aura-t-il également lieu au Nord ?
— Oui, j'ai de nombreux partisans à Tien-Tsin et même à Pékin. La Chine entière est dans un état moral qui la dispose à la révolte contre les mandarins et la dynastie mandchoue.
— Avez-vous l'intention, comme on le dit, d'établir la république, et une république socialiste ?
— Parfaitement, mais ce projet ne répond pas exactement à l'idée que vous vous en faites, en Europe, car il aura, avec vos conceptions, des différences profondes qui seront dues au caractère
propre de la mentalité et des mœurs chinoises.
— Il semble que, pour arriver à un si complet changement, il soit nécessaire de faire auparavant une révolution morale. Vous attaquez-vous aux principes qui sont la base de la société chinoise,
au culte des ancêtres et aux lois familiales qui maintiennent les Chinois dans une étroite dépendance et suppriment son individualité ?
— C'est bien en effet le but de nos efforts. Nous voulons supprimer tout ce que les rites ont de tyrannique, mais en respectant ce que le culte des ancêtres a de bon et de moralisateur. Nous
revendiquons en somme, nous aussi, comme l'a fait la Révolution française, les droits de l'homme.
— Vous appuyez-vous sur les sociétés secrètes ?
— Oui. Ces associations, autrefois anti-étrangères, sont, aujourd'hui, uniquement réformistes et anti-dynastiques. Les Chinois savent maintenant que le mal vient bien davantage de la cour et des
mandarins que des Européens. Ce sont les mandarins qui, pour détourner la colère du peuple, mécontent de leur administration, provoquent toujours les mouvements xénophobes.
Nous sommes par-dessus tout anti-mandchous, car cette dynastie usurpatrice est la cause de notre déchéance nationale. Tant que la Chine sera sous sa domination, elle sera faible et cette
faiblesse, en excitant des convoitises, est un danger pour la paix universelle. En rendant notre pays fort et en lui donnant un régime adapté aux nécessités modernes, nous travaillerons donc pour
la paix du monde. Et quand nous aurons réussi, loin d'être hostiles aux Européens, nous serons heureux de les voir venir commercer avec nous et concourir à la modernisation de la Chine.
— Marchez-vous avec le réformateur de 1898, Kang-Yu-Wei, et son parti du Pao-hoan-hoei ?
— Sans doute, Kang-Yu-Wei est réformiste, mais nous ne pouvons être avec lui puisqu'il est monarchiste et dynastique et que sa société a pour but la défense de l'empereur.
— Que pensez-vous des réformes entreprises par le gouvernement ?
— La cour n'est pas sincère et d'ailleurs elle est incapable de réaliser ses promesses. Il n'est pas un Chinois intelligent, du Nord, comme du Sud, qui ne soit convaincu que le gouvernement de
Pékin nous trompe.
Tout en parlant ainsi, il s'était échauffé et j'avais vu peu à peu la méfiance s'évanouir de son regard qui brillait, à la fin, d'une ardeur confiante et juvénile. Et quand, tard, je le quittai,
il me serra très fort la main, en me demandant à plusieurs reprises de défendre une si juste cause.
*
Lire aussi :
- Jean Rodes : La Chine et le mouvement constitutionnel.
- Jean Rodes : Le Céleste Empire avant la Révolution.
- Jean Rodes : La fin des Manchous.
- Jean Rodes : Scènes de la vie révolutionnaire en Chine.
- Jean Rodes : Les Chinois.Essai de psychologie ethnographique.
- Jean Rodes : La Chine nationaliste.
- Jean Rodes : À travers la Chine actuelle.
- Jean Rodes : La transformation de la Chine.
- Albert Maybon : La politique chinoise.
- Albert Maybon : La république chinoise.

















