Albert LONDRES (1884-1932)
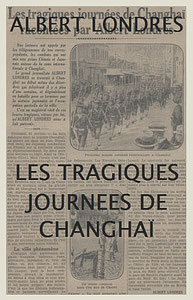
LES TRAGIQUES JOURNÉES DE CHANGHAÏ
à partir des câblogrammes envoyés de Changhaï au quotidien parisien Le Journal,
du 31 janvier au 5 mars 1932.
-
Le Journal, 31 janvier 1932 : "Nos lecteurs ont appris par les télégrammes de nos correspondants, les combats qui ont mis aux prises
Chinois et Japonais autour de la zone internationale à Changhaï.
Le grand journaliste Albert Londres se trouvait à Changhaï au début même des désordres qui éclatèrent il y a plus d'une semaine, et dégénérèrent en bataille pour se terminer par la victoire japonaise et l'occupation partielle de la ville.
C'est un magistral récit de ces heures tragiques, vécues par lui, qu'Albert Londres nous a fait parvenir."
- La tragique journée d'Albert Londres : Contrairement à ce qu'il avait pu faire à l'occasion de précédents reportages, dont La Chine en folie, Albert Londres n'aura pas eu le temps de rassembler en un volume ses impressions et ses témoignages chinois récents : il meurt le 16 mai 1932, dans l'incendie du paquebot qui le ramenait en France, le Georges Philippar. Ses textes sont proposés ici, avec comme titre les premiers mots de son premier article.
- Tous les numéros du quotidien Le Journal de la période concernée sont disponibles sur le site Gallica.
Extraits : 31 janvier 1932. Les tragiques journées de Changhaï - La panique règne dans Changhaï
3 février. Les Japonais occupent les forts de Woosung
7 février. Scènes vues et vécues dans le décor fumant de Chapeï - 12 février. La trêve de quatre heures
3 mars. La belle leçon donnée à Machiavel par l'Extrême-Orient
4 mars. Les Chinois se réjouissent d'une défaite imaginaire de l'armée japonaise
Feuilleter
Lire aussi

La folie asiatique vient de toucher Changhaï. La guerre est dans les rues. Depuis cinq mois, les Japonais combattent les Chinois sur le
territoire chinois et, diplomatiquement, les deux pays sont toujours en règle. Ainsi va l'Extrême-Orient. Mais l'heure n'est pas aux considérations. Changhaï, monstre international, est attaqué ;
arrivons aux faits.
Pour répondre à l'action du Japon en Mandchourie, la Chine, je ne dis pas le gouvernement chinois, car seul Bouddha sait où il est, la Chine avait eu quelques idées. La grande idée de Changhaï
fut le boycottage des marchandises japonaises. Les Chinois qui, toujours, se sont passés de tout pouvaient, en effet, à la rigueur se passer aussi, pendant quelque temps, des produits si bien
présentés des manufactures japonaises. Le Japon, serré dans ses îles, étouffant sous son propre poids, n'envisagea pas sans émoi la clôture même momentanée du marché le plus vaste du monde. La
riposte chinoise avait touché juste. Vainqueur en Mandchourie, vainqueur à Tien-Tsin, les Japonais vinrent à Changhaï pour être de nouveau vainqueurs. Et c'est là que commence notre
histoire.
Changhaï, ville américaine, anglaise, française, italienne, russe, allemande, japonaise et, tout de même, un peu chinoise, est un phénomène sans pareil au monde. Un imagier, pour la faire
comprendre, devrait la représenter en déesse à vingt têtes et cent quarante-quatre bras, les yeux avides, et les doigts palpant des dollars. C'est là que les Chinois inébranlables et patients
surveillaient les achats de leurs compatriotes. Qui achetait ou vendait de la camelote japonaise était aussitôt conduit dans un étroit chemin et son échine répondait de sa trahison. Le Japon
envoya un ultimatum en même temps que quelques bateaux. À qui l'adressa-t-il ? Lui-même n'en sait trop rien. Au gouvernement ? Où l'aurait-il trouvé ? Les ministres chinois sont à l'hôpital plus
souvent qu'au pouvoir. Quand, par hasard, le bonheur des temps vous met en présence d'un président de l'Exécutif, ledit président s'excuse de son impuissance. Toute responsabilité, d'après lui,
devant être prise par un maréchal en congé illimité dans son village natal. Bref, l'ultimatum fut recueilli par le maire du plus grand Changhaï. Ce maire, M. Wu Te Chen, qui en même temps est
général, choisit la voie de la sagesse. Que pouvait faire à l'éternelle Chine que les piquets de volontaires en faction devant les magasins fussent renvoyés à leur jeu de dominos ?
Les étudiants ne se rangèrent pas à son avis. Ils allèrent conspuer le pauvre maire. Cette manifestation sans doute les épuisa, ces derniers deux jours, en effet, personne ne peut dire les avoir
revus dans la rue. Le maire du plus grand Changhaï s'en tint à son point de vue. Le 28 janvier, à sept heures, il donnait satisfaction aux Japonais.
Du drame dans l'air
La journée n'avait pas été sans émoi. Du drame était dans l'air, les concessions s'assuraient déjà contre les événements. Les Français dans la leur, les autres et les Américains dans
l'internationale barraient leurs voies avec des chevaux de frise, entouraient leur territoire de barbelés, appelaient leurs volontaires. À quatre heures, les Blancs faisaient placarder un avis
déclarant l'« état d'alerte ». La nuit apportait avec elle l'odeur d'une veillée d'armes. Mais sept heures sonnèrent et l'acceptation du maire de Changhaï arriva, par bonheur, juste pour le
cocktail.
Les journalistes qui, à 11 h 35 de cette même nuit, promenaient leur insomnie professionnelle dans la partie de la concession internationale attribuée aux Japonais, se souviendront longtemps du
spectacle qui, soudain, s'offrit à leurs yeux.
Le ciel était sans clarté, tous les magasins abandonnés. Chapeï — c'est le nom du quartier — était désert, ses rues, ses ruelles, ses impasses, ses cul-de-sac, ses « houtongs », comme l'on dit,
n'étaient guère éclairés que par quelques lanternes oubliées.
Requête au maire
Un bruit régulier frappant sec sur le sol s'élevait dans la direction des rives du Whang-Poo. Je regardais. Une masse marchant à une cadence automatique venait dans le fond sur Chapeï ; je
m'arrêtai. Composée d'hommes petits, aplatis par un casque, bruns, vêtus de bleu noir, la masse, d'un seul bloc, s'avançait baïonnette au fusil. D'autres petits hommes encore, plus secs, plus
mécaniques, la flanquaient de vingt pas en vingt pas, revolver au poing. Le silence que seuls ils troublaient en frémissait. Les soldats japonais débarquaient. Trente minutes avant, l'amiral de
Tokio avait fait porter au maire du plus grand Changhaï une lettre en trois lignes verticales : trente caractères au plus.
« Très honorable monsieur, disait la lettre, la situation à l'extérieur des concessions est devenue grave. Les municipalités qui commandent les forces étrangères ont décrété l'état de siège.
Comme nous avons beaucoup de ressortissants dans Chapeï, nous envoyons nos troupes. Je vous prie de faire le nécessaire pour que vos soldats soient retirés de cet endroit. »
C'était tout.
Scènes de bataille
Les Japonais avaient traversé la Mandchourie ; ils avaient débarqué à Tien-Tsin comme on cueille une fleur, en passant, sans s'arrêter. Ils allaient du même pas, croyant cueillir de même Chapeï
et la gare de Nankin. Mais, en Chine, tout arrive ; il arrive même que, malgré M. le maire, des soldats chinois décident de se battre.
Un feu imprévu arrêta la masse en marche. Des troupes de Canton s'opposaient à l'avance du Soleil levant. Le spectacle fut renversé. Les Japonais se planquèrent le long des maisons et, sur un
commandement rauque, dont le son non plus ne s'oublie pas, ils partirent au pas de course, courbés, le fusil en avant, si bien que dans la pénombre on les aurait crus à cheval sur leur
baïonnette.
Le feu des Cantonnais les arrêta deux heures. Puis les Cantonnais se retirèrent. Alors commença l'autre chose. Toute armée chinoise est toujours accompagnée d'irréguliers, les « plain clothes men
», comme on les appelle dans le pays, autrement dit des francs-tireurs, pour parler comme dans le nôtre ; les francs-tireurs étaient dans les maisons de Chapeï.
Les Japonais, sur le trottoir, virent la guerre sortir des fenêtres. Leur plan était déjoué. Cloués sur place, ils ne pouvaient plus marcher sur la gare. La fusillade de rues commença. Toute la
nuit, toute la journée, mitrailleuses et fusils arrosèrent Chapeï de haut en bas et de bas en haut. Imaginez par exemple le quartier de Paris entre la Bastille et l'Hôtel de Ville, et les
Japonais débarqués le long de la Seine avec la gare du Nord pour objectif. Ici la gare de Nankin s'appelle aussi la gare du Nord. Eh bien ! les Japonais ne pourraient l'atteindre. Ils resteraient
accrochés rue de Rivoli si vous voulez.
Depuis deux jours, bien entendu, le cortège qui accompagne les grands malheurs passe en courant dans le reste de Changhaï. Rickshaws, brouettes à une roue, véhicules antédiluviens dont je suis
loin de savoir les noms, tout cela bourré de matelas de cauchemar, au-dessus desquels glapissent les innombrables enfants chinois, s'engouffre en désordre dans les concessions étrangères.
Les moins pauvres se jettent à l'assaut de tous les bateaux du Whang-Poo ; les plus riches sont dans les hôtels européens. Si l'invasion continue demain, je ne pourrai plus sortir de ma
chambre.
Dans Chapeï, tous n'ont pu fuir encore. Affolées au milieu des crépitements des mitrailleuses, les femmes cherchent une sortie par groupes de trois ou quatre sous la protection instinctive d'une
couverture de coton.
Nous sommes maintenant le 30 janvier. Il est huit heures. Une nouvelle traverse la ville. Un armistice serait donné. La nouvelle est vraie. Est-ce fini ? Non. L'armistice n'arrête que l'avance
des Japonais. La guerre est toujours dans les rues ; elle dure toute la nuit et nous voici aujourd'hui samedi.
La situation se tend d'heure en heure. Le consul général du Japon a perdu complètement le contrôle de l'emploi des troupes nippones et surtout des volontaires.
Message américain
Quelques-uns de ces derniers ont débordé sur le secteur international. À deux heures, le major Powers, commandant les forces américaines, envoie ce message à toutes les troupes au-delà de Ston
Bridge :
« Vous êtes prévenus par la présente communication que, si vous pénétrez dans notre secteur, nous ouvrirons le feu sur vous, que vous ayez ou non tiré, et cela sans égard à votre nationalité
chinoise ou japonaise. De plus, vous ne serez pas autorisés à battre en retraite par ce pont, que vous soyez armés ou désarmés. »
Anglais, Américains, Chinois creusent des tranchées autour de Changhaï. Les Français sont bien équipés, leur concession est protégée par une crique.
À 18 heures, cinq nouveaux destroyers japonais paraissent. À 19 heures, 700 soldats anglais débarquent. La division chinoise de Nankin est à pied d'œuvre.
Il est minuit : quatre des buildings flambent. Voilà où nous en sommes.
*
La panique règne dans Changhaï
tandis que les armées gardent leurs positions
Des vagabonds chinois revolver au poing tentent de se glisser dans la zone internationale.
Des communistes pénètrent dans la concession française et arrêtent les tramways.

L'horizon ne s'éclaircit pas. Le cœur de Changhaï ne cesse de battre d'heure en heure plus fort ; l'une des plus grandes villes du monde perd la
tête. Aujourd'hui, le spectacle est ahurissant.
Les Chinois n'étaient-ils donc pas tous partis ces deux derniers jours ? Seraient-ils aussi nombreux qu'on le dit ? Il faut le supposer. Leur ruée désespérée reprit dès le petit matin. À 7
heures, en même temps qu'arrivait le jour, eux, semblaient sortir du sol, les uns seuls, les autres en famille, et le plus grand nombre, êtres amphibies, liés à leur véhicule comme l'escargot à
sa coquille.
L'exode vers le fleuve
Brouettes et rickshaws pliaient sous le poids des femmes, des concubines, des rejetons, des matelas et des bols de porcelaine. Tireurs et pousseurs, transfigurés par la sueur, fonçaient dans
cette marée roulante. Leurs points de direction étaient multiples ; toutefois, il était clair qu'un grand nombre allaient au hasard. Certainement, ils couraient, revenaient et repartaient sans
arriver à se poser. On devait sans nul doute voir repasser les mêmes. Je le crois. Autrement, il y aurait vraiment trop de Chinois.
Les uns piquaient vers le Bund pour s'emparer des bateaux du Whang-Poo. Vain espoir : les bateaux étaient nombreux, mais déjà pleins, et quand on dit qu'un bateau chinois est plein, il faut
savoir ce que cela veut dire. Il y avait des hommes jusqu'au sommet des échelles de la cheminée.
Pour éviter l'écrasement, les soldats anglais retiraient les passerelles. Délirante, la foule levait les bras en manière de supplication. Elle ne se jetait pas dans la rivière, non, le Chinois,
même dans les grandes circonstances, n'étant pas l'ami de l'eau, mais elle saisissait les cordages et l'on voyait des femmes, leur enfant dans le dos, grimper comme des panthères, à l'assaut des
rambardes.
Du bord, on jetait tout le matériel ; ainsi, gagnait-on quelques places. Ce soir, les poissons du Whang-Poo seront bien étonnés et, peut-être, bien satisfaits de trouver tant de matelas à leur
disposition.
Les adversaires en présence
Cependant, la situation militaire n'a pas changé. Les Japonais se maintiennent dans Chapeï. Certes, ils ne doivent pas s'y sentir à l'aise ; aussi bien, ils n'avaient qu'à ne pas y venir. À
l'heure qu'il est, ils se renforcent en hommes et en canons. Ce matin, ils ont promené sur Changhaï une escadrille de douze avions de bombardement ; ils n'ont rien laissé tomber. Ce n'était que
pour regarder. À chaque jour son travail.
L'armée chinoise originaire de Canton, la division dite modèle, dopée par cent vingt officiers allemands, ne bouge pas elle non plus. Elle colle à Changhaï comme une grosse poche. La poche
crèvera-t-elle ? Une armée chinoise n'a rien de commun avec les armées que vous pouvez connaître. Suivant qu'il pleut ou qu'il fait beau, suivant que le riz est bien ou mal cuit, suivant que le
chef reçoit ou ne reçoit pas d'argent, elle se bat ou ne se bat pas.
Celle-ci est fort excitée. Je viens de la voir, de la voir de loin, car elle n'a pas voulu de ma visite. Les avant-postes, aux aguets derrière les cercueils qui, ainsi que vous le savez, sont les
plus belles fleurs de la campagne chinoise, m'ont dit de m'en aller. Même, ils m'ont aidé à retourner l'auto, ce qui prouve au moins que, pour l'instant, l'armée a plus de voitures qu'il ne lui
en faut.
Les « snipers » à l'œuvre
Dans le centre de Changhaï, on n'entend que les coups de feu des « snipers ». Le « sniper » n'est pas le « plain clothes man », ce sans-vêtement, cet espèce de franc-tireur officiel qui, tout de
même, arrêta les Japonais. Le « sniper » est un vagabond qui a faim.
Alors, d'obscurs comités lui donnent un revolver, non certes pour qu'il le mange... enfin, vous comprenez. Ces « snipers » se sont glissés dans la zone internationale.
À l'instant, à 3 heures, quinze détonations viennent de claquer à deux cents mètres du Palace Hôtel, Jinkee Road, comme à l'angle de la rue Laffitte et des grands boulevards, pour mieux vous
expliquer. Cela augmenta considérablement le mouvement dans le flot ininterrompu des brouettes et des rickshaws en folie. Là-dessus, des bateaux ayant eu l'idée de donner de la sirène, cela vous
fixe tout de suite sur l'ordre qui s'en est suivi.
Tentative communiste
En même temps, des communistes chinois se montraient dans la concession française ; ils allaient assez carrément. Notre police leur fit reprendre la campagne. Là, ils se reformèrent, revinrent,
arrêtèrent les tramways et haranguèrent les conducteurs. Les autorités firent rentrer les voitures au dépôt.
La tension s'accentue.
Des Japonais en civil attaquent le Grand Hôtel de Hongkew ; ils tuent trois clients, des Chinois.
Dans Chapeï, la bataille entre fenêtres et trottoirs reprend nerf.
Qu'allons-nous voir ce soir ? Chinois et Japonais vont-ils s'accrocher ? La Chine déclarera-t-elle la guerre au Japon ? Dans ce cas, on ne peut prévoir le sort de Changhaï.

*
3 février. Après un bombardement de deux heures,
les Japonais occupent les forts de Woosung
à dix-huit kilomètres de Changhaï

Branle-bas défensif dans les rues de la ville
Nous sommes ici au plus haut de la fièvre. Tout espoir d'arrêter le pire semble emporté. Changhaï, hâtivement, s'équipe pour la bataille.
Là où, pendant ces quatre derniers jours, passa l'exode, passent aujourd'hui tanks, mitrailleuses, sacs de terre, chevaux de frise, mortiers. Le Bund est transformé en camp anglais. Les troupes
écossaises y débarquent de plain-pied, à toute vitesse. Faisant la chaîne, s'envoyant de main en main le matériel, elles l'enfournent dans des camions qui partent au galop d'alarme comme des
voitures d'incendie. Les avions japonais survolent la manœuvre, tournent et retournent, sans doute pour compter un à un les carreaux de la jupe des Highlanders.
La France attend ses bataillons de Tien-Tsin et de Haiphong ; les Américains ne sont plus très loin. Si ce n'est encore la guerre, c'est déjà la mobilisation.
Bombardement
Le gros de cette journée commença, ce matin, à onze heures. Des navires japonais se tenaient à Woosung, à l'endroit où le Whang-Poo, rivière de Changhaï, se jette dans le fleuve Bleu, autrement
dit Yang-Tsé.
Woosung, à 18 kilomètres de Changhaï, en est la clé. Si l'on veut prendre Changhaï, il faut commencer par Woosung. On n'a plus ensuite qu'à remonter le Whang-Poo et l'on y est. L'expédition de
police ayant raté, les Japonais organisèrent l'expédition de guerre. Ils reprirent la chose par Woosung. Dans ce cas, 20.000 hommes étaient nécessaires : ils les ont.
Les Chinois ont des forts à Woosung. Ce matin, un bateau japonais reçut, dit-on, un obus d'un de ces forts. C'est bien possible, mais l'incident ne pouvant pas ne pas être prévu, pourquoi les
Japonais, s'ils ne l'avaient cherché, étaient-ils ancrés là ? Sur-le-champ, ils bombardèrent les forts.
Quel est donc le rôle, dans ce drame, des Anglais, des Français et des Américains ? Les uns et les autres sont sur leur territoire. Dans l'un, 1.300 Français ; dans l'autre, 30.000 mille
Anglo-Saxons, Italiens, Allemands, Espagnols, Belges, etc. Tant que Chinois et Japonais se battront entre eux, hors de nos murs, nous les regarderons. S'ils débordent dans la part des Blancs, les
Blancs tireront. Les limites qu'ils ne doivent dépasser seront-elles toujours visibles à leurs yeux, au milieu des fumées d'une bataille ? Voilà l'interrogation tragique.

Visions de guerre
Commençons par la gauche : jonques sur une crique, jonques où naît, vit, meurt un innombrable peuple lacustre. Elles sont à ce point pressées les unes contre les autres qu'on ne voit pas l'eau.
Au premier regard, on se demande sur quoi elles glissent. C'est une grouillante ville basse, sans rues, ni places, et qui marche. Les lacustres sont-ils affolés ? On ne saurait le dire. Ils
crient, gesticulent et se menacent autant aujourd'hui que les autres jours.
Tout contre cette cité lacustre la concession française. Quelques obus tombent, l'un dans la cour du Cercle sportif. Tank devant le consulat. Blockhaus commandant toute percée vers la Chine,
ponts fermés au moyen de chevaux de frise, ceinture de barbelés. Au nord, hors du secteur, comme un ouvrage avancé, l'établissement des jésuites de Zikawe. Au sud, Nantao, l'œuf d'où sortent
quatre cent mille Chinois.
Nous avons fermé les portes de Nantao justement pour qu'ils ne sortent pas. Je viens de regarder nos voisins derrière leurs grilles. Il m'a semblé qu'ils me tenaient pour responsable de la
situation. Je n'en reçus que des grimaces, en attendant mieux.
Settlement international ; extrême agitation. Un peu plus d'obus. Camions remplis d'Écossais filant sans regarder derrière. Chinois flairant le vent. Tranchées face à la campagne. Odeur des jours
néfastes.
Chapeï. Devant chaque entrée de rue, trois Japonais : un soldat casqué, la baïonnette nerveuse, et deux civils, l'un à brassard rouge, l'autre maniant un gourdin. Rues vides. Fenêtres aux mains
des sans-vêtements chinois. Trottoirs semés de débris, de vitres, de tuiles, de plâtre, de pierre, de glace. J'y trouve même une poupée aux yeux bridés. « Planquons-nous ! » Des avions japonais
lâchent des bombes, des incendies s'allument.
Ici, les avant-lignes japonaises. Au-delà, les avant-lignes chinoises. Feu entre les deux.
Aux lisières de Chapeï, propagande communiste acharnée. Les meneurs chinois crient à leurs frères :
— Aux armes, tous, contre les concessions !
Il est 8 heures du soir.

Il neige : la guerre de Changhaï entre en hiver. Des dames, celles dont les maris ne se sont pas subitement aperçus qu'une affaire urgente les
appelait à Hong-Kong, tricotent pour les soldats. Je n'en dis rien. Une bronchite s'attrape aussi facilement qu'une balle. Il me semble cependant que nous n'en sommes pas encore là.
Il faut revenir sur les snipers et les fameux «sans-vêtements». La presse chinoise ne leur fait pas leur droit. D'après elle, la gloire de ces journées ne reviendrait qu'à l'armée. Cette
interprétation part d'un bon naturel, mais d'une mauvaise base. Le hors-la-loi, le franc-tireur est le héros du jour.
Le franc-tireur
Quel est-il ? Un sans-classe, un aventurier à la semaine. Jusqu'ici, il était l'homme des corsaires de l'opium. Hier, il tirait sur les douaniers, aujourd'hui, il tire sur les Japonais. Dans les
époques normales, vu la dureté des temps, il assassinait pour cinq dollars. Le nom de « professionnel » lui conviendrait mieux que celui de « volontaire ». Le sniper kidnappait aussi ses
concitoyens, ce qui revient à dire qu'il les enlevait pour le compte de son patron, comme d'autres à Paris firent du général Koutiepoff. C'est un individu de coup de main, un spécialiste de
l'ombre. On le charge de tous les péchés. Donnons-lui à cette heure ce qu'il mérite, un peu de considération pour le métier qu'il fait.
Je viens d'en voir un ; c'est pourquoi je pense à eux. J'étais au bout de Norththibet Road, sur la terrasse du Changhaï-Emergency-Hospital. Le bout de Norththibet Road est le front international.
On y parvient à travers un labyrinthe de sacs de terre. Sur les trottoirs, des haies de barbelés séparent la rue de ses maisons et, dans ces maisons, derrière les carreaux, des têtes de Chinois.
Ils sont là comme des rats de concours ratier, attendant dans leur cage. Le Changhaï-Emergency-Hospital est évacué, bien entendu ; toutefois, les troupes chinoises n'en sont pas moins polies à
son égard. Ayant hier placé un obus en plein dans sa façade, elles téléphonèrent dès qu'elles l'apprirent.
— Allô ! dirent-elles à l'officier blanc commandant le secteur, ici l'artillerie chinoise.
— Vous feriez bien de regarder avant de tirer, renvoya l'autre.
— Justement nous téléphonons pour nous excuser. L'obus est allé plus loin que nous ne l'avions lancé.
C'est encore un des aspects de cette guerre.
Je me trouvais dans le secteur portugais, je dis bien, portugais. J'étais loin de penser à cette éventualité, aussi ai-je mis quelque temps à me rendre au fait. Je voyais que ces soldats, malgré
l'uniforme anglais, n'avaient pas la tête britannique, mais que le Portugal fût occupé en ce moment à faire la guerre en Chine, cela ne m'était pas venu à l'esprit. C'est que je suis un peu jeune
ici. Bref, l'officier me conduisit sur la terrasse.
Sniper sur les toits
Chapeï était là à trois mètres. Les toits, aucun ne dépassant l'autre, semblaient, à cause de leurs arêtes cornues, un immense troupeau de béliers. Au milieu, un grand cadavre d'immeuble, la gare
du Nord dont les fumées rabattues par le vent tamponnaient comme une ouate noire les pans ruinés. D'ici on lisait cette guerre de rues mieux que sur un bulletin. Les Japonais n'ont vraiment pas
fait beaucoup de chemin en huit jours.
Soudain, un être humain nous apparut, accroupi sur un toit. Il rampa, il s'accrocha à l'une des cornes et, tel un singe jetant son long bras, il attrapa la corne de la maison voisine. Il se
rétablit et rampa sur ce nouveau toit. C'était un sniper qui n'avait plus ni cartouches, ni nourriture. Le ravitaillement est devenu presque impossible. Alors, une fois les réserves épuisées, les
francs-tireurs quittent leur gîte. Ils ne peuvent sortir de la maison d'où ils ont tiraillé. De toit en toit, ils prennent de l'air. Sans armes, ayant changé leur habit contre une immonde
défroque chinoise, la petite calotte de faux enfant de chœur sur la tête, ils se retrouvent dans une rue de Chapeï, loin du lieu de leurs exploits. Rencontrent-ils des soldats japonais, ils
lèvent les mains, avancent à l'appel et se laissent fouiller comme des malheureux abandonnant enfin leur logis.
Le sniper enjamba douze toits. Il allait lentement, sans bruit, avec des précautions de chat. Nous le regardions, cachés derrière une cheminée. Il nous semblait qu'il prêtait l'oreille. Aussi ne
bougions-nous pas. Il s'arrêta un quart d'heure sur son douzième toit. La neige blanchissait sa petite calotte. Son souffle repris, il repartit. Sans doute allait-il loin ; nous ne lui
souhaitâmes pas malheur.
Au retour, le long de la crique de Soochow, sur le mur d'une usine, quatre inscriptions, écrites en anglais et dont les lettres mesuraient un mètre, proclamaient, la première : « Nous nous
battons pour notre défense » ; la deuxième : « Nous nous battons pour notre droit » ; la troisième : « Nous nous battons pour la paix du monde » ; la quatrième : « Nous nous battons pour le
bien-être de l'humanité ». Cela signé : « La dix-neuvième armée ». J'eus l'idée d'ajouter une cinquième inscription, mais je n'avais pas de pinceau ; elle aurait dit : « Moi, je me bats et je
n'écris pas », et de signer : « Un sniper ».
*
12 février. La trêve de quatre heures
a permis de sauver enfants, malades et vieillards
en détresse dans les rues de Chapeï

Invraisemblable matinée. On se demande si l'on voit bien ce que l'on voit. Il faut se tâter pour n'en pas douter.
À huit heures la trêve commença dans Chapeï. Un peu avant, quatre voitures s'arrêtaient à l'angle de North Setchouen et de Yukong Road. Un prêtre, un officier, une dizaine de religieuses,
quelques nurses infirmières en descendirent. Puis deux pousses, une sœur de Saint-Vincent-de-Paul dans chacun, une Belge, une Française.
Le prêtre était le père Jacquinot, missionnaire de chez nous. L'officier, le lieutenant-colonel Hailey Bell, Américain. Les sœurs en cornette appartenaient à l'hôpital Sainte-Marie, les autres à
l'ordre des franciscaines.
Le canon, la mitrailleuse se sont tus. Les snipers chinois, à qui l'on ne fait pas le service des journaux, continuent de tirer.
Cette trêve était une idée du père Jacquinot. Aujourd'hui aumônier du corps des volontaires blancs, le Père, voilà quatorze jours, était curé du Sacré-Cœur de Hongkew. Malgré la bataille, il
venait rôder autour de son église, il frappait aux portes de sa paroisse. Alors, reconnaissant sa voix, parfois on lui répondait. Il restait encore des gens dans Chapeï. Il trouva neuf enfants
décomposés par la peur et par la faim, grelottants, cachés dans une maison en ruine ; le plus âgé avait onze ans. Il trouva des blessés cloués sur place. Il trouva des vieillards oubliés. Ainsi,
depuis deux semaines, dans l'une des plus grandes villes du monde, tout ce qui d'ordinaire fait l'objet des attentions de l'humanité, enfants, malades, vieillards, demeuraient sous les feux
croisés de deux armées qui, ne l'oublions pas, ne sont pas encore officiellement en guerre.
L'Américain et le Français se rendirent chez l'amiral Nomura. Le commandant en chef japonais convint de la cruauté de la situation. De son côté, le maire du plus grand Changhaï toucha l'armée
chinoise.
Résultat : quatre heures de trêve ce matin, 12 février.
Le père Jacquinot porte des lunettes ; sa barbe n'est pas la barbe classique du missionnaire, elle est taillée. Il lui manque une main. L'aspect de sa soutane montre incontestablement que, ces
derniers temps, il n'a pas fréquenté que son église. Je me demande si saint Pierre le recevrait dans cet état.
Mais voici huit heures. Les sauveteurs franchissent les sacs de terre japonais. Le père va droit, puis il prend la deuxième impasse tombant dans Yukong Road. Il pousse une porte : un très vieux
Chinois, au menton duquel il ne reste plus qu'une vingtaine de poils blancs, est étendu sur un amas d'étoffes gluantes. Il ne dit pas un mot, les infirmiers l'emportent.
Cinq enfants se tenant par la main, petits magots boudinés dans des casaques ouatées, passent, emmenés par une nurse.
Leurs larmes ont tracé un sillon sur leurs joues sales. On leur a donné un nougat de cacahuètes ; ils le sucent. Une femme chinoise tremble sur le trottoir et, par intermittence, elle pleure
d'une voix aiguë.
Entre les lignes.
Des deux côtés des sacs de terre, le quartier se peuple. N'exagérons rien : une foule n'envahit pas les rues, mais voilà bien vingt personnes qui
renaissent au jour. Est-ce l'attachement à leur mobilier qui les avait retenues là ? Il faut le croire, car elles chargent tour ce qu'elles peuvent sur leurs brouettes à haute roue. Le quartier
est un labyrinthe. Des silhouettes apparaissent à chaque angle ; on leur fait signe de ne pas avoir peur de venir, elles viennent ; de vite s'en aller, elles s'en vont. À la barrière, les
Japonais les fouillent, soulèvent leur casquette, leur calotte, leur font ouvrir les mains. Ainsi va la besogne entre les lignes.
Dans le Chapeï occupé, c'est une autre histoire. Ceux qui étaient partis reviennent pour sauver leurs défroques. North-Setchouen Road,
désertée depuis huit jours, est grouillante maintenant.
Tout le sud de Chapeï n'est qu'une immense caravane de déménagement. Je voudrais pourtant vous en donner une idée.
Voilà deux hommes qui emportent leur lit sur un bambou ; l'un trottine devant, l'autre derrière, et dans le lit une vieille Chinoise est couchée. Bambous, brouettes, voitures, traîneaux,
c'est-à-dire des caisses qu'ils tirent, rickshaws où la femme, écrasée sous le matériel, fait un grand effort de la tête pour maintenir à l'air ses organes respiratoires, enfin une chaîne
ininterrompue d'armoires, de tables, de boîtes laquées, de chaises, de miroirs, de portemanteaux, de vaisselle, de casseroles bosselées, de bouteilles huileuses, d'affreux linges, d'immondes
couches et, sur le tout, de temps en temps, le canari chéri.
Les foyers cédaient la place aux canons.
Les blue jackets
Le tableau de Chapeï, pendant ces heures de trêve, n'est pas encore complet. Les blue jackets, nos marins japonais, parcourent les rues en side-car. Sur la selle, le conducteur avec son masque
contre la grippe. Vous n'imaginez pas combien ce supplément vestimentaire peut rendre vilain même un Japonais. Derrière le conducteur, un autre marin, fusil mitrailleur dans les deux mains. Assis
dans le panier, un troisième marin se promène lui aussi avec son fusil mitrailleur mais il le tient entre ses jambes. Vingt équipages de cette sorte vont, viennent et pétaradent sans relâche.
Toutefois, eux respectent la trêve. À dix heures, à l'angle de North Setchouen et de Yu-kong Road, un sniper tire sur deux Européens, ce qui n'est pas gentil, et sur un Japonais. Espérons qu'il
visait seulement le Japonais. Tir sans résultat. Les blue jackets ne répliquent pas. Je pense que, midi sonnant, avant de déjeuner, ils reviendront faire un petit tour par là.
Les ronins
Dernière touche au tableau. Je dois vous présenter les ronins. Le ronin est un Japonais qui, tout en restant un civil, est beaucoup plus méchant qu'un militaire. Dans une main, il tient un
gourdin et, dans l'autre, un revolver. Il est le maître de Chapeï. Les blue jackets vous laissent passer, mais le ronin en décide autrement. Il court après vous, vous barre le chemin. Vous
insistez. Sa figure devient froide, une envie violente de vous étrangler le parcourt des pieds à la tête. Il n'a pas digéré l'ordre venu de haut et qui lui interdit de créer un incident avec les
Blancs. Je n'ai pu sauver mon appareil photographique qu'en le confiant à un officier japonais. Une seconde de plus, le ronin l'eût jeté à terre et piétiné au cours d'une gigue frénétique. Quel
pouvoir ces ronins représentent-ils ? Celui d'un clan ? Celui d'une organisation patriotique secrète ? Il serait bon de le savoir. Sommes-nous en Chine ou au Japon ? Que le mikado envoie ses
soldats pour y faire la guerre, c'est déjà exagéré, mais que ses civils veuillent y faire la loi, où allons-nous ?
J'ai salué l'un d'eux. Il était garçon coiffeur à mon arrivée à Changhaï. Aujourd'hui, il se tient à Range Road, revolver au poing. Quand il maniait le rasoir, il me faisait de beaux sourires ;
depuis qu'il s'est élevé jusqu'à l'arme à feu, il ne veut plus me reconnaître. Garçons coiffeurs, coupeurs d'habits, vendeurs d'ice-cream, marchands d'antiquités, tous ces messieurs japonais ont
de bien curieuses distractions quand ils ferment leurs boutiques.
L'armée chinoise est partie. Les Japonais, qui voulaient Chapeï, ont Chapeï. Changhaï est dégagé.
Cependant, les canons de Sa Majesté Impériale continuent de tirer.
Hier soir, à l'heure du dîner, alors que chacun s'apprêtait pour la première fois depuis un mois à déplier doucement sa serviette, un nouveau coup fit vibrer les verres sur la table. Les convives
se regardèrent. Je ne sais si des éclairs jaillirent de la rencontre de ces prunelles ; en tout cas, le tonnerre suivit. Les idées jusqu'ici admises en furent renversées comme de simples
maisons.
Peut-être se souvenait-on mal de l'ultimatum japonais. Il fallut le rechercher dans de vieux papiers ; on le retrouva, il disait bien : « Retrait des troupes cantonnaises à vingt kilomètres. »
N'avaient-elles pas déménagé ? Pourtant, Chapeï était vide, Chenzu était vide. Ne fallait-il plus croire ses yeux ? Dans quel but ce nouveau pilonnage de Chapeï et de Chenzu ?
Nous nous trompions, ce n'était qu'un nettoyage. Le Japon est l'un des pays les plus propres au monde. Pour éviter la poussière de charbon, il va jusqu'à ne pas faire de feu dans ses demeures.
Chapeï flambant encore, nous comprîmes tout de suite son explication. Mais pourquoi mettre le feu à Chenzu? Pour le plaisir d'avoir à les nettoyer, brûlerait-il village après village ?
L'Extrême-Orient est en train de donner une belle leçon à Machiavel. Le retrait de la dix-neuvième armée ne fut pas une simple opération militaire. Personne ne discute les pertes qu'elle a
subies, ni la supériorité mécanique de son adversaire. Toutefois, convient-il d'oublier les conversations de Nankin et celles tenues à bord du croiseur Kent ? La dix-neuvième armée eût été forcée
de se retirer un jour, cela est entendu ; mais qui donc fixa pour cet événement la nuit du 1er au 2 mars ? Est-ce la nécessité ou la combinaison ? Est-ce le général Tsaï ou bien les délégués
japonais et chinois, secrètement réunis dans le salon blindé de l'amiral britannique ? De cette entrevue masquée, ni les communiqués de l'armée chinoise, ni ceux de l'armée japonaise n'ont jamais
parlé. Les Chinois en auraient perdu la face et les Japonais les fruits de la victoire. Pour l'avenir de leurs espérances, la face est aussi nécessaire à l'un que la victoire l'est à l'autre.
Aujourd'hui, l'intérêt des Chinois serait de proclamer que les Japonais ne jouent pas complètement le jeu, mais ne serait-ce pas avouer les avoir rencontrés autour d'une table, les cartes à la
main ? Que resterait-il alors du prestige acquis par trente-quatre jours de résistance ? Qu'ils soient tranquilles, le partenaire ne les découvrira pas. S'il était connu que le retrait des
Chinois fut le résultat d'un arrangement, ne faudrait-il pas respecter exactement les termes du contrat ? Au contraire, le terrain reste libre si l'adversaire n'a cédé qu'à la victoire. On n'a
pas traité, mais vaincu. Ainsi, les droits du vainqueur ne sont pas délimités, et Tokio peut illuminer.
Où la dix-neuvième armée s'est-elle réfugiée ? À peu près à trente-cinq kilomètres de Changhaï. Nous ne pouvons dire qu'elle se soit retirée en ordre, étant impossible de parler d'ordre en Chine
; mais elle n'a pas jeté ses fusils ; les soldats ne sont pas encore partis piller les villages ; la horde amputée est toujours un peu debout, et le général Tsaï, ayant retrouvé la voix, vient de
pousser un nouveau cri dans les journaux moustiques : « Nous jurons de continuer la lutte jusqu'au dernier homme et de ne pas vivre sous le même ciel que les Japonais. »
Les vainqueurs ne seront pas mécontents de cette parole. Ils ont des projets à Changhaï. Par exemple, ils aimeraient beaucoup passer de la concession internationale dans une concession japonaise.
La dix-neuvième armée est bien près à leur gré. Pour un touriste ordinaire, plus la marche se prolonge, plus les kilomètres semblent longs. Il n'en est pas de même pour le dernier visiteur de
Changhaï : plus il va, plus les kilomètres lui paraissent courts. Il annonce bien qu'il a bloqué le combat. Une nouvelle petite bataille, cette fois dans la campagne, n'étonnerait personne. La
paix a ses besoins, et la guerre a ses lois... même quand elle n'est pas déclarée.

Changhaï vient d'être le théâtre d'une ahurissante crise d'hystérie. À six heures et demie du soir, une pétarade échevelée s'élevait à la fois
dans la concession française et dans le quartier international. La surprise fut si grande que chacun, à la première minute, se demanda si les mitrailleuses ne recommençaient pas à parler. Les
fenêtres s'ouvrirent et des têtes interrogèrent.
Il ne s'agissait pas de bataille, mais de réjouissances. La pétarade ne provenait que de pétards.
Il faut vous conter cette histoire, si insensée soit-elle. Les journaux moustiques de l'après-midi, n'ayant, depuis deux jours, plus rien à mettre sous leurs presses, forgèrent une victoire. Le
général en chef japonais Shirakawa et trois mille de ses hommes avaient été anéantis par les armées chinoises. Il n'en fallut pas davantage. L'enthousiasme populaire éclata.
Les pétards du jour de l'an sortirent des tiroirs où ils étaient restés. Ce fut un épouvantable tapage. Le délire s'empara de la foule. On se serait cru sur les boulevards parisiens, un jour de
mardi gras. Rien n'y manquait. Des automobiles et des camions, où s'entassaient tant de Chinois que l'on ne sait comment ils y pouvaient tenir, déferlaient en trombe, drapeaux au vent, dans rues
et avenues. Les gens du trottoir leur lançaient des vivats, enfin des vivats à leur manière, les gens en voiture répondaient :
— Japonais vaincus, Japonais vaincus.
C'était à qui pousserait le cri de victoire le plus aigu. Sur le bitume, sur les coussins, chacun piétinait de joie. Les pétards éclataient par guirlandes. C'était lamentable !
La folie dura jusqu'au couvre-feu. L'affaire de Changhaï n'est pas terminée.

















