Louis Laloy (1874-1944)

LÉGENDES DES IMMORTELS
d'après les auteurs chinois
Société des Trente, Albert Messein, éditeur, Paris, 1922, 110 pages.
- Extraits de la préface : "La croyance aux Immortels appartient à la religion taoïste. Par l'étymologie, le nom chinois des Immortels, Sien, désigne seulement les Hommes des montagnes, les ermites qui se sont retirés dans la plus sauvage solitude pour exercer leur esprit à la méditation et à la prière, leur corps aux rigueurs de la discipline et des macérations. L'immortalité est la récompense de ce genre de vie ; d'où le sens que le mot a pris de très bonne heure, et qui s'est étendu ensuite aux hommes qui ont obtenu l'immortalité par d'autres moyens, et même aux immortels qui ne sont pas d'essence humaine."
-
"Le taoïsme est la religion de la Voie, en langue chinoise Tao. La Vertu, qui est la conduite conforme à la Voie, se dit Teh. Le
texte fondamental du taoïsme est le Livre sacré de la Voie et de la Vertu, Tao teh king, attribué à Lao-tze, qui commence ainsi : « La voie qui peut être tracée n'est pas la voie immuable ;
le nom qui peut être prononcé n'est pas le nom immuable. »
Le taoïsme est une doctrine d'initiés. Il a donné à la Chine, par un développement naturel, ses mystiques, ses occultistes, ses alchimistes et ses magiciens. Mais son influence, comparable à celle des mystères dans la Grèce antique, plus forte seulement, s'est étendue bien au delà des retraites des sages, auxquelles succédèrent ensuite les temples et les monastères. Les mythes du taoïsme ont exercé jusqu'à nos jours un si puissant attrait sur tous les poètes et tous les artistes de la Chine, qu'il est impossible de parvenir à l'intelligence de leurs œuvres sans quelque connaissance des légendes qui donnent ce merveilleux essor à leur imagination."
- "Le recueil qui est présenté ici au lecteur français ne contient que les principales de ces légendes, celles auxquelles il est fait allusion sans cesse au cours des poèmes comme dans les peintures, les sculptures, les compositions qui décorent les vases de luxe et les objets plus familiers, paravents, panneaux d'armoires, tabatières, brûle-parfums, séries d'assiettes, services à thé. Qui ne prendrait plaisir à y reconnaître Lao-tze sur son bœuf, le roi Mouh sur son char, les Huit Immortels munis des instruments de leurs miracles, ou le pêcher magique qui faillit être fatal à un disciple de Tchang Tao-ling ?"
Extraits : Lao-tze - Le roi Mouh et la reine d'Occident - Tchang Tao-ling, premier pape de l'Église taoïste
Liou-tch'en et Yuen-tchao - Le vieux pêcheur
Feuilleter
Télécharger/Lire aussi

Lao-tze est le Prince de la Grandeur suprême. À plusieurs époques déjà il avait pris corps,
sans que ces incarnations eussent laissé de traces, quand sous la dynastie des Chang, en l'année quatorze cent deux avant l'ère chrétienne, il réalisa son essence une fois de plus et descendit
dans le sein d'une femme. Après quatre-vingt-une années, le quinzième jour du deuxième mois de l'année treize cent vingt et un, il naquit dans un village du royaume de Tch'ou. Il sortit du flanc
gauche de sa mère, au pied d'un prunier, et désignant l'arbre prononça :
— Celui-ci me donnera mon nom.
En effet, son nom de famille était Li qui signifie prunier. Son surnom, Lao-tze, signifie le Vieillard : dès l'instant de sa naissance, il avait les cheveux blancs et le visage jauni. Il exerça
d'abord des fonctions publiques : il fut conservateur des archives sous le roi Wen, historiographe sous le roi Wou, de la dynastie des Tcheou, au XIIe siècle avant l'ère chrétienne. C'est alors
qu'il entreprit de grands voyages, visita la Perse, l'Inde, d'autres pays encore, sous le nom du docteur Kou (l'Ancien). Il instruisit ces nations, et au temps du roi K'ang (1078-1052) revint en
Chine où il reprit sa charge d'historiographe. Il se remit en route sous le règne du roi Tchao, en l'an mil vingt-neuf. Son char était attelé d'un bœuf bleu. Il atteignit ainsi la passe de
Han-kou, aux confins du royaume.
Le gouverneur de la passe se nommait Yin-hi. C'était un homme de bien qui dès sa jeunesse aimait l'étude et cachait sa vertu. Quelques années auparavant, comme il observait le ciel, il avait
aperçu du côté de l'est une vapeur violette qui gagnait vers l'ouest ; il reconnut à ce signe qu'un saint homme allait franchir la frontière du royaume dans la direction de l'ouest, et c'est
alors qu'il avait demandé l'emploi de gouverneur de la passe de Han-kou, qui lui fut accordé. Sitôt arrivé, il avertit le chef du détachement que s'il voyait venir un homme d'apparence
extraordinaire, il ne devait pas lui donner le passage. En exécution de cette consigne, le chef vint dire un jour au gouverneur qu'un vieillard était là, sur un char blanc traîné par un bœuf
bleu.
— En ce jour, s'écria Yin-hi, il me sera donné de voir un saint homme !
Ayant revêtu son costume de cour, il sortit, et se prosternant devant le vieillard :
— Je voudrais, lui dit-il, retenir un peu votre Divinité.
Mais l'autre répondit :
— Je ne suis qu'un pauvre vieillard ; j'habite à l'orient de la passe et mon champ se trouve à l'occident. Je vais rentrer mon foin. Pour quel motif aurais-je l'honneur d'être retenu ici ?
Hi ne se laissa pas convaincre, et se prosternant de nouveau, il dit :
— Depuis longtemps je sais qu'un grand saint doit venir, en se dirigeant vers l'ouest. Après tant de jours de fatigue, je désire donner un peu de repos à votre Divinité.
— Cette porte ouvre le chemin de l'Inde où vit un docteur nommé Kou. Voilà pourquoi je me suis mis en route et me présente à votre passe. Pourquoi me retenir encore ?
— Mes yeux ne me trompent pas. Je contemple la beauté extraordinaire d'un grand saint qui doit avoir un rang éminent dans le ciel, je ne puis croire qu'il se soit mis en route pour voir un de ces
barbares qui rôdent près de nos frontières.
Lao-tze, cessant de le tromper, dit simplement :
— À quoi donc m'avez vous reconnu ?
— L'hiver dernier, au mois de décembre, les étoiles se sont déplacées vers l'ouest, au solstice. Le premier jour de ce mois-ci un vent chaud par trois fois s'est levé ; du côté de l'est s'est
formée une vapeur qui avait l'apparence d'un dragon ou d'un serpent et se dirigeait vers l'ouest. Ce sont là des signes certains.
Lao-tze sourit de contentement et dit :
— C'est bien. Vous me connaissez, et moi aussi je vous connais déjà.
Hi lui fit alors dresser un trône et présenter de la nourriture en sa demeure ; il accomplit les rites du disciple. Lao-tze resta pour lui devant la passe plus de cent jours. Il lui communiqua
toutes les règles pour l'exercice interne et externe.
Lao-tze avait alors pour conducteur de son char un certain Siu-kia, qui était entré tout jeune à son service, à raison de cent sapèques par jour. Quand ils se mirent en route vers la passe, il
lui était dû sept millions trois cent mille sapèques. Siu-kia voyant que son maître renonçait aux fonctions publiques et s'en allait à l'étranger, se hâta de réclamer son dû.
— Nous allons, répondit Lao-tze, visiter les royaumes de la mer occidentale. À notre retour, je vous réglerai le prix juste en or fin.
Siu-kia s'engagea, sur la foi de cette promesse, à ne pas le quitter. Quand ils furent arrêtés devant la passe, il avait dételé le bœuf pour le mener au pâturage. Lao-tze voulut alors le mettre à
l'épreuve : avec des herbes favorables il fit une belle jeune fille qui s'avança du côté où le bœuf paissait. Elle sut plaire à Siu-kia, qui pour rester auprès d'elle alla trouver le gouverneur
de la passe, devant qui il porta plainte contre son maître et exigea un payement immédiat.
— Quoi ! dit Lao-tze. Voilà deux cents ans que vous êtes attaché à ma personne ; depuis longtemps vous seriez mort, sans le talisman que je vous ai donné. Comment n'y avez-vous pas pensé avant de
porter plainte contre moi ?
Au même instant, le talisman s'échappa de la bouche de Siu-kia, qui ne fut plus devant eux qu'un amas d'ossements blanchis. Mais Hi intercéda en sa faveur, et Lao-tze, par la vertu du talisman,
le rappela à la vie.
Quand cent jours se furent écoulés, Lao-tze dit à Hi :
— Ce docteur Kou dont je vous ai parlé, c'est moi-même, incarné aux limites de l'occident. Voici le moment venu de ramener mon âme aux régions de l'Ineffable. Je vais quitter ce monde.
Hi le supplia de l'emmener avec lui :
— Je vogue, répondit Lao-tze, à l'extérieur du ciel et de la terre, je trouve ma joie parmi les ténèbres du mystère, je vais et je viens jusqu'aux extrémités de l'univers, je monte et descends à
l'infini. Vous qui voulez me suivre, comment y parviendriez-vous ?
— En sautant dans le feu et me précipitant dans l'abîme, en m'abaissant jusqu'à terre et m'élevant jusqu'au ciel, en faisant de mon corps une cendre et en anéantissant la vie, je veux vous
suivre, ô grand Immortel !
— Il est certain que votre matière physique est bien ordonnée et que vous vivez en accord avec la Voie suprême. Cependant cet accord n'est pas constant encore, il change de jour en jour. C'est
pourquoi vous ne pourriez encore parcourir en vos transformations tous les royaumes de l'univers.
Alors il lui remit le livre de la Voie et de la Vertu, qui compte cinq mille mots et lui donna rendez-vous, après mille jours écoulés, dans le pays de Chou, au marché du mouton vert. Il finissait
à peine de parler que déjà Hi le voyait, assis au bord d'un nuage, s'élever lentement dans l'espace, environné d'une lumière éclatante. Il avait disparu que son disciple le cherchait encore,
perçant du regard la brume et la vapeur du ciel. Alors il baissa la tête et pleura amèrement.
Trois ans plus tard, en l'année mil vingt-quatre, Hi, qui avait résigné sa charge, quitta sa demeure et se mit en route vers l'ouest, pour chercher le marché du mouton vert, dans le pays de Chou.
Il s'informait de tous côtés, et personne ne pouvait le renseigner, quand un matin, près du marché d'un village, il aperçut un petit domestique qui emmenait un mouton, il l'arrêta :
— À qui est ce mouton dont la toison a la couleur de l'or vert ? Et où le conduis- tu ?
— Ma maîtresse a un petit enfant qui aime à jouer avec ce mouton. Il s'était enfui depuis deux jours, et l'enfant n'arrêtait pas de pleurer. Je viens de le retrouver, et je me hâte de le
ramener.
Hi tout ému lui dit :
— Je vais te suivre.
Quand ils furent arrivés devant la maison, le petit domestique entra et annonça un visiteur. Aussitôt on vit l'enfant arranger correctement sa petite robe, et se lever en disant :
— Faites entrer le seigneur Hi.
Dès que Hi fut entré, les murs de la maison s'écartèrent, le toit s'éleva, et un trône fait de fleurs de lotus sortit du sol. L'enfant était devenu un homme de haute stature, de la couleur de
l'or blanc. Il rayonnait comme le soleil, et sur sa nuque reposait une auréole de lumière. Il prit possession du trône en fleurs de lotus, pendant que tous les assistants tremblaient, et prononça
:
— Je suis Lao-tze. Le Grand Mystère est ma demeure. L'Unité véritable est ma substance. Ce mouton que vous voyez près de moi, et dont la toison a la couleur de l'or vert, est un dragon céleste à
qui j'ai donné cette forme. L'homme que voici est mon ami. Deux amis se retrouvent. Pourquoi vous effrayer ?
Hi, au comble du bonheur, inclina la tête et parvint à murmurer :
— Je ne pensais pas revoir jamais votre front céleste.
Lao-tze lui répondit :
— Si je vous ai laissé sur terre la dernière fois, c'est que vous n'étiez encore qu'au début de la connaissance sacrée et ne pouviez accomplir votre mérite. Mais aujourd'hui, par l'exercice et
par l'épreuve, vous avez atteint le Mystère véritable. Votre cœur est noué dans le réseau de pourpre, votre visage a l'éclat divin, votre nom est inscrit au jardin ténébreux, votre image est
suspendue en la chambre violette.
Il partit avec lui, vers les déserts des sables mouvants, dont ils convertirent les populations barbares. Depuis lors, Hi réside au-dessus du Roi des quatorze cieux ; il commande aux quatre-vingt
mille Immortels et a le pouvoir de voler dans l'espace sur un char attelé de dragons.
Ce n'est que sous le règne du roi Mouh (1001-946), que Lao-tze revint en Chine où il continua de vivre, sous différents noms. En l'année cinq cent trois avant l'ère chrétienne, il eut un
entretien avec Confucius, alors âgé de cinquante ans, et célèbre dans toute la Chine pour son enseignement de la morale. Lao-tze se nommait à cette époque Lao-tan ; il venait de résigner ses
fonctions d'historiographe, parce qu'il prévoyait la fin prochaine de la dynastie des Tcheou. Confucius, qui au contraire la croyait durable, voulait déposer ses ouvrages, pour en assurer la
conservation, dans la bibliothèque du palais impérial des Tcheou. Comme il se mettait en route vers la capitale, Tze-lou, qui était un de ses plus chers disciples, lui dit avoir entendu parler
d'un certain Lao-tan, historiographe des Tcheou, qui venait de donner sa démission, et lui demanda s'il ne croyait pas bon d'avoir un entretien avec ce sage. Confucius suivit son conseil et alla
voir Lao-tan qui d'abord refusa de l'entendre. Confucius entreprit alors de lui exposer verbalement la doctrine contenue dans les douze volumes de ses œuvres complètes, mais Lao-tan l'interrompit
:
— De tous ces développements je voudrais connaître les principes.
— Ce sont, répondit Confucius, la justice et l'humanité.
— La justice et l'humanité sont-elles dans la nature humaine ?
— Sans doute, car sans l'humanité, le sage n'atteindrait pas sa perfection ; sans la justice, il ne parviendrait pas à l'existence. L'humanité et la justice sont la nature même de l'homme
véritable. Ou sinon, comment la définir ?
— Puis-je vous demander ce que vous entendez par ces noms d'humanité et de justice ?
— Du fond du cœur se réjouir de toute chose, aimer tous les êtres d'un amour désintéressé, voilà quels sont les sentiments de l'humanité et de la justice.
— J'ai peine à comprendre ce que vous venez de dire. L'amour universel n'est-il pas une perversion des sentiments naturels, et n'est-ce pas s'intéresser encore que d'être désintéressé ? Si vous
ne voulez pas que l'empire soit privé de sa nourriture, voyez : le ciel et la terre demeurent toujours à la même place, le soleil et la lune répandent la même lumière, les étoiles et les planètes
se succèdent dans le même ordre, les animaux sont groupés de la même manière, et les arbres se dressent toujours au-dessus du sol. De même, conformez-vous à la Vertu en vos actions, à la Voie en
vos démarches, et vous aurez atteint la perfection. Mais rechercher à grand zèle l'humanité et la justice, c'est suivre la trace d'un fugitif en battant du tambour. Le cygne n'a pas besoin, pour
être blanc, de se laver chaque jour, ni le corbeau, pour être noir, de se noircir. La blancheur ou la noirceur n'ont pas besoin d'être définies. La renommée n'a pas besoin d'être étendue. Quand
la source est tarie et que les poissons se trouvent à sec, à quoi leur sert-il de se venir en aide avec la buée de leur souffle ou l'humidité de leur salive ? Ce qu'il leur faut, c'est
l'insouciance dans la profondeur du fleuve.
Quand Confucius revint de sa visite à Lao-tan, il resta trois jours sans parler. Ses disciples à la fin l'interrogèrent.
— Maître, qu'avez-vous dit à Lao-tan ? Quelle sorte de remontrance lui avez-vous adressée ?
— Je connais, répondit Confucius, les oiseaux qui volent dans l'air, les poissons qui nagent, les quadrupèdes qui courent. Les animaux qui courent peuvent être pris avec les filets, ceux qui
nagent avec la ligne, ceux qui volent sont atteints par la flèche. Mais le dragon qui s'élève au ciel, porté par les vents et les nuages, je ne sais comment le saisir. Je viens de voir un dragon,
et j'en suis demeuré sans voix. Il s'agissait bien de remontrances !
Sous la dynastie des Ts'in, vers la fin du IIIe siècle avant l'ère chrétienne, Lao-tze descendit sur les rives du fleuve Tsieh, et prit le nom de Seigneur du fleuve, pour enseigner la Voie à Ngan
Ki-cheng. Sous l'empereur Wen de la dynastie des Han (179-156 avant l'ère chrétienne), il prit le nom de Koang-tch'eng. L'empereur envoya un messager chargé de l'interroger. Il répondit :
— La Voie est trop vénérable, la Vertu trop précieuse pour qu'on les recherche par procuration.
L'empereur fit alors atteler son char et alla le trouver en personne. Koang-tch'eng l'attendait, impassible.
— Parmi les quatre grandeurs terrestres, dit l'empereur, il faut certainement compter la royauté. Bien que vous possédiez la Voie, vous appartenez à mon peuple. Pour ne pouvoir vous incliner
devant moi, quel est donc votre orgueil ? Ignorez-vous qu'il est en ma puissance de rendre un homme riche ou pauvre, honoré ou misérable ?
Koang-tch'eng, sans répondre, toujours assis, frappa dans ses mains ; aussitôt il se détacha de terre et doucement s'éleva dans l'air comme un nuage. Parvenu à plus de cent toises de hauteur, il
s'arrêta dans l'espace et inclinant la tête, répondit enfin :
— À l'instant où je parle, au-dessus de moi, je n'atteins pas le ciel ; autour de moi, je ne suis pas mêlé aux hommes ; au-dessous de moi, je ne touche pas la terre. Comment me parler encore d'un
peuple ? Et vraiment Votre Majesté croit-elle pouvoir me rendre riche ou pauvre ?
L'empereur, illuminé, descendit de son char et lui rendit hommage.
Il n'y a pas eu d'époque où Lao-tze ne se soit manifesté. Avant la concrétion de notre univers, il durait. Après sa dissolution, il subsistera. Mystérieux et éclatant, toujours insondable, ses
transformations n'ont pas de limite, son action s'étend aux êtres célestes et aux hommes. Aucune parole n'en peut rendre compte.

Le roi Mouh, de la dynastie des Tcheou, a régné de l'an mil et un à l'an neuf cent
quarante-six avant l'ère chrétienne. Il s'illustra par ses conquêtes et bâtit des palais magnifiques.
Vers la fin de son règne, un magicien de l'Extrême-Occident vint à la cour. Il était capable de se jeter à l'eau et dans le feu, de traverser le métal et les roches, de retourner les montagnes,
renverser le cours des fleuves, déplacer les cités, chevaucher le vide sans tomber, heurter les corps solides sans se blesser. Les changements et les transformations qu'il pouvait accomplir
étaient sans limite ; non content d'imposer aux choses une apparence différente, il pouvait aussi s'emparer du cœur des hommes et leur donner d'autres pensées.
Le roi Mouh le traita comme un prince et le révéra comme un dieu. Il destina un corps de bâtiments à le loger, offrit les meilleures viandes pour le nourrir, et choisit parmi ses musiciennes
celles qui devaient lui tenir compagnie. Mais le magicien trouva le palais du roi trop délabré pour s'y loger, sa cuisine trop nauséabonde pour s'en nourrir, ses femmes trop malpropres et trop
laides pour accepter leur société. Alors le roi Mouh fit bâtir pour lui un nouveau pavillon de bois et de briques, bariolé de blanc et d'écarlate, où aucun genre de travail ne fut épargné. Quand
on l'eut achevé, les cinq trésors du royaume, qui sont le trésor des tributs, le trésor des gemmes, le trésor intérieur, le trésor extérieur et le trésor des récoltes, étaient vides. Il était
haut de six mille pieds, et dominait le mont Tchoung-nan. On l'appela Touche-au-ciel. Le roi choisit alors, dans les provinces de Tcheng et de Wei, célèbres pour la beauté des femmes, des jeunes
filles d'une grâce charmante, parfumées de senteurs exquises, et parées d'épingles précieuses et de boucles d'oreilles qui faisaient valoir la délicatesse de leurs traits. Elles avaient des robes
de gaze fine, des traînes de soie blanche, leurs visages étaient poudrés, leurs sourcils allongés, leurs ceintures ornées d'anneaux de jade, et l'arôme des fleurs rares se répandait sur leur
passage. Elles jouaient les plus beaux airs de la musique de l'empereur Hoang-ti, de l'empereur K'ou, de l'empereur Choen et de l'empereur T'ang. Chaque jour on offrait au magicien des vêtements
précieux, chaque matin on lui présentait des mets recherchés.
Le magicien ne put refuser d'entrer dans ce pavillon, mais ce ne fut pas pour longtemps, Bientôt il invita le roi à faire une promenade avec lui. Le roi le tenait par la manche, et tous deux
s'élevaient dans l'espace, toujours plus près du ciel. Soudain, ils s'arrêtèrent : ils étaient arrivés au palais du magicien.
Le palais du magicien était charpenté d'or et d'argent, lambrissé de perles et de jade. Il s'élevait par delà la région des nuages et de la pluie, et on ne savait à quelle profondeur étaient
cachées ses fondations. Il se présentait aux regards comme un amas de nuages. Tous ce que la vue et l'ouïe pouvaient percevoir, tout ce que le goût et l'odorat pouvaient sentir, ne ressemblait en
rien à ce qui existe sur terre, et le roi se crut transporté au pur et mystérieux séjour de la félicité, résidence de l'Empereur du ciel. Abaissant son regard, il aperçut son palais qui ne lui
sembla qu'un amas de boue et un tas de bois.
Le roi comptait bien rester là de nombreuses années, sans plus songer à son royaume, mais le magicien le pria de se remettre en route. Dans la contrée où ils arrivèrent, on ne voyait plus soleil
ni lune au-dessus de soi, océan ni fleuves au-dessous. La lueur qui y flottait éblouit les yeux du roi, et il cessa de voir ; la résonance qui y parvenait assourdit ses oreilles, et il cessa
d'entendre. Les os et les organes de son corps perdirent l'équilibre et sortirent de leurs places, son esprit s'obscurcit, son âme lui échappa. Il n'eut que le temps de s'adresser au magicien, en
le suppliant de revenir. Le magicien lui donna un léger coup, et le roi se sentit précipité dans l'espace.
Quand il revint à lui, il se trouvait assis à la même place, entouré des mêmes officiers qu'à son premier départ. Devant lui le vin dans la coupe n'avait pas déposé sa lie, le ragoût dans
l'assiette n'avait pas séché.
— Où étais-je donc ? demanda-t-il.
Les officiers répondirent :
— Votre Majesté n'a pas bougé d'ici.
Le roi Mouh fut si frappé de cette réponse, qu'il resta trois mois perdu en rêverie. Enfin il osa interroger le magicien, qui répondit :
— C'est que tous deux nous avons voyagé en esprit ; nos corps sont restés immobiles. Cependant y a-t-il une différence entre le séjour où nous étions et ce palais, entre l'espace que nous avons
traversé et ces jardins ? Revenu à votre vie habituelle, vous doutez de la réalité de ce qui s'est passé. Mais comment fixer une limite aux changements ? Comment établir une distinction entre la
rapidité et la lenteur ? Les termes de comparaison nous font défaut.
Le roi fut ravi de cette révélation. Dès lors il ne prit aucun souci des affaires du royaume, ni aucun plaisir en son palais, car il ne cessait de songer à de lointains voyages. Un jour enfin il
fit atteler à deux chars huit chevaux enchantés, présents d'un prince barbare, et partit dans la direction de l'ouest, accompagné seulement de deux conducteurs et de deux valets. Il atteignit
d'abord le pays des Géants rouges, qui lui offrirent à boire du sang de cygne blanc, et du lait de jument pour lui laver les pieds. Il se remit en route et atteignit au soir les bords du Lac
rouge, devant le mont Koen-liun. Le lendemain, jour faste qui était le cinquante-huitième du cycle sexagésimal, il fit l'ascension de cette montagne où il voulait visiter le palais bâti jadis par
l'empereur Hoang-ti ; il y fonda un culte pour l'édification de la postérité. Il resta là cinquante-cinq jours, puis reprit sa marche, et en neuf jours arriva au royaume de la Reine
d'Occident.
La Reine d'Occident partage avec le Roi d'Orient la direction des deux principes, le principe positif ou mâle et le principe négatif ou féminin, elle détermine avec lui l'harmonie du ciel et de
la terre et la formation de tous les êtres. Au ciel comme sur terre toutes les femmes qui ont atteint l'immortalité lui obéissent. Elle habite, dans les jardins du mont Koen-liun, la terrasse
ténébreuse du pavillon de jade, qui a neuf étages, touche à gauche l'étang de turquoise, et est entouré à droite par les eaux d'azur.
Le lendemain, jour faste qui est le premier du cycle, le roi Mouh fut reçu par la Reine d'Occident. Le jour suivant, il lui offrit une fête au bord de l'étang de turquoise. La Reine chanta pour
lui ces vers :
Au ciel les nuages blanchissent,
Sur les monts les forêts se hérissent ;
La route longuement s'éloigne,
Coupée de montagnes et de fleuves.
Que la mort vous soit épargnée :
Ainsi vous pourrez revenir !
Le roi lui répondit, sur le même air, par des paroles mélancoliques. Puis il partit. Plus rapides que jamais, ses chevaux parcouraient mille lieues en un jour. Il atteignit ainsi le bord de
l'abîme où disparaît le soleil. Alors il s'arrêta et dit en soupirant :
— Hélas ! Pourquoi, moi que voici, ai-je reçu ma part de joie sans avoir accompli ma vertu ? Les siècles futurs, revenant sur ma vie, ne manqueront pas de faire le compte de mes fautes, car le
roi Mouh n'est pas parvenu à la divinité. Je puis épuiser tous les plaisirs dont ce corps est capable. Quand j'y mettrais cent ans, il n'en faudra pas moins mourir, et le peuple croira que je
suis monté au ciel !

Tchang Tao-ling descendait à la huitième génération de Tchang Tze-fan, ministre de Kao-tsou,
fondateur de la dynastie des Han. Il naquit sous l'empereur Koang-wou de la même dynastie, en l'an trente quatre de l'ère chrétienne. Sa mère avait rêvé qu'un géant descendait de la constellation
de la Grande Ourse et lui donnait des fleurs odorantes. Elle s'éveilla : la chambre était imprégnée d'un parfum étrange qui persista un mois sans se dissiper. Émue, elle se trouva enceinte. Le
jour de la naissance, un nuage jaune enveloppa la chambre, une vapeur violette emplit la maison. Au milieu de la chambre, une lueur éclatante parut.
À sept ans, l'enfant lisait le livre de la Voie et de la Vertu, et en comprenait le sens le plus caché. Il vécut d'abord dans le monde, mais déjà il appartenait de cœur à la haute doctrine. Un
jour qu'il s'était rendu dans le pays de Chouh, qui est la province moderne du Sse-tchoen, il fut gagné par le charme de ces sites pittoresques et de ces solitudes luxuriantes. Il se retira sur
le mont du Chant de la grue, qui porte à son faîte une grue de pierre. Un disciple nommé Wang-tch'ang vint l'y rejoindre et ils étudiaient ensemble les écrits célestes, s'entretenaient des
enseignements de Lao-tze et de Hoang-ti, préparaient l'élixir de longue vie. Ils l'eurent acquis en trois ans. Tchang avait alors soixante ans ; il avala l'élixir et redevint pareil à un homme de
trente ans.
S'enfonçant alors dans une retraite plus profonde, il se rendit avec son disciple dans les monts des Cimes du Nord. Un envoyé céleste vint l'y trouver et lui dit :
— Sur le pic du milieu, dans une grotte, sont cachés les écrits ésotériques des anciens Souverains et le livre de l'élixir de la grande Pureté. Celui qui s'en sera rendu maître gagnera le
ciel.
Après s'être préparé par sept jours de jeûne, Tchang découvrit la grotte, y pénétra. Comme ses pas résonnaient sur le sol, il le creusa et découvrit la cachette où étaient enfouis les livres
sacrés. Il devint alors capable de diviser son corps et disperser son apparence. Il lui arrivait de voguer en barque sur un étang, de lire un livre dans sa chambre, de recevoir des hôtes à sa
table, de se promener en chantant, tout cela dans le même temps, sans que personne y pût rien comprendre. Sa science complète lui valut le titre d'Homme véritable.
Un jour qu'il méditait dans la montagne, il eut une vision. Il entendit d'abord un tintement de sonnailles et les sons inconnus d'une musique céleste. Ayant tourné la tête vers l'orient, il vit
paraître, au milieu des nuages violets, un char blanc, et sur le char un homme divin dont le visage pareil à la glace ou au jade rayonnait d'un éclat éblouissant. Un serviteur précédait le char.
S'adressant à Tchang, il lui dit :
— Ne craignez rien : c'est Lao-tze qui vient à vous.
Le Véritable alors s'inclina et entendit ces paroles :
— Il y a en ce moment dans le pays de Chouh six rois des enfers qui persécutent les hommes. C'est grande pitié. Allez donc à ma place les mettre à la raison et rendre le bonheur aux êtres
vivants. Pour ce combat je vous apporte le talisman secret et redoutable de l'Unité parfaite, le livre des Trois Purs, deux épées magiques, une mâle et une femelle, et le Sceau des mérites
universels. Je vous attends dans mille jours aux Jardins enchantés.
Après avoir consacré plusieurs jours à lire le livre qui venait de lui être remis, le Véritable partit pour combattre les rois des enfers. Sur le mont de la Ville bleue il dressa un trône de
cristal, plaça ses talismans à droite et à gauche, et ferma le cercle des nattes magiques. Il frappa sur les cloches et les pierres sonores, pour appeler les esprits malfaisants. Une armée de
démons accourut ; brandissant leurs couteaux, jetant des flèches et des pierres, ils attaquèrent le Véritable. Mais le Véritable leva un de ses doigts qui se changea en fleur de lotus, et les
démons furent repoussés. Ils revinrent avec des torches enflammées. Le Véritable leva un second doigt, et les démons furent eux-mêmes brûlés.
Le lendemain, les six rois des enfers vinrent en personnes, à la tête d'une nouvelle armée. Le Véritable prit un pinceau de cinabre et traça un signe. Les démons et les rois tombèrent à terre.
Cependant les rois vivaient encore et demandaient grâce. Le Véritable fit avec son pinceau un trait sur la montagne qui se fendit, empêchant les rois de passer. Ils se mirent à le supplier en
pleurant. Alors le Véritable dit à son disciple Wang-tch'ang de jeter une pierre sur l'abîme pour faire un pont, et de son pinceau traça un autre signe. Les rois se relevèrent, et les démons
ressuscitèrent. Le Véritable leur enjoignit de franchir le pont et d'aller se retirer dans les déserts du nord et de l'ouest. Comme ils hésitaient, il prononça une formule magique qui vola
jusqu'au ciel supérieur, déchaînant le tonnerre, l'ouragan, la tempête et la foudre : la horde des démons fut anéantie.
Après mille jours écoulés, Lao-tze apparut de nouveau à Tchang ; mais ce fut pour lui dire :
— Grâce à vos mérites accumulés, vous alliez devenir un Immortel du rang suprême. Mais quand je vous ai envoyé au pays de Chouh, c'était pour chasser les démons, non pour les massacrer, ni pour
disposer à votre gré du tonnerre, de l'ouragan, de la tempête et de la foudre. C'est pourquoi votre épreuve terrestre n'est pas terminée.
Accompagné de Wang-tch'ang, le Véritable revint au mont de la Grue. Comme ils approchaient, douze fées vinrent à leur rencontre, souriantes, et leur dirent :
— Il y a près d'ici un étang où habite un dragon venimeux ; ne pourriez-vous l'en faire sortir ?
Le Véritable traça en l'air un signe et aussitôt, changé en un oiseau aux ailes d'or, alla planer au-dessus de l'étang : le dragon prit peur et s'enfuit. Dès que le Véritable eut repris sa forme
humaine, les douze fées s'approchèrent de lui, tenant chacune un anneau de jade qu'elles lui offrirent, en signe de reconnaissance, et elles dirent :
— Nous voulons être vos épouses.
Le Véritable ayant pris leurs anneaux les tordit dans sa main et avec les douze en fit un seul, qu'il jeta dans l'étang.
— Je ne prendrai qu'une seule épouse, dit-il, c'est celle de vous qui retirera l'anneau.
Les fées se dévêtirent en hâte et se jetèrent dans l'étang où elles se disputaient l'anneau. Le Véritable les y enferma par une parole magique. L'eau de cet étang est salée. Comme il n'y avait
plus rien à craindre ni du dragon ni des fées, les gens du pays vinrent y pratiquer l'extraction du sel, qui a continué sans interruption jusqu'à nos jours.
Le Véritable était reconnu comme le maître de la doctrine. Un jour il s'était rendu au mont de la Terrasse des nuages ; une centaine de disciples l'accompagnaient. Le sommet de cette montagne est
coupé d'un côté, et plonge par une paroi verticale dans l'abîme. Un peu au- dessous, accroché par ses racines à une fente de la roche, un pêcher avait poussé obliquement, de sorte que l'extrémité
de ses branches arrivait à cinq ou six toises du sommet de la montagne. Ce pêcher était alors chargé de fruits. Le Véritable dit à ses disciples :
— Si l'un de vous cueille ces fruits, je lui enseignerai les secrets de la Voie.
Mais tous, suant d'angoisse, n'osaient même jeter un coup d'œil sur le précipice. Seul un jeune homme, qui se nommait Tchao-cheng, s'écria :
— Quand le bien de notre âme est en jeu, qu'importe le danger ?
Il se jeta dans le vide, et tomba juste sur la cime de l'arbre. Il se mit aussitôt à cueillir les pêches dont il remplissait son giron. Mais comment remonter ? La roche était abrupte et lisse
au-dessus de sa tête, sans aucun point d'appui. Alors, pour qu'au moins sa vie n'eût pas été sacrifiée en vain, il se mit à jeter en l'air les pêches qu'il avait cueillies. Le Véritable les
rattrapait à mesure. Il y en avait cent deux. Le Véritable en distribua cent aux disciples, en garda une pour lui, une pour Tchao-cheng. Il étendit le bras ; son bras s'allongea, et c'est ainsi
que tendant la main au jeune disciple il le ramena sur la montagne.
En l'année cent cinquante-deux de l'ère chrétienne, le premier mois, au cinquième jour, le Véritable reçut avis de Lao-tze que son temps était accompli. Il remit à son fils aîné ses livres, ses
talismans, les deux épées, les tablettes et le sceau de jade, et depuis lors le souverain pontife de l'église taoïste, qu'on appelle le Maître céleste, a toujours été choisi dans sa famille. Au
neuvième mois de la même année, au neuvième jour, il se rendit sur le mont de la Grue. À midi, le cortège des Immortels vint au-devant de lui, aux sons d'une musique céleste ; il s'éleva au ciel
avec eux, et c'est alors qu'au sommet de la montagne la grue de pierre chanta.

Sous le règne de l'empereur Ming, de la dynastie des Han, Liou-tch'en en compagnie de
Yuen-tchao s'était aventuré dans le massif du T'ien-t'ai pour y chercher des simples. Ils s'égarèrent dans la montagne, leurs vivres s'épuisèrent. Depuis treize jours déjà ils étaient en proie à
la faim et à la soif. Étant montés sur un pic pour tenter de se reconnaître, ils aperçurent au-dessous d'eux le feuillage d'un pêcher chargé de fruits, qui avait poussé le long d'une paroi
abrupte, dans une anfractuosité de rocher. En s'aidant de plantes grimpantes, ils parvinrent à descendre jusqu'à l'arbre et à remonter avec quelques pêches qui trompèrent leur faim.
Ils prirent, pour redescendre du sommet, un autre chemin, sans le vouloir, et se trouvèrent tout à coup devant un torrent. Ils s'y désaltérèrent. Dans un remous de l'eau, ils virent émerger un
bol qu'ils attirèrent à eux : il contenait des grains de sésame. Ils s'écrièrent :
— Nous approchons d'un endroit habité. Nous sommes sauvés !
Ils suivirent le cours du torrent qui les conduisit, de l'autre côté de la montagne, à une agréable vallée où coulait une belle rivière. Sur la rive deux jeunes filles fort jolies semblaient les
attendre. Du plus loin qu'elles les virent :
— Monsieur Liou, monsieur Yuen, est-ce que vous nous rapportez notre bol ?
Et sans leur laisser le temps d'être surpris :
— Comme vous vous êtes fait attendre ! Venez-vous ?
Liou et Yuen les suivirent sans se rendre compte de ce qui leur arrivait. La maison des jeunes filles était grande et bien bâtie. Dans la salle où les voyageurs furent introduits, les murs
étaient tendus de soie cramoisie, et les fenêtres avaient des rideaux de gaze par où l'on découvrait les arbres du jardin et les massifs de fleurs. Les jeunes filles cependant pressaient une
vieille servante :
— Ces messieurs ont bien eu quelques fruits de rubis, qu'ils ont su cueillir, mais ce n'est pas assez, hâtez-vous de les servir, car ils doivent avoir grand appétit.
On servit des tranches de chevreuil accommodé aux grains de sésame, d'un goût exquis. Après le repas une troupe de musiciennes entra ; elles jouèrent sur le luth, la flûte, et le petit orgue des
airs inconnus, pendant que les voyageurs causaient, en buvant le vin chaud, avec les jeunes filles. Elles connaissaient tous les détails de leur existence et de leur parenté, mais ils n'osaient
les interroger à leur tour.
À minuit, deux lits furent dressés, et on souhaita bonne nuit aux voyageurs. Liou était déjà couché et allait s'endormir, quand jetant un dernier regard sur l'autre lit, il s'aperçut que son ami
n'était pas seul : une des jeunes filles se trouvait auprès de lui. Il allait les interpeller, quand l'autre jeune fille parut devant son lit et le doigt aux lèvres, en souriant lui fit signe de
se taire. Elle vint doucement s'étendre à ses côtés. Son corps délicat avait l'éclat et la douceur du jade. Un parfum étrange et délicieux l'environnait.
Le jour venu, les deux amis demandèrent le chemin pour partir.
— Restez encore un jour ! dirent les jeunes filles.
Elles avaient des larmes dans les yeux. Ils se laissèrent retenir, et il en fut ainsi pendant bien des jours. Cependant le souvenir du pays natal ne quittait pas leurs cœurs. Un jour ils crurent
remarquer que le ciel était moins pur et que les fleurs se fanaient. « L'hiver approche, se dirent-ils ; il faut rentrer. » Ils firent part de leur résolution aux jeunes filles, et ce fut à leur
tour de pleurer. Les jeunes filles voyant leur désespoir s'étaient fait un signe d'intelligence.
— C'est, dirent-elles, que vous n'êtes pas encore délivrés complètement du péché originel. Voilà pourquoi vous avez du regret. Nous ne vous retiendrons plus.
Elles leur dirent adieu sans montrer de tristesse, et leur indiquèrent la route à suivre.
En approchant de leur village, Liou ni Yuen ne le reconnaissaient plus. Les maisons avaient changé d'aspect, et dans la rue on ne voyait que de nouveaux visages. Ils se nommèrent : on se
souvenait bien que deux hommes de ces noms, partis pour chercher des simples dans le massif du T'ien-t'ai, n'étaient jamais revenus. Depuis lors, sept générations avaient passé.
Liou et Yuen se remirent en route, mais ils ne retrouvèrent ni le pêcher magique, ni le torrent, ni la vallée, ni la maison des deux jeunes filles. Ils errèrent ainsi dans la montagne jusqu'à
leur mort.
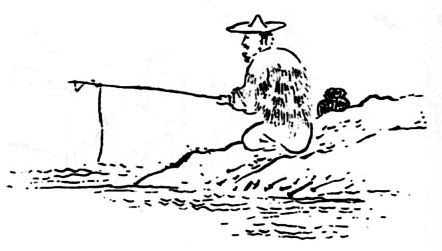
Confucius était allé se promener dans la forêt des Voiles noirs. Il s'était assis non loin
de la rivière sur un tertre ombragé d'abricotiers. Ses disciples avaient pris des livres, et le maître chantait en s'accompagnant sur la cithare. Il n'était pas arrivé encore au milieu de sa
chanson, qu'un vieux pêcheur approchant sa barque du rivage en descendit. Il avait les sourcils et la barbe blanche, les cheveux flottants, les manches retroussées. Ayant gravi la berge et
parvenu à la terre ferme, il s'arrêta. La main gauche appuyée à son genou, et de la droite soutenant son menton, il écouta la chanson jusqu'au bout. Deux disciples, nommés Tze-koung et Tze-lou,
s'étaient approchés de lui.
Désignant de la main Confucius, il demanda :
— Qui est-ce ?
Tze-lou répondit :
— C'est un sage du pays de Lo.
— Et son nom ?
— Confucius.
— Quelle est la profession de Confucius ?
Tze-lou gardant le silence, Tze-koung prit la parole :
— Dans son âme il obéit à la droiture et à la sincérité, de sa personne il pratique l'humanité et la justice, veille au bon ordre des rites et de la musique, définit les devoirs de chaque
condition ; il sert loyalement les maîtres du monde et réforme les mœurs du peuple, afin de se rendre utile ici-bas : telle est la profession de Confucius.
Le vieux pêcheur demanda :
— Est-il donc prince ?
— Non pas.
— Ministre ?
— Pas davantage.
Alors le vieillard se mit à rire et s'en alla en murmurant :
— Humanité ! C'est bon à dire, mais j'ai bien peur qu'il n'arrive à rien qu'à s'épuiser d'efforts et de soucis pour compromettre à la fin la justesse de son chant. Ah ! qu'il est éloigné de la
Voie !
Tze-koung revint auprès de Confucius et lui rapporta ces propos. Confucius laissant là sa cithare se leva aussitôt en s'écriant :
— C'est un saint homme !
Il s'élança sur ses traces et le rejoignit au bord de la rivière, comme il prenait son bâton pour attirer la barque. Le vieux pêcheur se retourna, et reconnaissant Confucius demeura immobile,
pendant que Confucius reculait un peu et par deux fois le saluait jusqu'à terre, avant d'avancer de nouveau.
— Que désirez-vous ? demanda le vieux pêcheur.
— À l'instant vous aviez commencé de parler, quand vous êtes parti. Dans mon indignité, je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire, et viens vous prier humblement de vouloir bien me faire
entendre le son de votre voix, afin de me venir en aide.
— À la bonne heure, répondit le vieux pêcheur, je vois que vous aimez à vous instruire.
Confucius se prosterna deux fois encore, et dit en se relevant :
— J'ai étudié dès ma jeunesse, sans relâche, et je suis aujourd'hui dans ma soixante-neuvième année. Cependant je n'ai pas obtenu ce que je cherchais. Si la parfaite doctrine m'est révélée, ce
n'est pas d'un cœur léger que je la recevrai.
Le vieux pêcheur commença alors à l'instruire en ces termes :
— Les objets semblables s'attirent, les sons pareils se répondent. C'est la loi de nature. Je vais vous expliquer ma connaissance afin de régler votre action. L'objet de votre action, ce sont les
affaires humaines. Quand l'empereur, les princes, les ministres et le peuple se tiennent à leurs places respectives, l'ordre règne ; s'ils les quittent, le désordre est bientôt à son comble.
Quand les fonctionnaires s'acquittent de leurs charges et que les hommes vaquent à leurs affaires, chacun reçoit son dû. Les champs en mauvais état, les toitures délabrées, l'insuffisance de la
nourriture et du vêtement, la mauvaise répartition des impôts, la discorde entre les femmes et la confusion entre les aînés et les cadets, voilà les soucis des hommes du commun. La disproportion
des capacités à la fonction, le désordre de l'administration, une conduite où tout n'est pas clair, le mauvais vouloir des subordonnés, le mérite mal récompensé, la médiocrité des appointements,
voilà les soucis des fonctionnaires. Une cour sans fidélité, un État mal réglé, la maladresse des ouvriers, la mauvaise rentrée des impôts, le retard des audiences et le mécontentement de
l'empereur, voilà les soucis des princes. Le désaccord des deux principes, le désordre des saisons qui nuit aux biens terrestres, la violence des princes et leurs guerres de conquête qui
appauvrissent les peuples, le discrédit des rites et de la musique, la détresse du trésor public, le mélange des rangs et la corruption des mœurs, voilà quels sont les soucis de l'empereur dans
sa charge. Vous n'avez pas la charge d'un empereur ou d'un prince, ni la responsabilité d'un ministre, et vous prenez sur vous de régler les rites et la musique, de prescrire les devoirs de
chaque condition, afin de rendre les hommes meilleurs. N'est-ce pas trop ?
Confucius poussa un profond soupir, s'inclina de nouveau, et dit :
— J'ai été banni, proscrit, privé de mes biens, emprisonné, dans les différents royaumes que j'ai parcourus. Qu'ai-je fait pour mériter ces peines infamantes ?
Le vieux pêcheur changeant alors de visage s'écria avec dépit :
— Vous avez du mal à comprendre ! Il y avait un homme qui avait peur de son ombre et avait pris en horreur la trace de ses pas. Il s'enfuyait pour les laisser derrière lui. Mais plus il jouait
des jambes, plus ses traces se multipliaient, et il avait beau courir, son ombre ne le quittait pas. Il pensa qu'il n'allait pas encore assez vite et redoublait d'efforts sans relâche, il finit
par en mourir. Il ne savait pas qu'il lui suffisait de se mettre à l'abri du soleil pour faire disparaître son ombre, et de se tenir tranquille pour arrêter la trace de ses pas. C'était un grand
sot. Vous scrutez les degrés de l'humanité et de la justice, examinez les limites du différent et du semblable, considérez les variations du mouvement et du repos, évaluez les proportions de ce
qui est donné ou reçu, réglez les sentiments d'affection et de haine, prescrivez une mesure à la satisfaction et au mécontentement. Mais à quoi cela vous avance-t-il ? Songez donc à votre
personne et veillez à votre vérité, rendez aux hommes ce qui leur appartient, et vous ne serez plus jamais dans l'embarras. Au lieu de cela, vous négligez votre personne pour vous occuper
d'autrui. N'est-ce pas vous écarter du but ?
— Mais, répondit tristement Confucius, qu'appelez-vous donc la vérité ?
— La vérité, c'est la perfection de la pureté et de la sincérité. Sans la pureté, sans la sincérité, impossible d'agir sur les hommes. Celui qui se lamente par ordre a beau montrer de la
tristesse, il n'est pas en deuil ; celui qui s'irrite par ordre a beau montrer de la sévérité, il ne se fait pas respecter ; celui qui montre de l'affection par ordre a beau sourire, il n'obtient
pas l'harmonie. La véritable affliction mène son deuil sans bruit ; la véritable colère se fait craindre sans démonstration ; la véritable affection obtient l'harmonie sans sourire. Quand la
vérité est dans le cœur, le mouvement de l'âme est sensible au dehors, et voilà pourquoi nous estimons la vérité.
Alors Confucius supplia le vieux pêcheur de lui indiquer sa résidence afin qu'il pût le servir, acceptant d'avance l'office qui lui serait indiqué, et recevoir son enseignement. Mais le vieillard
s'y refusa.
— Nous ne pouvons faire route ensemble, dit-il.
Et repoussant sa barque loin du rivage, il partit et peu à peu disparut au milieu des roseaux.
Le disciple Yen-yuen ramena le char, et Tze-lou tendit les rênes à Confucius. Mais Confucius ne le voyait pas : il regardait les rides de l'eau s'effacer, et c'est seulement quand le bruit des
rames se fut éteint qu'il se décida à monter sur son char.


















