Louis Laloy (1874-1944)
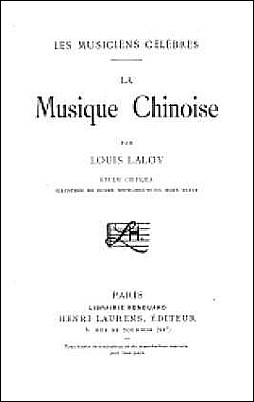
LA MUSIQUE CHINOISE
Collection ‘Les musiciens célèbres’, Henri Laurens, Éditeur, Paris, 1903, 128 pages.
- Les sources : "La Chine, encore aujourd’hui, regarde les autres pays de l’Extrême-Orient, Annam, Japon et Corée, comme ses tributaires ; et ce n’est là une fiction que dans l’ordre politique : ces empires, aujourd’hui indépendants ou tombés sous une tutelle étrangère, ne lui rendent plus hommage, mais ils lui doivent encore un respect filial ; car c’est d’elle qu’ils ont reçu la civilisation. Elle leur a enseigné les règles de la morale, celles des arts, les principes du droit et de l’administration. Le bouddhisme lui-même, qui vient de l’Inde, n’a passé jusqu’à eux que sous sa forme chinoise. Et c’est la Chine encore qui leur a appris à écrire, donc à penser, car ses caractères idéographiques sont des mots, non des signes qui représentent des sons, comme les lettres de notre alphabet : dans toute l’Asie orientale, ceux qui savent lire, lisent en chinois. L’Empire du Milieu est le maître vénérable des peuples qui l’entourent."
- "Ce sont les élèves que nous avons connus et appréciés d’abord. Pendant tout le XIXe siècle, le Japon seul fut à la mode ; aujourd’hui nous découvrons enfin la Chine, et nous apprenons à distinguer sa simplicité souveraine de la recherche japonaise. Ce qui est vrai des bronzes, des porcelaines, des ivoires, des jades, des panneaux peints, des poèmes et des ouvrages de philosophie, ne l’est pas moins de la musique. Celle des Japonais raffine avec subtilité sur la musique chinoise : celle des Annamites n’en est qu’un écho qui se perd. Chez les uns et les autres, cet art est abandonné aux hasards, heureux ou malheureux, de la pratique. Seuls les Chinois en ont fait la théorie ; seuls ils en ont étudié les lois et les effets. D’où ce grand avantage pour nous, que nous ne sommes plus seulement en présence d’instruments et de notes, mais d’un système qui établit la relation de ces notes entre elles, et, ce qui est plus précieux encore, de commentaires qui nous indiquent le sens et l’emploi des mélodies qu’elles forment."
- "Ce sont ces derniers témoignages qui doivent être recueillis en premier lieu ; une fois connu l’esprit de la musique chinoise, ni son système n’offrira plus rien d’aride, ni ses productions ne risqueront de rebuter ; sans doute, faute de l’éducation nécessaire, on ne retrouvera pas d’emblée, à les entendre, les impressions mêmes de ceux à qui elles se destinent ; du moins on aura l’idée de ces impressions ; et peut-être, avec un peu d’application et d’exercice, gagnera-t-on quelque chose de plus que l’idée. De même, le connaisseur en œuvres d’art commence par comprendre, et finit par sentir l’austère pureté d’un vase rituel, le néant philosophique de Lào-tzèu, la pitié de Kouān-Yīn."
Extraits : La doctrine - Le kîn - La notation
- Musique populaire
Feuilleter
Télécharger/Lire aussi
C’est le Li ki, ou Mémorial des Rites, qui expose la doctrine officielle de la Chine sur la
musique. Le chapitre qui concerne cet art, et dont le titre est Mémorial de la musique (Yŏ kì), a été introduit dans le recueil à une époque assez tardive, que la critique chinoise fixe au
premier siècle avant notre ère, mais la rédaction en est beaucoup plus ancienne. En voici le début :
« Si une note se produit, c’est dans le cœur humain qu’elle a pris naissance. Si le cœur humain est ému, c’est par l’action des objets. Sous l’impression des objets, il s’émeut, et son émotion se
manifeste par des sons. Les sons se répondent entre eux, ce qui donne lieu à des différences. C’est lorsqu’ils présentent ces différences qu’ils prennent le nom de notes. »
La musique est donc le langage naturel du sentiment. Et le sentiment lui-même a une cause qui n’est pas en nous. Selon la remarque d’un commentateur, le mot d’objet désigne ici toute «
circonstance extérieure » ; et on lit, un peu plus loin, dans l’ouvrage, ces aphorismes :
« L’homme naît dans l’état de repos ; telle est sa condition originelle. Sous l’impression des objets, il s’émeut : de là ses aspirations naturelles. »
Ainsi le sentiment exprime la relation de la conscience avec l’univers, du sujet avec l’objet, du moi avec le non-moi. Le son est le signe de cette relation. Mais le son n’appartient pas encore à
la musique : elle demande des notes, c’est-à-dire des sons différents. Un autre commentateur du texte cite en exemple les cinq notes de la gamme chinoise.
« Mélangées entre elles, dit-il, elles prennent le nom de notes. Émises isolément, elles portent celui de sons. »
En effet, ce qui définit une note, c’est son degré de hauteur, et ce degré ne peut être évalué que par comparaison.
Le son qui manifeste le sentiment humain est celui de la voix. La musique a commencé par le chant. Mais ce n’est là qu’une origine théorique. Dans la pratique, le chant s’accompagne d’instruments
; en outre, les mouvements de la danse répondent à ceux de la mélodie.
« En adaptant les notes aux instruments de musique, et en y ajoutant les boucliers et les haches, les plumes et les bannières, on obtient ce qu’on appelle la musique. »
Les boucliers et les haches sont les accessoires de la danse guerrière ; les plumes et les bannières, ceux de la danse pacifique. À la fin du traité, on nous montre comment ces divers éléments
sont devenus l’un après l’autre nécessaires :
« Dans la joie, l’homme prononce des paroles. Ces paroles ne suffisant pas, il les prolonge. Les paroles prolongées ne suffisant pas, il les module. Les paroles modulées ne suffisant pas, sans
même qu’il s’en aperçoive ses mains font des gestes et ses pieds bondissent. »
Ainsi se retrouve en Chine cette trinité des arts musicaux, poésie, musique et danse, qui fut en Grèce aussi un article de foi. Ici l’union est plus étroite encore : ce n’est pas pour satisfaire
à des conditions de beauté, c’est d’instinct que l’homme, dans ce transport joyeux qui accompagne tout sentiment fort, écoute ses propres paroles, en prolonge le son, en fait un chant, dont le
rythme s’impose à son corps.
Toute musique est émotion. Lire la suite...

Le plus ancien des instruments à cordes est le k’în : c’est un luth, monté d’abord de cinq, puis de sept cordes. Ces cordes sont en soie ; toutes égales en longueur, elles ne différent que par leur épaisseur, et la tension qu’on leur donne. La caisse est plate par-dessous, comme la terre, bombée en dessus, comme le ciel. Elle est faite en bois d’aréquier et vernie en noir. Des noms poétiques sont donnés à toutes ses parties, depuis la tête, qui est large et carrée, jusqu’à la queue arrondie ; deux échancrures sont les reins et le cou ; le sillet s’appelle la montagne sacrée ; deux cavités, dans la table inférieure, comptent comme l’étang du dragon et le bassin du phénix. La corde est attachée, par un nœud « en tête de mouche », à un cordonnet de soie tordu sur lui-même et qui, traversant la tête de l’instrument, vient se fixer sur une cheville. On augmente ou on diminue la torsion, par suite, la longueur du cordonnet, et la tension de la corde varie en conséquence, mais en des limites très étroites. Il faut établir d’abord un accord approximatif : on passe la corde sur la queue, dans une échancrure dite « la mâchoire du dragon », et on enroule l’extrémité sur l’un ou l’autre de deux boutons placés sous l’instrument. C’est à cette opération que procède le musicien des deux gravures reproduites ci-contre : de la main droite, il tire sur la corde ; et de la gauche il éprouve le son.

Les figures ci-contre montrent comment il faut soutenir la queue de l’instrument, pincer la
corde, l’aider à franchir la mâchoire du dragon, enfin la tirer.
Pas plus que nos cordes en boyau, les cordes de soie ne tiennent longtemps l’accord. L’instrument ne représente donc pas l’ordre fixe de liŭ. Pour chaque exécution, on le règle selon les
exigences de la musique : ses cinq cordes sont instituées pour donner lés cinq notes, à partir de l’un quelconque des douze liŭ. Le koūng se trouve au centre : si ce koūng est hoâng-tchoūng ou
fa, on a donc :

Au temps où fut écrit le Mémorial des Rites, le k’în à cinq notes était déjà un instrument ancien. Le k’în à sept cordes est seul usité aujourd’hui. Les deux notes ajoutées répètent les deux premières à l’octave :

Les cordes sont touchées de la main droite. Au long de la plus grave se trouvent incrustées dans le bois treize petites rondelles de métal ou de nacre : elles indiquent les places où les doigts de la main gauche doivent appuyer pour raccourcir la corde [figure ci-dessous].

On peut ainsi trouver sur une même corde quatorze notes, qui sont pour la première :

Le raccourcissement s’applique à toutes les cordes et donne à l’instrument une grande
richesse. La notation est une tablature : elle indique le numéro de la corde, et en regard de quelle marque il faut placer le doigt ; en outre, elle prescrit le doigté de chaque main, et la
manière dont la main droite attaquera la corde ; d’un doigt, de deux ou de trois, en l’attirant ou en la repoussant, en pinçant, frôlant ou martelant. Ces précautions montrent le compositeur
chinois attentif non à la note seule, mais à la sonorité dont il veut déterminer les plus subtiles nuances.
Le k’în est un instrument délicat. C’est pourquoi, outre son usage rituel, les amateurs le tiennent en haute estime, et en jouent volontiers dans le secret des salles retirées, seuls ou avec
quelques amis de choix, qui se taisent : véritable musique de chambre, aimée pour elle-même et non pour le succès. Et il ne suffit pas que le lieu soit paisible ; il faut aussi un cœur pur, et
une attitude de respect, ou le k’în profané ne livrera pas sa beauté. La méthode qui fait suite au recueil de Siù Ts’īng-chān énumère ses vertus. Elles sont au nombre de vingt-quatre ; le k’în
est à la fois :
Harmonieux. — Limpide. — Pur. — Distant. — Ancien. — Sans mélange. — Calme. — En repos. — Élégant. — Beau. — Lumineux. — Choisi. — Net. — Gras. — Rond. — Ferme. — Vaste. — Délié. — Coulant. —
Solide. — Léger. — Lourd. — Lent. — Rapide.
Chacun de ces attributs est ensuite l’objet d’une méditation. Voici la deuxième (Limpide) :

« Trouver, pour jouer du luth, un lieu de limpidité, ce n’est pas difficile. Ce qui est
difficile, c’est la limpidité dans le mouvement des doigts. Or, si les doigts se meuvent, c’est pour chercher le son. Comment donc atteindre la limpidité ? Je dis qu’il faut la chercher dans le
son même. Si le son est rude, c’est signe que les doigts sont inquiets ; si le son est épais, c’est signe que les doigts sont impurs ; si le son est ténu, c’est signe que les doigts sont
limpides. C’est ainsi qu’il faut scruter les notes. Or la limpidité se produit de cette manière, mais le son vient du cœur. Si donc le cœur a trouble et désordre, la main aura une sorte
d’agitation ; c’est avec cette agitation qu’elle touchera le luth : comment pourrait-elle atteindre la limpidité ? Seuls les sages formés dans la retraite, à l’âme dépouillée et paisible, ont
fait choix de la limpidité. Leur cœur est sans poussière, leurs doigts sont de loisir. Ils réfléchissent à la ténuité du son, et, en y pensant, ils l’obtiennent. Ce qu’on appelle ténuité, c’est
le plus haut degré de la limpidité. Elle communique avec l’immensité obscure, sort de l’être et entre dans le néant, et fait voler son émanation, jusqu’au séjour élevé de l’empereur Foŭ.
« Pour que les doigts exécutent leur office, il faut : d’une part, se trouver dans une disposition harmonieuse ; de l’autre, les avoir exercés. Si la disposition est harmonieuse, l’âme possède la
limpidité ; si les doigts sont exercés, la note possède la limpidité. Ceux qui brûlent des parfums gardent la fumée et chassent la vapeur ; ceux qui font infuser le thé ôtent ce qui est trouble
et versent ce qui est clair ; de même, pour avoir un son limpide, on lave la souillure de l’humeur, on détend l’ardeur des sentiments ; de dessous les doigts on balaie toute passion, et sur la
corde on fait régner la pureté. C’est pourquoi on obtient la rapidité sans désordre et l’abondance sans excès. C’est le rayon clair dans l’eau profonde. Le sage qui possède la raison doit y
parvenir sans effort.
On voit que la doctrine chinoise, au cours des siècles, est restée fidèle à son haut spiritualisme ; mais elle a gagné, au contact des religions bouddhique et taoïste, une exaltation mystique :
le k’în est sacré. Un k’în monocorde est sur les genoux de cette divinité qui, « montée sur le dragon blanc, touchant une seule corde, parcourt les quatre mers » [figure ci-contre].
La sixième méditation (Sans mélange) se termine par ces vers :
J’aime ce sentiment
Ni tiède ni ardent.
J’aime cette saveur :
Goût de neige ou de glace.
J’aime cette rumeur :
Le vent dans les sapins, la pluie sur les bambous,
La chute du torrent, le bruissement des flots.
Ceux qui ont pu goûter la gravité suave de la soie chantante au-dessus du bois noir, sauront apprécier l’allégorie. Le barbare d’Occident qui écrit cet ouvrage se permettra une autre comparaison
: elle ne passera pas pour désobligeante en un pays comme la Chine, où l’art culinaire a gardé son rang. Le son du luth chinois est aussi délicat à l’oreille qu’au palais ces nids d’hirondelles,
mets sans substance, saveur évanescente, qui pourtant, apporte avec elle le souvenir des brises marines. Il faut, pour savourer l’un et l’autre, le recueillement. Ce n’est jamais par la force que
s’impose la musique du luth chinois ; pareille à l’épouse selon la sagesse et les rites, elle doit sa beauté, sa puissance, à sa douceur. Elle est sœur du silence ; elle ne paraît que s’il
l’accompagne ; et ce n’est pas là un de ses moindres bienfaits.
Le k’în passe pour très ancien. Un des empereurs légendaires en aurait réglé la construction : Hoâng-tí, ou même le plus ancien de tous, Foŭ-hī. Selon le Mémorial des Rites, c’est en
s’accompagnant du luth a cinq cordes que l’empereur Chouènn chantait ces vers de sa composition :
Le souffle parfumé du vent du sud
Peut dissiper les chagrins de son peuple.
La venue opportune du vent du sud
Peut augmenter les trésors de mon peuple.
Cependant le k’în fait appel au raccourcissement des cordes, qui ne semble pas avoir été connu de toute antiquité. La question reste obscure, et nous manquons des éléments nécessaires pour
discuter la tradition chinoise.

La notation chinoise énonce le nom des notes dans le sens de l’écriture, c’est-à-dire par
colonnes descendantes. et rangées de droite à gauche. Un point à droite marque la fin d’une phrase ou d’un membre de phrase, et les indications complémentaires sont mises en caractères plus
petits, à raison de deux colonnes pour une, ainsi que les commentaires dans les éditions classiques.
Les notes sont désignées par les noms des liŭ, pour les jeux de cloches et de pierres. Pour la voix, on emploie d’ordinaire les cinq mots qui qualifient les cinq degrés de la gamme chinoise :
koūng, chāng, kiŏ, tcheù, yù. Au début on indique à quel liŭ il faut mettre la note koūng. Les instruments à vent et la guitare se servent de la notation mongole, qu’ils interprètent chacun selon
son diapason particulier. On peut voir [ci-contre], ces deux modes de représentations réunis : sous chaque mot la note chinoise se trouve tracée en rouge, et la mongole en noir. Il s’agit en
effet d’un chant doublé par les instruments. Mais les ritournelles instrumentales qui séparent les strophes (6e colonne) ne sont écrites qu’au moyen des signes mongols.
Le luth et la cithare ont une tablature ; pour celle du luth, la plus explicite de beaucoup, on trouvera un exemple [ci-dessus, extrait 2].
Mais toutes ces notations ont le défaut de ne pas indiquer la durée relative des notes, ni les silences. La pratique et sans doute l’observation de certaines formules servent de guides au
musicien chinois. Nous sommes moins favorisés. Tout ce que nous savons, c’est que la mesure à deux ou quatre temps est presque seule employée, et que les groupes ternaires sont rares. Lorsque la
musique suit, à raison d’une note par mot, un texte en vers réguliers, nos doutes sont levés : tel est le cas pour le chant cité [ci-contre]. Mais dans tous les autres cas, et surtout pour les
mélodies instrumentales, nous sommes abandonnés à notre goût, trompeur presque à coup sûr.
Le rythme est quelquefois indiqué par des signes particuliers. Mais ce que les Chinois entendent par là, c’est une suite de coups de tambours ou de castagnettes, indépendante de la mélodie et
qu’on peut varier à volonté. Un recueil de chansons populaires qui donne ou plutôt propose des rythmes, cite à ce propos cette expression : « la mélodie morte, et le rythme vivant », c’est-à-dire
mobile. C’est un contrepoint libre, et le plus souvent improvisé.

Aux temps anciens, la musique était associée à tous les rites de la vie privée : le luth et
la guitare accompagnaient les festins ; des symphonies joyeuses accueillaient la fiancée, ainsi qu’en témoigne cette chanson nuptiale :
C’est le cri, le cri des mouettes
Par les îlots de la rivière.
Celle qui vit pure et secrète,
Bonne compagne pour le prince.
Diverses, les lentilles d’eau,
À droite, à gauche, sont flottantes.
Celle qui vit pure et secrète,
Nuit et jour nous l’avons cherchée.
La cherchant sans la trouver,
Nuit et jour nous avons pensé,
Si longuement, si longuement
Nous tournant et nous retournant.
Diverses, les lentilles d’eau,
À droite, à gauche, sont cueillies.
Celle qui vit pure et secrète,
Cithare et luth lui font cortège.
Diverses, les lentilles d’eau,
À droite, à gauche, sont servies.
Celle qui vit pure et secrète,
Tambours et cloches lui font fête.
En des occasions moins solennelles, la musique intervient aussi : elle célèbre un retour
désiré :
Mon seigneur est souriant,
Une flûte en sa main gauche,
De la droite il m’invite à sortir.
Ô joie, ô quelle joie !
Mon seigneur est radieux,
L’éventail en sa main gauche,
De la droite il m’invite à venir.
Ô joie, ô quelle joie !
Et les jeunes gens se réunissent, hors les murs des villes, pour danser sur les esplanades :
À la porte de l’est des ormes,
Et des chênes sur la colline.
La fille de Tzèu-tchoūng, la belle,
Dessous les arbres va dansante.
On choisit belle matinée
Au sud est une aire élevée,
Elle ne file pas le chanvre,
Mais sur la place va dansante.
On sort par belle matinée,
Et l’on marche en grande assemblée.
Belle à voir comme fleur de mauve,
Des grains de poivre en ma main pose.
La musique qui préside à ces fêtes et ces galanteries était sans doute populaire, au sens premier du mot, qui n’est plus le nôtre : elle était destinée à un peuple où tous avaient même goût.
Aujourd'hui la distance est si grande entre riches et pauvres, lettrés et artisans, maîtres et serviteurs, que les instruments mêmes diffèrent. Les uns gardent comme des privilèges leurs luths,
leurs cithares et leurs flûtes délicates, laissant à la masse ignorante la guitare, les violons et les hautbois. Mais ces humbles sont, eux aussi, passionnés de musique ; ils y mettent quelque
grossièreté : leurs oreilles gloutonnes se régalent de bruit ; même elles sont contentes si le grincement des archets ou des anches les écorche un peu. Mais les airs qu’on leur offre, simples et
sans ornement, par là même nous touchent davantage : ils laissent plus naïvement transparaître, sous leur douceur paisible, l’émotion. Une musique alerte accompagne la chaise close où la fiancée,
en joyeux cortège, est conduite à la maison qui sera sienne [mélodie 5, ci-dessous]. Une musique funèbre précède le cercueil [mélodie 6].
Hautbois et clarinettes font retentir ces accents sur le tumulte des rues. Mais, dans le privé, l’instrument d’élection est la guitare, plus sonore que le luth, moins nuancée, douce encore. Elle
accompagne le chant de la jeune fille qui n’a pu retenir un amant passager :
En secret, en secret je soupire ; qui connaît mon malheur ?
Depuis le temps qu’il est parti, pas une fois une lettre ne m’est venue.
Toute cette douleur me vient de vous, seigneur !
Vous avez appris à votre esclave à passer toute la nuit en rêves insensés.
Ah ! dans une existence passée, il faut, je pense, que je n’aie pas fait mon devoir : c’est pourquoi, aujourd’hui, mon lot est le mépris.
Aux visages fardés de rouge est réservée la solitude amère ; je ne sais combien l’amertume durera.
On m’invite, et je tourne le dos pour essuyer les larmes de mes joues.
Je crains que les traces de ma tristesse ne révèlent mes pensées d’amour.
Mais je ne sais comment me délivrer de ce mot unique : douleur.
Ah ! vraiment, le goût en est pénible !
Ciel, il me semble qu’ayant créé les hommes, tu ne devais pas leur infliger l’absence.
Telle autre, qui habite seule en quelque rue nocturne de la ville, s’afflige aussi :
Fleur de fumée, iah ! allée de saules !
Elle a son tablier, ses épingles, iah !
Sur ses joues a mis le bon fard,
Empourprée comme fleur qui s’ouvre, iah !
On croirait voir venir un ange.
Haï ! haï ! haï !
Aï iah ! hou haï iah !
Elle a pris et mis son enseigne.
Haï ! haï ! haï !
C’est avec la mort dans l’âme qu’elle fait ces apprêts. Enfant, elle a été vendue par ses parents ; elle a connu les mauvais traitements, les coups ; elle énumère les hontes qui lui furent
enseignées; vieillie, elle sera méprisée, sans amis, et plus tard un fils ne brûlera pas l’encens devant sa tablette funèbre ; un sauveur ne se trouvera-t-il pas pour la sortir d’infamie ? Sa
plainte est sans révolte, et, comme sa sœur délaissée, elle croit, en bonne bouddhiste, « avoir péché en une autre existence ». La mélodie atteste sa peine résignée [mélodie 7 ci-dessus].
Ce sont là les quartiers extérieurs de la cité chinoise, facilement accessibles à l’Européen. Mais le foyer paisible a aussi ses chansons, qui nous livrent un peu de son secret. L’épouse y
dévoile ses vertus de douceur, de fidélité, de soumission, et une tendresse qui resterait toujours cachée, sans le déchirement du regret. Le mari est allé à la capitale pour les examens ; depuis
six années sa femme est sans nouvelles, et se désole. Un jour, elle demande à son miroir de lui présenter les traits aimés, mais elle n’y trouve que les siens, et, désespérée jusqu’à la colère,
brise le verre ingrat. À ses lamentations prolongées, guitares et violons répondent [mélodie 8].
Un autre est parti pour la guerre, et l’appel de la délaissée monte à chacune des cinq veilles nocturnes [mélodie 9].
Celle-ci est veuve, et chacun des douze mois lui rappelle un souvenir de bonheur [mélodie 10].
*
Lire aussi :
- Joseph Marie Amiot : La musique des Chinois.
- François Arnaud : Mémoire sur les danses chinoises. Et: Ly-Koang-ty, L'ancienne musique chinoise.
- Charles Compan : Danses des Chinois. Un extrait du Dictionnaire de danse.
- Jean-Benjamin de La Borde : De la musique des Chinois. Extrait de Essai sur la musique.
- Adrien de La Fage : Musique des Chinois. Liv. I d'Hist. gle de la musique.
- Charlotte Deveria-Thomas : Essai nouveau sur la musique chez les Chinois.
- Maurice Courant : Essai historique sur la musique classique des Chinois.
- Marcel Granet : Danses et légendes de la Chine ancienne.























