Léon Wieger (1856-1933)
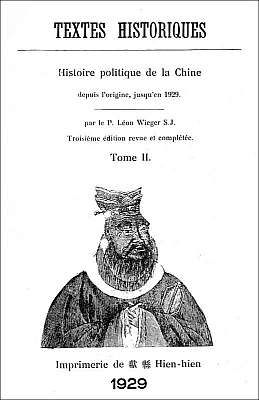
*
1124. Relation de l'ambassade chinoise au roi des Kinn
Cette pièce fait revivre les mœurs de ce temps.
La frontière entre les Kīnn et les Sóng, est marquée par une levée de terre haute de trois pieds. De chaque côté, pour éviter les conflits, il
est défendu de cultiver une bande d’un lì de large. Quand l’ambassade chinoise arriva à la frontière, l’officier Kīnn chargé de l’introduire, l’attendait de l’autre côté. Chaque parti dressa son
campement de tentes de son côté. Puis l’ambassadeur chinois envoya, par son héraut, une lettre dans laquelle il demandait la permission de passer la frontière. L’officier Kīnn lui répondit, aussi
par écrit, qu’il était chargé de le conduire. Alors l’ambassadeur chinois monta à cheval. Il se rencontra avec l’officier Kīnn, sur la frontière. Les deux envoyés se présentèrent, leurs deux
chevaux se faisant face. Les lettres étant échangées, ils se saluèrent, levèrent leur cravache, puis l’envoyé Kīnn volta, l’envoyé chinois passa la frontière, et tous deux se mirent en marche
côte à côte... L’habitude des Kīnn étant de galoper d’une traite, depuis le déjeuner jusqu’au souper, sans manger ni boire, les Chinois souffrirent beaucoup de la faim et de la soif... Un peu
plus loin que le Moukden actuel, le préfet de Hiên-tcheou donna à l’ambassadeur une petite fête. Danses, avec accompagnement de tambours, flûtes et castagnettes. Les tambours des Barbares sont
trop graves, leurs flûtes sont trop criardes, leurs castagnettes ne savent pas marquer la mesure, leurs danseurs ne savent pas évoluer, c’est un spectacle indigne d’être vu, observe notre
Chinois. Pour ce qui est du banquet, la musique jouant, on but neuf rasades de vin, en grignotant des pignons de pin. Puis, selon la mode barbare, les tables furent couvertes de tous les mets à
la fois, sans distinction de services successifs. Riz, cerf, lièvre, oie, surtout lard et mésentère, pâte cuite, gâteaux à l’huile et au miel. Quand il fut ivre, le préfet se mit soudain à vanter
le royaume des Kīnn, comme n’ayant pas son pareil au monde...
— Pourquoi insultez-vous aux Sóng ? lui demanda l’ambassadeur d’un air sévère ; vous n’avez pas mission pour cela ; ne créez pas de difficultés entre nos deux nations...
Intimidé, le Barbare ne dit plus mot.
À dix lì de la résidence de Ou-k’i-mai, au N. E. de Kirin, près de la Soungari, ville actuelle d’Altchoukou, pâturages dans lesquels des fermes sont disséminées, comme les étoiles au ciel, comme
les échecs sur l’échiquier. Ni remparts, ni rues, ni ruelles. C’est pour faire paître leurs bestiaux autour de leurs demeures, que les habitants les disséminent ; spectacle très original pour un
Chinois, une habitation isolée étant un phénomène rare en Chine. Un mur clôt le douar du roi. L’ambassadeur démonta, entra à pied dans l’enceinte dans laquelle des palais étaient en construction,
et fut logé dans une tente, où on lui apprit d’abord le cérémonial. Il fut ensuite reçu par Ou-k’i-mai, dans une grande halle. Des deux côtés, avec des soieries de diverses couleurs, étaient
figurées des monts et des rochers, garnis de pins et de cyprès, de dragons et d’éléphants, de Buddhas et d’Immortels. Des hommes cachés derrière ces décors, imitaient le chant des oiseaux. Le
siège d’Ou-k’i-mai était comme une chaire de pagode, couvert de deux peaux de tigre. Le roi portait un bonnet noir à pendants analogue à celui des bonzes, une robe de soie brodée, une ceinture à
agrafe en jade, des bottes en cuir blanc. C’était un homme d’environ 38 ans, à barbe rare. Devant lui étaient disposées de petites tables en laque rouge, ornées d’argentures et de dorures.
Vaisselle en or, jade, écaille, ivoire. Tout le repas fut servi en une fois. Musique sans interruption. Le vin passa cinq fois. Puis le repas desservi fut distribué aux gens de la suite, tandis
que chaque convive recevait en cadeau une robe brodée et une ceinture. Après les remerciments rituels, retour à l’hôtel.
Le lendemain, banquet des fleurs. Chaque convive avait une vingtaine de fleurs artificielles piquées dans sa chevelure. Musique, pantomimes avec grand vacarme, scènes de chasse et de combat. Des
baladins dansèrent sur la corde, d’autres grimpèrent à des mâts, d’autres jonglèrent avec des boules, d’autres lancèrent des ballons. Il y eut des luttes d’hommes, des combats de coqs, et autres
divertissements. Les costumes étaient éclatants et variés. Des femmes fardées, placées derrière la scène, jonglaient avec des miroirs, projetant des éclairs de lumière sur les acteurs et les
spectateurs, comme on représente la déesse de la foudre.
Le jour suivant, tir à l’arc, avec prix de chevaux et d’habits.
Le lendemain, audience de congé. Après le banquet, l’ambassadeur chinois s’avança devant le trône, et demanda la missive qu’il devait rapporter à son maître. Il la reçut, et revint à sa place, en
l’élevant des deux mains. Reconduit à son hôtellerie, l’envoyé chargé de l’escorter, lui donna un repas d’adieu. Dans les banquets de la cour, observe le narrateur, on n’avait pu que peu manger
boire et parler. Cette nuit-là, on se dédommagea. On parla et on rit tant qu’on put, et la fête ne finit, que quand tous les convives furent parfaitement ivres.
Le lendemain, départ. À la frontière, les deux envoyés tournèrent leurs chevaux face à face. Restant en selle, ils burent une tasse de vin, et échangèrent leurs cravaches, en souvenir. Puis,
s’étant salués, ils fouettèrent leurs chevaux, voltèrent simultanément, s’éloignèrent en regardant en arrière, s’arrêtèrent, repartirent, et ainsi trois fois de suite ; pour exprimer combien il
leur coûtait de se séparer. Enfin chaque parti prit sa course...
Hù k’ang-tsoung termine en disant qu’il constata que l’invasion de la Chine par les Kīnn était imminente.
Le nom de famille de Gengis khan était Ki-ou-wenn. Sa horde stationnait dans les vallées du Keroulen et de l’Onon, branches terminales de l’Amour
(P). Son père Ye-sou-kai commença sa fortune, en battant les Ta-tan ou T’a-t’a-eull, Tatares ou Tartares des (Y) Yīnn-chan... Pourquoi les Mongols furent-ils connus en Europe, plutôt sous ce
dernier nom ? Peut-être que les premiers corps des armées mongoles qui parurent en Europe, furent des corps de cette nation, laquelle ne fut jamais très florissante.
Gengis-khan fut déiste. Il favorisa tous les cultes, et enjoignit à ses descendants de faire comme lui. Il y a un Dieu (le mot mongol Tengri signifie, et Dieu, et le ciel), disait-il ; mais peu
importe comment on l’honore... Personne n’a mieux décrit la religion des Mongols, que le bon Frère Ricold dans sa Peregrinacion :
« En manière de vivre et de créance, diffèrent-il de toutes autres nations du monde, car il ne se vantent point d’avoir loy baillie de Dieu, comme plusieurs autres nations mentent, mais croient
un Dieu, et ce bien tenument et bien simplement, par ne sçay quel mouvement de nature, que nature leur monstre, que, sur toutes choses du monde, est une chose souveraine qui est Dieu. »
Aboul Ghazy parle de même.
Les Mongols, dit-il, adorent Dieu, qui fut adoré en Tartarie depuis Japhet. Gengis-khan imposa aux Mongols cette croyance, mais sans spécifier le culte, les laissant libres de se plier aux temps,
aux lieux et aux circonstances. Il craignit qu’une croyance exclusive ne gênât leurs conquêtes et l’établissement de l’empire universel qu’il rêvait. De là vient que, partout où régnèrent des
Gengis-khanites, ils conservèrent le culte dominant, et tolérèrent les autres. Ils furent buddhistes en Chine, musulmans en Perse, etc. En Allemagne, ils auraient été chrétiens.
Sommaire du Yassa (code) de Gengis-khan
promulgué dans le kouriltaï (diète) de Karakorum, en 1205.
Obligation de croire qu’il y a un Seigneur suprême, auteur du ciel et de la terre, qui donne la vie et la mort, la richesse ou la pauvreté ; qui
accorde ou refuse selon qu’il lui plaît ; qui a, sur toutes choses un pouvoir absolu.
Tolérance de tous les cultes. Les prêtres de toutes les religions consacrées, les médecins, ceux qui lavent les cadavres, sont exempts de toute charge publique.
Défense, sous peine de la vie, à quiconque n’a pas été élu par la diète générale de la nation, d’usurper le trône des Mongols. Empire électif, non héréditaire. C’est bénévolement que les princes
mongols conservèrent ce trône aux descendants de Gengis-khan.
Défense, aux princes, nobles et chefs mongols, de s’affubler de titres honorifiques.
Défense de faire jamais la paix avec aucun prince ou peuple qui ne se serait pas entièrement soumis.
Tout Mongol est soldat. Les guerriers sont répartis par goupes de dix, cent, mille, dix mille hommes. Chaque groupe a son chef. Les hommes se mobilisent et marchent, au premier appel de ce
chef.
Les armes sont déposées chez le chef, qui les remet aux soldats, au moment d’entrer en campagne. Les soldats doivent les entretenir en bon état. Le chef les inspecte avant le combat.
Défense de piller, avant le signal. Après le signal donné, chacun pille pour son compte, sans distinction de chef ou de soldat. Chacun paie au khan un droit sur la prise.
Défense de chasser en été, afin que le gibier puisse se multiplier. En hiver, grandes battues. Elles sont un exercice pour les guerriers, lesquels s’y forment aux grandes évolutions d’ensemble,
spécialité qui faisait la force des Mongols.
Tout Mongol est libre, et ne peut servir, même comme domestique. Le service est fait par les prisonniers étrangers réduits en esclavage. Peine de mort pour quiconque ne livre pas un esclave
fugitif.
L’homme achète ses femmes. Le nombre des concubines est illimité ; Gengis-khan avait plus de cinq cents femmes. Chaque femme a sa tente, et fait ménage à part. Sauf quelques petits privilèges
accordés aux fils des femmes principales, tous les enfants sont légitimes et égaux. Deux familles peuvent marier leurs enfants morts, et devenir ainsi légalement parentes. Le fils aîné épouse
toutes les veuves de son père défunt, excepté sa propre mère. Le frère épouse ses belles-sœurs veuves. L’adultère est puni de mort.
En cas de vol considérable (un cheval, par exemple), le voleur est coupé en deux par le milieu du corps. En cas de vol moins important, bastonnade proportionnée, ou rachat en payant neuf fois la
valeur.
Tous les animaux qu’on tue pour les manger, doivent être éventrés vifs, et avoir le cœur arraché.
Défense de se baigner, de faire aucune ablution, de rien laver dans l’eau courante. Il paraît que les Mongols se jetaient à l’eau quand il tonnait, pour se préserver de la foudre, dont ils
avaient une peur extrême. Les armées de Gengis-khan ayant perdu nombre d’hommes noyés, il leur interdit l’accès de l’eau, pour cette raison, et aussi par superstition. Car il était superstitieux
à l’excès. Il défendit sévèrement d’uriner dans les cendres, de sauter par dessus le feu, et autres actions supposées attirer la foudre.
Gengis-khan s’efforça de refréner l’ivrognerie, le vice capital des Mongols. Au moins, dit-il, ne vous enivrez que trois fois par mois. Une fois seulement, serait mieux. Ne jamais s’enivrer,
serait mieux encore ; mais cela est-il possible ?
Que Gengis-khan fut cruel, le récit de ses gestes le prouve suffisamment. Il a d’ailleurs pris soin de nous faire connaître ses sentiments. Un jour il demanda à ses officiers en quoi consistait
la félicité. Ceux-ci ayant répondu diversement ; elle consiste, dit Gengis-khan, à vaincre ses ennemis, à les chasser devant soi, à leur arracher leurs biens, à savourer leurs larmes, à outrager
leurs femmes et leurs filles. Etc.
Les camps mongols se composaient de huttes, dont le squelette était en perches, réunies au sommet autour d’un cercle de bois, couvertes de feutres cordés. La fumée sortait par l’ouverture du
cercle, l’air entrait par une portière ouvrant sur le midi. Les huttes étaient toutes rangées en rond, autour de celle du chef. — Leurs troupeaux de chameaux, bœufs, moutons, chèvres, surtout de
chevaux, fournissaient aux Mongols leur subsistance, et presque tout ce dont ils avaient besoin. Ils vivaient de viande fraîche, séchée ou boucanée ; de beurre, fromage, lait condensé par une
cuisson prolongée. Le petit-lait fermenté leur fournissait le koumys, leur boisson enivrante. Ils s’habillaient avec les peaux de leurs animaux, faisaient feutres et liens avec leur laine et leur
crin, arcs, cordes et fil avec leurs tendons et leurs boyaux, pointes de flèches et aiguilles avec leurs os, outres avec leurs peaux, vases avec leurs cornes, combustible avec leur fiente. Quand
un pâturage était épuisé, la horde abattait son camp et se transportait ailleurs, sans sortir toutefois des limites qui lui étaient assignées. Les bêtes de chaque horde étaient marquées au
fer.
Campant durant toute leur vie, cavaliers depuis leur plus tendre enfance, endurcis à toutes les fatigues et à toutes les privations, les Mongols avaient la vue, l’ouïe et l’odorat d’une finesse
analogue à celle des animaux sauvages. C’étaient des archers incomparables. Leurs chevaux, petits, laids, mais infatigables, jamais abrités, jamais nourris, manœuvraient à la voix du cavalier, ce
qui permettait à celui-ci de combattre des deux mains. Chaque homme conduisait plusieurs chevaux, pour sa remonte, les chevaux fourbus fournissant la viande de boucherie.
L’arc était l’arme de choix des Mongols, qui évitaient les combats à l’arme blanche. Leurs cavaliers étaient couverts en partie d’une tunique en cuir lamée de fer, ou portaient du moins un
plastron en cuir sur le dos. Leurs escadrons immenses et admirablement exercés, approchaient, tiraient, voltaient, revenaient, décochaient une nouvelle nuée de flèches, par devant, par derrière,
sur les flancs. Ils passaient par les sentiers de montagne les plus difficiles, et traversaient les fleuves les plus larges, le cavalier assis sur une outre contenant ses effets, attachée à la
queue de son cheval, qui nageait et remorquait son maître.
Comme tous les peuples qui se succédèrent dans le p.1648 steppe asiatique depuis les Huns, les Mongols reconnaissaient un Dieu céleste. Ils saluaient le Soleil et la Lune (p. 285). Ils avaient de
plus, dans chaque hutte, un dieu terrestre en bois ou en feutre, avec femme et enfants, suspendu à la paroi. Avant chaque repas, ils lui enduisaient la bouche de jus ou de lait... La mort était
pour eux le passage dans un autre monde, fait à peu près comme celui-ci. Aussi enterraient-ils, avec leurs morts, cheval, armes, ustensiles, etc... Ils attribuaient les maladies et les malheurs à
l’influence d’esprits malins. Afin de s’en préserver, ils leur faisaient des offrandes, passaient les personnes et les objets entre deux feux, et surtout recouraient aux sorciers. Ces artistes,
augures, devins, interprètes des songes, médecins tout ensemble, étaient consultés dans toutes les circonstances grandes et petites de la vie. Les Mongols avaient en eux une confiance
aveugle.
Encore en 1873, à l’occasion de la majorité de l’empereur (marié le 15 octobre 1872), les ministres des nations étrangères demandent à être reçus
en audience. Leur requête est accordée, et ils sont reçus, le 29 juin 1873, dans le pavillon destiné aux réceptions des ambassadeurs des peuples tributaires. Si la chose se passa sans
k'eue-t'eôu, elle ne fut pourtant pas un succès. L’effet produit sur le peuple fut plutôt mauvais. En effet, des pamphlets répandus à profusion, à l’occasion de cette réception, ridiculisèrent
les ministres.
Les ambassadeurs des nations étrangères ayant sollicité une audience impériale, voulaient entrer au palais portés en palanquin, et demandaient que l’empereur descendît de son trône pour recevoir
leurs lettres de créance en main propre. Le commissaire Wênn-siang fut si indigné de leur audace, qu’il brisa sa tasse à thé contre terre, et les rebuta sévèrement. On convint enfin que le 5 de
la sixième lune, Ils verraient l’empereur dans la salle Tzèu-koang-keue (ci-dessus). La veille, au Tsoùng-li yâ-menn, on leur fit faire une répétition des cérémonies. À cette occasion, les
ministres montrèrent un dédain hautain, rirent, badinèrent, et ne se donnèrent aucun mal. Le lendemain ils furent introduits par les hauts dignitaires du Tsoùng-li yâ-menn. Ils portaient leur
épée. Quand ils furent entrés, on ferma la porte. Ils saluèrent l’empereur, non en se prosternant, mais en inclinant seulement la tête. À côté du trône était une table, devant laquelle chacun
devait, à son tour, lire sa lettre de créance. Le ministre d’Angleterre commença. À peine eut-il lu quelques mots, qu’il fut pris d’un tremblement qui l’empêcha de continuer. Vainement l’empereur
le questionna avec bonté, pas de réponse. Les autres vinrent à leur tour. Ils furent tous saisis d’une telle terreur, qu’ils laissèrent tomber leurs lettres, et ne purent ni lire ni parler. Le
prince Koūng ordonna alors aux gens du palais de les prendre sous les bras, pour les aider à descendre les marches. Leur effroi était tel, que, incapables de se tenir debout, ils s’assirent par
terre, couverts de sueur, pour reprendre haleine. Ils n’osèrent pas accepter le festin qu’on leur avait préparé, et s’enfuirent au plus vite dans leurs logis. Le prince Koūng leur dit :
— Ne vous avais-je pas averti que voir l’empereur n’est pas une petite chose ? Vous ne vouliez pas me croire. Maintenant vous savez ce qui en est...
Et pourtant la réception s’était faite avec le plus petit appareil. Les ministres ont avoué, que c’est une vertu transcendante, émanée de l’empereur, qui les a terrifiés... Les voilà bien, ces
hommes vains, fanfarons de loin, poltrons de près !... Sic.
Encore en 1873, grâce surtout aux efforts de M. H. Parkes, suppression de la Traite des Jaunes, exportation de coolies chinois au Pérou, à Cuba, et ailleurs. Elle avait commencé vers 1848. Un
demi-million de coolies environ avait été exporté en 25 ans. Macao était le principal marché de ce commerce abominable, qu’on avait vainement essayé de réglementer en 1859 et en 1866.
Les engagements de coolies étaient pour la plupart du temps loin d’être volontaires. Enlèvement brutal, promesses fallacieuses, violence morale, tout était mis en jeu. À peine embarqués,
exaspérés par des traitements barbares, les coolies se révoltaient parfois. Il se passa sur le Pacifique des tragédies, qui rappellent celles des négriers de l’Atlantique. Trente-quatre navires
européens, dont six français, souillèrent leur pavillon dans ce trafic infâme. Le sort des coolies, dans les colonies, était en tout semblable à celui des esclaves noirs. Les procédés des
Espagnols, à Cuba, furent spécialement révoltants. Des enquêtes officielles ont établi que, de 1854 à 1873, 140 mille coolies chinois furent importés à Cuba. De ces malheureux, en 1874, 68.825
restaient en vie. Seize mille étaient mort en mer, durant la traversée ; 2.179 étaient revenus ; 53.096 étaient morts ou avaient été supprimés. Sur les 140 mille, 99.146 avaient été exportés de
Macao. Il paraît que la suppression de la traite ruina cette ville, elle en vivait donc ? propre !... Les Japonais mirent les premiers la main à l’œuvre, saisirent les navires des traitants, et
renvoyèrent les coolies en Chine. Puis l’Angleterre ferma le port de Hong-Kong aux navires faisant la traite. Enfin le Portugal se décida à interdire la traite à Macao, 27 décembre 1873.

















