Louis Laloy (1874-1944)
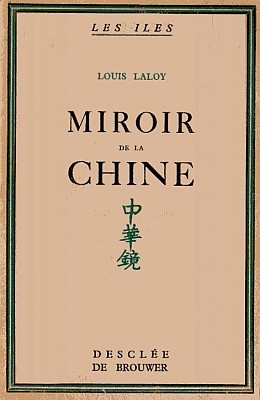
MIROIR DE LA CHINE
Présages, images, mirages
Éditions Desclée de Brouwer & Cie, Paris, 1933, 340 pages.
- Soirée à Changhaï : "Nous ne finissions pas d’arriver à Changhaï, remontant le fleuve limoneux dont une rive se perd dans la blancheur de l’horizon ; l’autre, à peu de distance, protège ses rizières vert d’eau par l’ombre grise de saules pareils à ceux du Doubs, près de mon village. Tous les passagers sur le pont, parés pour débarquer, ne sachant plus que faire, et de mauvaise humeur à cause de la déclaration pour la douane, que le premier maître d’hôtel les avait obligés non sans peine à remplir : cette prétention, récente encore, de la Chine à contrôler les bagages introduits sur son territoire, ainsi qu’on le fait depuis longtemps partout ailleurs, les offensait comme un outrage à leur dignité d’Européens, au-dessus des lois de l’Asie. « Cela ne peut durer », disaient les uns. Et les autres : « Ce n’est pas ainsi qu’ils empêcheront la contrebande »."
- Nankin, capitale politique : "Le nom chinois de Nankin signifie la capitale du Sud, et fut choisi par le premier empereur de la dynastie des Mîng, qui vint s’y établir en 1368. Les Mongols qu’il venait d’abattre régnaient dans Pékin, capitale du Nord. Le Nord s’oppose au Sud, comme la terre au ciel. Il fallait consacrer au ciel une dynastie qui par son titre de Mîng invoquait l’éclat du jour. Pékin n’étant plus capitale prenait le nom plus modeste de Pei-p’îng, la paix du Nord, mais redevenait Pékin dès le début du siècle suivant, l’empire ayant alors deux capitales. Les Mandchoux, qui s’emparèrent du trône impérial en 1644, choisirent celle du nord, plus rapprochée de leur pays. La république qui leur a succédé en 1911 ne voulut pas d’abord quitter Pékin, afin d’éviter la dépense et aussi par déférence pour les diplomates étrangers. Mais depuis 1928 Nankin est redevenue la capitale politique de la Chine, dont Pékin reprenant le nom de Pei-p’îng sera plutôt la capitale intellectuelle, ville de monuments, de musées et d’universités."
-
Campagne : "Il n’était pas commode hier soir, le grand fleuve qu’il fallait franchir pour trouver, sur l’autre
rive, la gare et l’express de Pékin. J’ai pensé y avoir perdu mon porte-cigarettes en passant d’une embarcation à l’autre, et le regret de ce petit serviteur venu de si loin pour se noyer
dans les flots livides m’a empêché de goûter la sécurité du wagon, jusqu’au moment où il a reparu, s’étant trompé de poche dans l’émotion du départ et de la traversée.
Les bas quartiers étaient encore inondés. Sur les passerelles de planches remplaçant les trottoirs, les passants en file ininterrompue s’emboîtaient le pas l’un à l’autre. Quand la voiture a roulé dans l’eau jusqu’au moyeu, il a fallu accepter les services des bateliers qui s’approchaient, passer dans leur barque à fond plat, descendre ainsi la rue jusqu’au quai submergé. Des gamins, la tête hors de l’eau, s’amusaient comme au bain à s’éclabousser. Un fils respectueux portait à califourchon sur ses épaules une vieille dame impassible, jambes tendues. Des ménagères revenaient du marché, en serrant leurs paquets comme des enfants sur leurs poitrines. On se fait place en pataugeant, on s’interpelle avec des voix joviales. Le bon peuple de Chine, comme celui de France, trouve toujours le mot pour rire."
Extraits : Sans sourire - Rues de Pei-p'îng - Fête de famille - Soirée artistique - Noces
Feuilleter
Télécharger/Lire aussi
Le premier des vingt-quatre historiens officiels de la Chine, grand annaliste de la cour
impériale sur la fin du deuxième siècle avant l’ère chrétienne, rapporte le malheur du roi Yeou, de la dynastie des Tcheou. En la troisième année de son règne, qui est l’année 778 avant la
naissance du Christ, il s’éprenait d’une favorite, appelée Pao-sseu, au point de dégrader l’impératrice et l’héritier présomptif, pour conférer ces titres à Pao-sseu et à l’enfant qu’elle venait
de lui donner. Son grand annaliste, consultant les anciennes archives, prononça : « C’en est fait de la dynastie ! »
Les archives étaient bien tenues à cette époque. Elles permettaient d’affirmer que deux dragons s’étaient montrés dans la salle d’audience au palais impérial, après la mort de Hia-heou qui avait
fondé, vers le vingtième siècle avant l’ère chrétienne, la première des dynasties héréditaires. « Nous sommes, disaient-ils, les princes de Pao. » Ce pays dont le nom a subsisté jusqu’à nos jours
se trouve dans la province moderne du Chan-si qui formait alors la limite occidentale de l’empire. L’empereur consulta les sorts : fallait-il tuer les dragons, les chasser, les garder ? Dans les
trois cas, la réponse fut sinistre. Il demanda s’il devait recueillir leur écume et la réponse fut favorable. Les dragons informés par une affiche sur le mur disparurent après qu’on eut pris leur
écume, enfermée en un coffret qui se transmit à la dynastie suivante, celle des Yin, puis à celle des Tcheou, fondée au douzième siècle avant notre ère. Mais sur la fin du règne du roi Li, dans
les dernières années du neuvième siècle, quelqu’un par curiosité s’avisa de l’ouvrir. L’écume se répandit sur le pavé de la salle, d’où on ne put la retirer. L’empereur alarmé eut recours à une
conjuration magique. L’écume du dragon, c’est l’émanation de son esprit vital. Elle est chargée du principe mâle ou positif, et sera attirée par le principe contraire. C’est pourquoi les femmes
furent appelées pour se dévêtir et jeter ensemble de grands cris. L’écume alors se changea en un lézard qui courut aux appartements intérieurs. Une petite fille de sept ans se trouva sur son
passage. Elle devint femme et eut un enfant. Mais prise de peur, elle l’abandonna dans la campagne. Le roi Siuan, qui avait succédé à son père cette même année, apprit un jour que des petites
filles chantaient une ronde sur ces paroles :
« Arc en mûrier sauvage, carquois de vannerie, perte de la dynastie ». C’était alors une croyance, destinée à durer longtemps encore, que les chansons enfantines sous leur absurdité apparente
recelaient de graves présages. On découvrit un pauvre homme et sa femme qui faisaient commerce d’arcs en mûrier sauvage et de carquois en vannerie. Ordre fut donné de les mettre à mort, mais ils
réussirent à prendre la fuite.
Au bord du chemin, dans la nuit, ils entendirent des vagissements. C’était une fillette de quelques jours. Ces braves gens par pitié l’emportèrent avec eux et coururent d’un trait jusqu’au pays
de Pao, où elle trouva des parents d’adoption. C’était l’enfant abandonnée par la petite fille du palais. En grandissant, elle prenait une rare beauté.
Les gens de Pao ayant eu quelques difficultés avec l’autorité impériale résolurent, pour racheter leur faute, d’offrir la jeune fille en présent au palais. C’est ainsi que le roi Yeou fit d’elle
sa favorite sous le nom de Pao-sseu.
Les présents dont elle était comblée, les faveurs qui lui étaient prodiguées, elle acceptait tout, mais restait impassible et sérieuse. L’empereur ne sachant qu’inventer pour lui arracher un
sourire s’avisa un jour de faire allumer les grands feux de crottes de loup dont la flamme pendant la nuit, et la fumée en plein jour, servaient de signal d’alarme pour convoquer le ban et
l’arrière-ban des vassaux. Ils accoururent, et on leur expliqua que c’était une erreur. Cette fois Pao-sseu rit aux éclats de leur déconvenue. L’empereur eut la faiblesse de recommencer, deux
autres fois encore, pour lui plaire, cette mauvaise plaisanterie.
Mais l’impératrice légitime qu’il avait dépossédée était allée chercher du secours au delà des frontières occidentales, chez les tribus sauvages qui ont le chien pour totem ou animal ancestral.
C’étaient de redoutables archers. L’empire fut envahi. L’empereur fit allumer les feux d’appel, mais personne ne vint car on n’y croyait plus. Il fut tué, son palais dévasté, et la belle Pao-sseu
emmenée en captivité chez les hommes-chiens.
J’ai relu cette histoire à cause d’un portrait que j’ai vu hier au musée. Comparé à une antiquité aussi haute, il date d’hier : la princesse Cha Hiàng-fei est morte en 1758. Il était aisé de
reconnaître l’époque à la vivacité du coloris et au dessin précis, d’une grâce un peu maniérée qui semble avoir pris ses leçons à la cour de Louis XV. Ce n’est pas vrai au sens matériel, mais
chaque siècle est une saison dont l’influence est répandue sur plus d’un climat. Le moyen âge en Chine comme en France a eu ses remparts à créneaux et ses romans de chevalerie ; celui des Trois
royaumes est resté populaire, pour ses traits admirables d’héroïsme et de fidélité. Au XVIIIe siècle, depuis l’Europe jusqu’à l’Asie orientale, on respire le même air de galanterie.
Cependant l’arc et le carquois n’étaient pas là, comme sur une toile de Lancret ou de Boucher, les attributs d’une fiction mythologique. Ils s’accordaient à la fierté du fin visage rejeté en
arrière sur la taille cambrée, au défi du regard en éclair sous les paupières aux longs cils, et sans doute avait-elle dans les veines, elle aussi, l’écume du dragon, cette jeune femme dont les
lèvres étroitement closes ignorent le sourire.
Sous son nom posthume de K’ien-loung, les amateurs de porcelaines connaissent l’empereur Kao-tsoung, dont le règne fut égal en durée comme en gloire à celui de Cheng-tsou ou K’ang-hi,
contemporain de Louis XIV. À l’exemple de son aïeul, il était malgré l’origine étrangère de leur dynastie profondément imbu de la tradition chinoise dont il se fit en ses édits l’éloquent
défenseur. Poète abondant et facile, c’était un habile écrivain au sens que garde ce mot en un pays où l’écriture est un art. Dans la même salle, des banderoles où sa main auguste a tracé des
sentences de morale attestent par la fougue du trait à la pointe effilée, aux noires épaisseurs, un vigoureux talent.
C’était aussi un grand conquérant qui étendit de beaucoup les frontières de l’empire vers l’Asie centrale. C’est ainsi qu’il fut amené, en la vingtième année de son règne, à envoyer une colonne
contre un prince du Turkestan. Mais les précautions étaient mal prises, les effectifs insuffisants ; la colonne fut massacrée. Plus d’une grande puissance a éprouvé pareils mécomptes en ses
expéditions lointaines. La Chine était une grande puissance ; elle s’obstina, et par une stratégie plus habile remporta une victoire complète. Le prince put s’enfuir avec les débris de son armée.
La princesse qui était restée vaillamment dans le château, faite prisonnière, fut amenée à la cour de Pékin, où était parvenu avant elle son renom de beauté. L’empereur lui trouva plus de charmes
encore qu’il ne pensait. C’est lui qui l’appela Hiàng-fei, la dame parfumée. Il paraît en effet que cette fleur sauvage exhalait une odeur délicieuse.
Mais fidèle à son pays et à ses souvenirs, elle demeurait dans les splendeurs de la cour indomptable et farouche, ne daignant même pas se lever à son approche. Il lui parlait avec douceur,
s’excusait du mal qu’il avait fait à son pays sur la nécessité de la politique, sans jamais obtenir un seul mot en réponse. Il pouvait aisément la contraindre, mais ne voulait rien obtenir que de
son sentiment. Ainsi l’impérial amant implorait une captive rebelle en une scène que l’on croirait empruntée à quelque tragédie de Voltaire si elle ne se trouvait dans le drame chinois qui a pour
sujet cette histoire, et pour auteur, dit-on, un général de l’ancien régime rallié à la république.
Les autres femmes du palais ne comprenaient pas le refus d’une faveur dont elles étaient jalouses. Comme elles lui conseillaient d’en prendre son parti, l’étrangère s’emporta jusqu’à tirer de son
sein un stylet dont elle les menaça. L’impératrice douairière prit peur alors pour les jours de son fils, et profita d’une nuit où il restait à la chasse pour faire présent de la mort, selon
l’expression courtoise, à la dame parfumée.
La plupart de mes amis me plaignent d’habiter un quartier perdu. J’ai une automobile à ma
disposition mais préfère, quand la distance n’est pas trop grande, faire appeler un de ces véhicules à deux roues, traînés par un homme, que les Français appellent des « pousses », les Anglais
des «rickshaws» et les Chinois des « voitures étrangères » yâng tch’oe, parce qu’elles sont venues du Japon, il y a une cinquantaine d’années. On compte environ quatre-vingt mille
tireurs de pousse à Pei-p’îng. Comme nos marchands des quatre saisons, ils louent à des entrepreneurs leur instrument de travail. Sauf les heureux qui entrent au service d’une maison
particulière, ils gagnent de quoi ne pas mourir de faim. Sans famille pour la plupart, dans la rue tout le jour, sans autre vêtement que leur culotte courte et leur veste de cotonnade, il en est
beaucoup qui n’ont d’autre domicile, la nuit, que le garage de leur voiture. En hiver, la clientèle se fait plus rare, à cause du froid dont on ne peut se garantir en ces paniers sur roues, et
comme ils y sont plus exposés encore entre les brancards la tuberculose et la pneumonie les déciment. Il est rare qu’on dépasse la quarantaine en ce métier. D’autres prennent les places vides,
maintenant au même chiffre l’effectif de cette population misérable et inoffensive. Il faut débattre le prix qui varie, selon la longueur de la course, entre soixante centimes et trois francs de
notre monnaie. L’accord fait, jamais une contestation ne s’élève, ni un supplément n’est demandé à l’arrivée. Les agents n’ont pas à intervenir.
Ils sont nombreux et vigilants, postés à tous les carrefours des avenues spacieuses et fort bien entretenues qui traversent la ville, du nord au sud et de l’est à l’ouest, de part en part, et
pareils, avec leurs bras gantés de blanc qui indiquent la voie libre, à des sémaphores en uniforme. Ils n’ont à dresser d’ordinaire que de minimes contraventions, pour croisement fautif ou
stationnement interdit. Dans les quartiers populeux où se presse, sur les trottoirs de terre battue, une foule ouvrière, jamais je n’ai vu un ivrogne, ni assisté à une rixe, ni même à une
altercation violente. Pourtant on parlait fort, dans les groupes ; on plaisantait ; on discutait aussi, parfois on échangeait de gros mots qui faisaient rire l’assistance, et la querelle en
restait là.
Un soir que j’avais hélé un tireur de pousse pour dîner chez un ami, non loin de là, comme je lui donnais le nom de la rue, il me répondit : « Laquelle ? » Pei-p’îng ressemble à Londres en ceci
qu’on y trouve, en des quartiers différents, des appellations identiques. Je ne pouvais le renseigner, et dus me fier à son instinct. Nous roulions de rue en rue ; les voitures devenaient de plus
en plus rares, et les maisons plus basses. Je l’arrêtai. Un rassemblement de bonne volonté nous entoura aussitôt. Je me souvins que la maison était voisine de la Faculté de droit. Mais personne
ne connaissait la Faculté de droit. Il fallut se remettre en route, et bientôt j’entendis le sifflet d’un train. Nous approchions de l’une des voies ferrées qui contournent la ville. Nous étions
donc irrémédiablement perdus. La rue n’était qu’une route inégale, crevée d’ornières et bordée de masures. Par conscience, mais sans conviction, il finit par faire halte devant l’une d’elles qui
portait bien le numéro requis, et m’interrogea du regard. Une lueur rougeâtre filtrait au bas de la porte, et les pulsations d’un tambourin sauvage traversaient le plâtras des murs. J’hésitais à
descendre, mais il ne fallait pas offenser mon conducteur. Un passant me tira d’embarras en nous apprenant que c’était là le quartier des tanneurs. L’un d’eux sans doute battait des peaux de
bêtes en cet antre de sorcières. Il n’y avait plus qu’à refaire en sens inverse le chemin parcouru. Avec joie je reconnus mon logis. Le chauffeur devant la porte attendait mes instructions. Comme
il m’avait déjà conduit en cet endroit, il jeta un regard de mépris à son humble rival, qui fit des façons pour accepter le prix de la double course, se déclarant coupable de l’erreur
commise.
Un autre jour, au matin, un robuste coureur m’entraînait allègrement par l’avenue qui longe au sud l’enceinte interdite, quand j’aperçus devant nous un cortège de jeunes gens en robes noires, de
jeunes filles en jupes bleues, portant haut des bannières blanches, comme une procession de fête sous le clair soleil. Mais la démarche était plus vive ; sur les bannières, en approchant, je
lisais des devises vouant à l’exécration l’impérialisme des Japonais, et aussi l’injustice des étrangers ; de minute en minute, la troupe entière avec ensemble proférait des cris de guerre,
pendant que les tramways sonnaient, les voitures se détournaient, les passants s’arrêtaient un moment, sans paraître autrement surpris d’un spectacle qui sans doute leur était familier. Le sort
qui m’a fait naître à l’autre bout du continent m’a donné des traits où aucun Asiatique ne saurait se méprendre. Mon tireur court si vite que nous aurons bientôt rejoint les manifestants. Pour
rien au monde je ne voudrais lui demander de ralentir ni de changer de route, et nous voilà, longeant les rangs en marche, à les toucher parce qu’il faut laisser libre passage aux voitures. Tous
me jettent au passage un regard scrutateur, mais pas un, parmi tant de jeunes exaltés, n’a un geste de menace, ni même un mot désobligeant pour cet Européen avéré. J’arrive à la tête du défilé
quand il tourne à gauche en bon ordre pour s’engager sur un pont de marbre et disparaître, englouti par la voûte obscure de la porte centrale, gardienne immuable, majestueuse et revêche sous la
pesante coiffure de ses deux toits crochus. La vieille Chine accueille ses enfants.
Hors des avenues, les rues se croisent en réseau rectangulaire, juste assez large pour deux voitures. Mais dans les quartiers du commerce, la foule répandue sur la chaussée oblige à de telles
précautions qu’on va plus vite en pousse et même à pied. Tous ceux qui ont conduit une auto en Chine savent que le passant ne se gare qu’au dernier moment. Ce n’est pas qu’il ait moins de nerfs
que l’Européen, mais il a plus de dignité, et compte davantage sur des égards réciproques. Il les obtient toujours de ses compatriotes, aussi habiles que prudents, et les accidents sont très
rares, même en cette populeuse capitale. Cependant un de mes amis, qui se hâtait en bicyclette à son bureau de l’Académie, en a causé un ce matin, et me le raconte plus ému que s’il en avait été
victime :
— C’était un vieux bonhomme, qui ne m’entendait pas ou pensait à autre chose. Le voilà étendu par terre qui se met à gémir : Ma jambe, ma pauvre jambe ! Il y a trois mois elle était cassée. À
peine guérie, il va falloir la réparer encore ! Je le relève, il tremble, mais se tient debout, essaie de faire un pas : sa jambe était intacte. Je lui offre un peu d’argent qu’il refuse : Vous
ne me devez rien, puisqu’il n’y a pas de mal. Et il est parti, se retournant encore pour me dire : Soyez sans inquiétude.
Dans tous les pays du monde, le commerce de détail cherche à plaire au client par l’attrait des étalages. Ici, de même, une vitrine mêle agréablement les souliers de soie sur semelles de feutre
blanc aux bottines de cuir brillant, à la mode d’Europe ou d’Amérique ; une autre a composé un édifice d’abat-jour multicolores ; ailleurs ce sont des robes délicatement nuancées, ou des
appareils de photographie exposés entre un choix de portraits et de paysages, ou des chapeaux de feutre en compagnie de calottes chinoises et de bonnets de fourrure. Partout l’entrée est libre.
On peut faire le tour du magasin, examiner de près un objet, puis un autre, s’y attarder comme dans un musée. Le commis en silence attend qu’on l’interroge et salue, aussi poliment qu’à son
entrée, le visiteur qui s’en va les mains vides. Le marchand est un hôte qui reçoit dans sa maison. C’est pourquoi, non content de lui donner bonne apparence, il la pavoise au dehors d’enseignes
et d’oriflammes, qui sont comme un habit de fête.
Si pourtant il n’attend que des invités de bonne compagnie, il dédaigne cette parure et promet au contraire une intimité que ne troubleront pas les importuns. Dans cette rue sans étalages, il
suffit de quelques mots au jambage d’une porte pour renseigner le connaisseur. C’est là que sont groupés les marchands d’objets en jade. Ce silicate de chaux et de magnésie, qu’il ne faut pas
confondre avec la jadéite, silicate de soude et d’alumine, ne se rencontre qu’en gisements disséminés parmi les montagnes du Turkestan chinois, ou sous la forme de cailloux roulés dans les
torrents qui en descendent. C’était jadis un tribut réservé à l’empereur qui en décorait ses officiers, gardant pour lui le jade blanc, préféré de beaucoup jusqu’à nos jours, pour son doux éclat,
au jade noir, veiné, ou vert. Une seule qualité se vend plus cher encore : c’est le jade jaune, qui doit cette nuance à un long séjour sous terre et porte ainsi la marque indélébile de son
antiquité.
Le jade, selon les anciens rituels, est l’emblème de toutes les vertus parce qu’il est diffus comme l’humanité, serré comme la connaissance, net sans tranchant comme la justice, précieux comme la
sagesse. C’est ici, dans la calme clarté d’une salle que les stores baissés protègent contre l’indiscrétion de la rue, qu’il faut contempler à loisir, sur les gradins des étagères, une pendeloque
découpée à jour, un vase que supporte un phénix héraldique, une tasse qui laisse filtrer un reflet lunaire. Le regard n’est pas seul à y trouver sa joie. Il est permis de s’approcher. On soupèse
l’objet, on éprouve la finesse du trait, la fermeté du grain et la douceur de l’épiderme, car le jade a un corps.
Les luthiers sont plus loin, plus retirés encore, sans autre indication que leur nom sur la porte, en d’étroites boutiques où les grosses guitares sont pendues au plafond et se touchent de
l’abdomen. Les ouvriers quittent leur travail, dans l’atelier voisin, et viennent avec leur tablier poudré de fins copeaux pour voir cet étranger qui parle d’un vieux luth. Pour garnir
l’instrument qu’on m’a offert à Nankin il faut que je m’adresse à trois corps de métier, dont l’un fournit la corde, l’autre la torsade de soie pour l’accrocher, et le troisième le petit étui de
bois, solidaire avec celle-ci, qui en tournant produit la tension, retenu par le frottement de sa face plate contre le dessous de la table. Je ne m’en tirerais pas sans peine, si je n’avais pour
guide un ami obligeant, que tous les arts intéressent. Né dans une des premières familles de la capitale, d’un père qui fut ministre sous l’ancien régime, il doit à son origine et à son éducation
première un goût que ses études, achevées en France, ont cultivé encore.
Nous revenons par la rue des libraires, qui est la plus animée de toutes. Étudiants et étudiantes flânent aux devantures où sont ouvertes des éditions rares, et d’autres annoncées par une affiche
sur la vitre, mais s’écartent pour faire place au vieux lettré qui descend d’un pousse et qu’on voit accueillir, à l’intérieur, par des salutations profondes. Quelques jours plus tôt, j’étais
allé seul en un de ces magasins pour rectifier une commande. C’était ma seconde visite, mais le libraire ne m’avait pas reconnu. Ce qui ne l’a pas empêché de m’offrir aussitôt une tasse de thé,
dans la salle du fond, réservée aux ouvrages de prix. Couchés sur les rayons, du plancher au plafond, ils garnissent les murs. Craignant d’avoir fait erreur moi-même, j’alimentais la conversation
en lisant à haute voix les titres, recevant en récompense des compliments pour mon savoir, et nous pouvions rester ainsi jusqu’à la fin du jour, si un autre rendez-vous ne m’eût pressé. Je
risquai une allusion à la collection qui devait m’être envoyée, mon hôte tressaillit, et me pria d’excuser ses mauvais yeux.
Dans un atelier ouvert, trois ou quatre ouvriers, courbés sur des dalles de pierre inclinées comme de longs pupitres, les couvrent d’inscriptions fines, à la pointe du ciseau. Le plus âgé se
dresse et décerne un salut particulier à mon compagnon. C’est lui qui a gravé l’épitaphe de son père et il s’en souvient, à cinq ans de distance, comme d’un de ses plus beaux ouvrages.
Dans les quartiers aristocratiques, la rue est enfermée entre les murs que dépasse le feuillage. De distance en distance, sous un auvent de tuiles vernissées, une porte carrée à deux battants,
d’un rouge vif, est close. Il faut se reconnaître parmi les numéros qui souvent ne sont pas en ordre ; si l’on fait erreur, les voisins d’ordinaire s’ignorent et ne donnent aucune indication. Le
visiteur admis trouve devant lui un vestibule clos, d’où on passe dans le jardin par des ouvertures latérales, et de là au bâtiment qui fait face à l’entrée et où s’ouvrent les appartements de
réception. D’autres pavillons, épars sous les ombrages et reliés entre eux par des galeries couvertes, servent à l’habitation ou à l’étude. Ainsi chaque famille à l’abri de son enceinte dispose à
son gré de l’espace et forme une cité dans la cité.
On reconnaît qu’un dîner se donne à la file des voitures arrêtées et vides. L’usage hospitalier de la Chine réunit à l’office, pour un repas non moins nombreux que celui des maîtres, les valets
de pied et les chauffeurs. Au retour, dans la nuit, on entend le silence au bruissement des feuillages. Les maisons dorment, invisibles, et personne, même en rêve, n’y soupçonne mon existence. Je
l’oublie moi-même et me dissous dans cet univers qui m’ignore comme une goutte d’eau dans la mer.
Les voitures se poussent l’une l’autre, dans la rue étroite encombrée de foule et obstruée
d’enseignes en longues banderoles, devant un seuil lumineux. Les badauds font cercle et contemplent les élégantes en manteaux chamarrés qui effleurent de leurs mules brodées la boue noire,
soutenues par leurs maris ou leurs frères engoncés de fourrures. Cette maison est le club des marchands de tissus. Un riche banquier y fête le quatre-vingtième anniversaire de son père par une
représentation théâtrale. Il s’est assuré le concours des meilleurs artistes de la Chine et même, pour terminer la soirée, celui de Meî Lân-fâng qui m’a fait parvenir une invitation.
M. Tch’ên-louh m’accompagne, bien qu’il ait horreur de la foule ; ce soir il accomplit pour moi un sacrifice plus grand encore que je ne pensais, car au moment de descendre je veux qu’il prenne
les devants puisque je ne connais personne en cette société, et il me répond, hochant sa tête fine et clignant des yeux sous les lunettes d’or : « Ni moi non plus ».
Nous contournons de compagnie, en trébuchant un peu, car nous sommes myopes l’un et l’autre, le mur en écran qui dans toutes les maisons chinoises barre la route aux mauvais esprits. Au fond de
la cour, sous l’auvent qui donne accès à la salle, nous avisons un homme de haute mine, au menton dur, en robe confortable, et lui disons nos noms. C’est en effet le financier qui donne la fête,
ou l’un de ses parents proches, car il nous indique une table où aussitôt les serviteurs s’empressent à nous verser le thé, en attendant qu’on nous trouve une place. Le spectacle est déjà
commencé, et nous voyons aux derniers rangs les retardataires qui restent debout, en masse compacte.
Il nous faut fendre cette foule, guidés par un jeune homme qui porte une fleur de papier rouge au revers de son veston ; c’est l’insigne qui distingue les membres de la famille, le rouge étant la
couleur de la joie. La salle est tendue de soie rouge où sont inscrites, en lettres d’or, des adresses de félicitations, des vœux de longue vie. Le programme qui nous est donné porte aussi, en or
sur fond rouge, les noms des acteurs et les titres des pièces. Dans la galerie du premier étage où l’on se serre pour nous faire place sur un banc j’ai devant moi une compagnie de fillettes, qui
parfois quittent des yeux la scène pour consulter leur miroir, vérifier l’alignement sur le front de leurs cheveux lustrés, ou se taquiner l’une l’autre en se poussant du coude, parfois même
échanger leurs places, par caprice amical ; elles ont la fleur rouge, elles aussi, épinglée près du col de leur robe montante. Dans les loges qui s’ouvrent de chaque côté on aperçoit des familles
avec leurs enfants, qui montrent du doigt les acteurs et demandent qu’on leur explique la pièce. Du thé et des gâteaux circulent. Au parterre personne ne bouge : c’est la réunion des amateurs. De
temps à autre seulement, un bras se lève. Un domestique posté le long du mur jette un paquet blanc, attrapé au vol : c’est une serviette imbibée d’eau chaude, pour essuyer les mains et le visage,
bientôt renvoyée de la même manière.
Trois acteurs sont en scène ; la mère, la fille et son gendre. Ce sont trois acteurs, parce que depuis deux siècles le théâtre chinois n’admet plus le mélange des sexes. De nos jours seulement
quelques actrices de profession se montrent, ont du succès ; mais la tradition se défend, et durera longtemps encore.
La mère est une de ces bonnes bourgeoises, rondes et joviales, comme on en rencontre tant dans les rues commerçantes, marchandant aux étalages d’épicerie ou de mercerie. La fille minaude avec
grâce. Le gendre porte le bonnet des fonctionnaires au temps des Mîng et une barbe noire en minces filaments : c’est un jeune lettré. Ils font mauvais ménage. La vieille dame s’efforce de les
réconcilier pour la nuit. Ils cèdent, mais nous ne verrons pas dresser pour eux un lit de vaudeville. Le théâtre chinois, très chaste, interdit au comédien de se coucher à la vue du public ; il
reste assis, le menton sur la main fermée si c’est un homme, ouverte pour les femmes. Chacun comprend ce langage figuré. C’est ainsi que le couple s’installe, de part et d’autre de la table.
Sitôt que l’un semble dormir, l’autre le regarde sans bienveillance et se plaint à mi-voix de son sort. Paix trompeuse et menaçante. Le mari le premier se lève, pour vaquer à ses affaires. Ses
mains croisées et décroisées signifient qu’il ouvre la porte, son pas plus lourd qu’il descend l’escalier. Mais de son portefeuille il a laissé échapper une lettre, dont sa femme s’empare. Elle
hésite d’abord à y jeter les yeux, mais la curiosité l’emporte. Son visage s’éclaire de joie maligne : c’est une lettre compromettante. Du bruit dehors. Elle se replace dans le lit fictif, feint
de dormir. Le mari monte en hâte l’escalier. Le voici qui cherche à terre, sous la table, dans la tige de sa botte, sous la robe de sa femme, inquiet, bientôt tremblant de peur. Scène muette, que
l’orchestre groupé de côté accompagne de ses cymbales à coups pressés. La salle entière a fait silence, car le moment est pathétique, le geste éloquent. De plusieurs points des hào approbateurs
éclatent : « Bien ! » C’est la manière chinoise, qui certes vaut la nôtre, de crier : « Bravo ! » On applaudit ensuite, comme la pluie après la foudre, mais l’ondée est courte, pour ne pas
arrêter le mouvement dramatique.
Ces manifestations ne se produisent jamais à la fin de la pièce, signalée seulement par la sortie des personnages et l’entrée des accessoiristes qui viennent déplacer la table et les chaises. Ce
n’est pas que ces ouvrages soient sans valeur, mais au contraire que la valeur n’en est plus discutée. Le théâtre chinois est un théâtre de répertoire. Les auteurs modernes eux-mêmes se bornent
le plus souvent à l’adaptation d’un drame ancien ou empruntent l’intrigue, sans presque y rien changer, à l’histoire ou au roman.
Un drame héroïque fait admirer ensuite de superbes tournois où les guerriers se défient, se poursuivent, s’affrontent en cadence, mais sans air de musique, portés seulement par les chocs alternés
de la cymbale grave et de la crécelle stridente, tenus comme en suspens et renvoyés de l’une à l’autre, dans l’angoisse de leur destin. On nous repose avec une scène de comédie où l’on voit
l’étudiant pauvre, relégué au grenier par un important aubergiste qui change de ton à la nouvelle que son client, reçu premier au concours, va devenir un puissant magistrat. L’acteur a beaucoup
de verve et ne craint pas de moderniser son texte : « Non, mais pour deux sous tu te crois peut-être à l’hôtel des wagons-lits ? »
Il est deux heures du matin quand une rangée de lampes électriques à coquilles de cuivre s’allume devant la scène, en même temps que l’orchestre disparaît dans la coulisse. Un murmure joyeux
parcourt l’auditoire : Meî Lân-fâng va venir. Le célèbre artiste n’est pas seulement interprète, mais aussi, comme Molière, directeur de théâtre. Il amène ses compagnons, et aussi les innovations
qu’il a introduites dans la mise en scène, sans altérer en rien la tradition du genre.
Sous la coiffe fleurie et le manteau étincelant, cette jeune fille qui chante tristement, est-ce donc lui? Sans doute, décomposant les traits du visage, j’y retrouve, étant prévenu, le contour du
menton, l’éclat des yeux, l’enjouement du sourire. Mais d’où lui est venue cette voix cristalline qui vole de note en note, se pose, frémit, s’élance et mollement retombe, avec des trilles et des
battements ailés ? Et cette parole où subsiste un chant vague comme un souvenir, si nette cependant que même un étranger comme moi ne perd pas une syllabe ? Surtout cette ondulation de la taille
flexible, jusqu’à la tête penchante qui bouge à peine, assez cependant pour trahir, comme l’oscillation lente de l’arbre sous la brise imperceptible, la palpitation intérieure ?
C’est une femme du palais, une de celles dont la foule inutile peuple quelque séjour du bonheur. Un tyran s’est emparé du trône. Elle a pris le vêtement et la parure d’une princesse impériale
qu’il a fallu lui promettre en mariage. Par cette ruse elle s’approchera de lui et en fera justice. Elle a peur mais n’hésitera pas. Il apparaît, gonflant la cuirasse de son torse robuste,
férocement barbu, le regard flamboyant d’ivresse et de convoitise. C’est un comédien célèbre en cet emploi, et à juste titre, car M. Wang Poh-chen a le geste et l’accent d’une vigueur splendide.
Coquette, elle s’approche, lui offre à boire encore, et bientôt, confuse, lui demande de renvoyer les servantes. Cette cuirasse, il faut qu’il l’ôte en un jour de bonheur ; elle veut la lui
retirer elle-même. Il se prête à ce qu’il croit une tendre sollicitude et s’affale derrière les rideaux de l’alcôve, où il l’appelle. «J’enlève, lui dit-elle, mes épingles à cheveux, ma tunique,
mes souliers, ma jupe. » Mais elle a tiré de sous ses vêtements une dague et la contemple, tremblant de tous ses membres. Il ne répond plus ; il dort. Le moment est venu.
Cette suite de sentiments vrais ou feints tour à tour est traduite par des mouvements où chaque détail a un sens et prend exactement sa place, comme le mot dans la phrase. Rien n’est laissé au
hasard de l’improvisation ; une composition rigoureuse produit une image achevée, en traits qui mordent et se gravent dans l’esprit. Ce n’est pas une femme entre les femmes que nous avons devant
les yeux.
C’est la beauté de la femme, sa douceur, sa faiblesse, son courage, sa ruse, ses mensonges, son héroïsme. Les accents et les gestes sont jetés sans retouche ni bavure, d’une décision souveraine
et d’une sûreté infaillible, comme en un dessin de maître ou mieux encore en une de ces inscriptions chinoises où le pinceau du calligraphe a laissé dans les pleins et les déliés, les élans et
les retours, les courbes et les angles, la trace indélébile de l’émotion génératrice. C’est une grâce écrite, dont l’écrivain est un grand artiste.
Dans la cour que les lampes des galeries éclairent à peine, le bois de genévrier répand des
flocons de fumée odorante qui se perdent parmi le feuillage des arbres, et la braise rougeoie sous le gril. Un dîner mongol nous attend. Les amateurs de couleur locale regretteront les chameaux,
le désert. Mais la couleur locale n’est qu’une convention. C’est la couleur qui seule importe, et certes elle ne manque pas à notre groupe où je suis le plus mongol de tous, avec mon bonnet de
fourrure acheté au marché couvert de Pei-p’îng ; auprès de moi, M. Tch'ên-louh en par-dessus, Meî Lân-fâng debout et nu-tête, les autres convives en robes chinoises, les deux filles du maître de
maison nous servant de leurs mains fines : voilà un tableau pittoresque.
La cuisine en Chine est un art ; non contente des merveilles qu’elle a inventées selon le goût de chaque province, elle s’intéresse également aux saveurs exotiques. Mais c’est pour s’en inspirer,
et en leur retirant ce qu’elles peuvent avoir d’ingrat ou de sauvage les soumettre aux bonnes règles du style.
La viande de mouton, nourriture des Mongols, n’a rencontré qu’en Chine cette saumure aromatique où elle macère avant d’être mise sur le gril. Chacun puise du bout de ses baguettes un morceau,
qu’il regarde cuire et grésiller en le retournant quand il faut. Le goût est délicieux ; et nous sommes surpris nous-mêmes de pouvoir à ce point nous gorger de viande, comme de vrais
Mongols.
Le lettré raffiné qui est ce soir notre hôte nous réserve encore un autre régal. Nous prenons place dans la cour, devant une fenêtre qui s’éclaire. Des ombres coloriées s’y projettent, on
reconnaît un empereur, des magistrats, des soldats. Ce sont les personnages des pièces qui vont être jouées devant nous. Je suis prié de choisir celle qui me plaît, dans une longue liste de
titres, inscrits sur les deux faces d’une lame de bois courbée. Ce sont les mêmes que l’on représente au théâtre, et je choisis, parce que j’en connais le sujet, l’histoire de ce novice en un
couvent bouddhique, poursuivi par l’épouse qu’il a quittée, et qui est une magicienne. Voici le supérieur du couvent, branlant la tête, et le novice à genoux devant lui. Puis le déluge suscité
par la magicienne, menaçant les murs du monastère sur la montagne, les luttes avec des monstres, dont l’un crache du feu derrière l’écran de papier huilé. Le violon chante et la guitare se moque,
avec ses notes sèches, en rythme de scherzo. Le moine est retourné à son logis et a retrouvé son épouse qui lui présente leur enfant. Il ne pense qu’à se débarrasser d’elle, qui ne se doute de
rien, et presse le nourrisson sur son cœur.
La musique change. Ces sons graves et pénétrants, c’est le cymbalon chinois qu’on frappe de baguettes flexibles. Il découpe sans arrêt ses arpèges auxquels s’accroche tantôt un violoncelle à
trois cordes, plus doux que le violon, tantôt une voix de ténor, agréable et nuancée. C’est une berceuse, d’une tendresse inquiète, mélancolique et délicieuse. Il faut féliciter les artistes.
Celui qui fait mouvoir les silhouettes découpées dans le parchemin n’y emploie qu’une main ; l’autre soutient le tuyau de sa pipe qu’il fume, l’air satisfait et un peu narquois. Le chanteur vers
le fond de la chambre a son livre ouvert devant lui et ne s’en laisse pas distraire. Les deux musiciens sont âgés, puisqu’ils portent barbiche, et les traits nets de leurs visages sont creusés
par les rides. Tous quatre répondent d’un salut aimable à mon compliment. Mais leurs visages s’éclairent d’un heureux sourire quand j’ajoute : « Je m’en souviendrai en France ».
Les musiciens sont arrivés. Comme pour un vrai mariage ils ont endossé les souquenilles
chamarrées de bleu et de rouge, et voilà qu’ils disposent leurs tambours, sur deux rangs qui se font face, le long des murs de la salle oblongue, pendant que les joueurs de flûtes, de clarinettes
et de hautbois gagnent le fond où ils restent debout, attendant le signal.
Mon ami le fils du ministre m’a fait cette surprise. Qu’il s’agisse de vases anciens, de sculpture ou de musique, son goût affiné sait discerner, sous la rudesse du procédé, l’accent direct et
fort. Les symphonies que nous allons entendre sont de tradition pour accompagner la fiancée qui monte dans la chaise à porteurs hermétiquement close, disant adieu à ses compagnes, puis en
descend, accueillie par sa nouvelle famille qui la présente aux ancêtres.
Dès les premières notes le concert nous submerge, si puissant que malgré moi je m’avance, attiré par les ondes sonores, pas à pas dans l’allée que trace le rythme des tambours, pour gagner un
siège vacant près du groupe instrumental, et boire de plus près encore la mélodie impérieuse et déchirante. De part et d’autre du hautbois qui la scande en lignes droites, fermes comme le sol, la
clarinette plonge en remous aquatiques, et la flûte voltige : puis tout se rejoint, se noue pour un moment à l’unisson, s’écarte par des inflexions différentes ; le son instable explose, se
reforme, éclate encore, avec des irisations changeantes et des stries mobiles qui ne laissent pas à l’oreille un instant de repos dans la sécurité, pendant que les tambours tous ensemble frappent
des coups violents comme la foudre, soudain s’apaisent en un murmure aussi doux que l’ondée, ou abattent les baguettes en grêle sèche sur le rebord en bois. Personne ne dirige, mais tous sont
attentifs, le regard immobile, lisant en leur mémoire la partition qui se transmet ainsi depuis des siècles.
Ni allégresse, ni tendresse en ce chant nuptial. C’est un pieux martyre, une souffrance nécessaire et féconde. La fiancée est l’élue mais aussi la victime offerte en sacrifice aux volontés de la
nature élémentaire. C’est l’idée que Stravinski a illustrée, en son poème symphonique des Noces et mieux encore dans le Sacre du printemps, d’une musique où son art parvient à imiter, sans les
avoir jamais entendues, ces sonorités en déflagration et cette cadence implacable. Mais ici l’harmonie est à l’état natif, sans facettes polies, gemme rugueuse et dure, qui lentement a pris sa
forme inaltérable aux profondeurs de la terre chinoise.

















