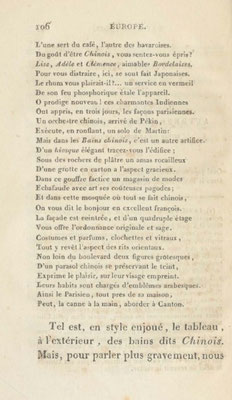Henri Cordier (1849-1925)

LA CHINE EN FRANCE AU XVIIIe SIÈCLE
Henri Laurens, Paris, 1910, 140 pages, 16 planches h. t.
Lecture faite à la séance annuelle de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, le 20 novembre 1908.
- Introduction : "Je voudrais aujourd'hui rechercher quelques traces de l'influence exercée par l'art et la littérature du Céleste-Empire dans notre pays, en particulier au XVIIIe siècle, pendant lequel, longtemps, ils firent fureur."
- "Cette influence a été d'ailleurs d'une durée relativement courte, et l'art chinois, chez nous, a eu surtout le caractère d'un engouement, d'une mode, d'une curiosité passagère, sans laisser de traces vraiment profondes."
- Conclusion : "J'ai tenté dans ces quelques pages de décrire l'engouement plus que passager suscité en France au XVIIIe siècle par une mode exotique. Ces crises sont fréquentes chez nous. Toutefois il faudrait se bien garder de croire que les rares objets de véritable valeur noyés dans la masse des produits de l'industrie de l'Asie orientale, suffisent à nous donner une notion juste de l'art chinois. Il a fallu plusieurs guerres et deux actes qui ont donné aux Asiatiques une triste idée de la civilisation européenne : le pillage du Youen Ming Youen, résidence d'été de l'Empereur, en 1860, et surtout le sac des palais impériaux de Pe-King, en 1900 — actes difficilement excusables mais qui ont singulièrement servi l'histoire de l'art puisqu'ils ont mis à jour des chefs-d'œuvre ensevelis jusqu'alors — pour apprendre qu'il y avait une peinture chinoise digne de notre admiration."
Extraits : Une ancienne mention du thé - Watteau et Huet, choiseries et singeries - Bains et Redoute
Voltaire, Diderot, Rousseau et les autres
Feuilleter
Lire aussi
M. le Dr G. Schlegel, de Leyde, dans son mémoire intitulé First introduction of Tea into Holland (T'oung Pao, Série II, Vol. I,
1900, pp. 468 seq.) nous dit que suivant une longue note adressée à M. G.-P. Rouffaer par M. H.-T. Colenbrander, archiviste-adjoint aux Archives d'État à La Haye, il est fait mention dans un
connaissement de l'année 1650-1651, d'une importation de thé japonais à Amsterdam sous le nom de thia ; il ajoute que dans une lettre écrite par les dix-sept directeurs de la Compagnie
des Indes orientales au Gouverneur général, en date du 2 janvier, 1637, il est dit que :
« Comme le thé commence à devenir en usage parmi quelques gens, nous attendons quelques vases de thé chinois aussi bien que japonais par tous les
navires ; »
M. Colenbrander pense que le thé a été importé sur une grande échelle vers 1667.
La plus ancienne mention de cette plante que l'on trouve dans les Archives de l'East India Company se rencontre dans une lettre de R. Wickham, agent de la Compagnie, à Firando, Japon, écrivant le
27 juin 1615 à Mr. Eaton, à Miaco, pour lui demander « un pot de la meilleure sorte de chaw ». Ce nom de tch'a, donné au thé, est celui que les Russes, qui le connaissent par le Nord,
lui ont conservé, en l'appelant чай et les Grecs, τσάι ; le nom tch'a de la même plante au Japon indique que les habitants de l'empire du Soleil Levant ont, malgré
leurs nombreuses relations avec le Fou-Kien, connu le thé par le nord de la Chine, probablement par la Corée. À nous autres Occidentaux, le thé nous est parvenu avec la prononciation tê
en usage dans le sud de la Chine, et en particulier dans la province de Fou-Kien, où il croît en abondance, et est d'excellente qualité. Le thé fut importé en Angleterre au milieu du XVIIIe
siècle, et cette véritable commère, Pepys, Secrétaire de l'Amirauté, marque dans son Journal, au 25 septembre 1660 : « J'ai envoyé chercher une tasse de tee (une boisson chinoise), dont je
n'avais jamais bu auparavant. »
C'est donc par erreur qu'on raconte que la première livre de thé qui lui coûta soixante shillings fut rapportée de Hollande par Lord Arlington l'année de la grande peste (1665). Il ne paraît pas
plus exact de dire que Mrs. Montagu adopta en 1788 la mode introduite de France par le duc de Dorset de donner des thés. Le Tatler de mars 1710, renferme l'annonce suivante :
« The finest Imperial Tea, 18s. ; Bohee 12s. ; 16s., 20s. ; and 2S. : all sorts of Green, the lowest 12s. To be had of R. Tate, at the 'Star' in
Bedford Court, near Bedford Street, Covent Garden. »
Dans le Strand, sur l'emplacement de Tom's Coffee House, Thomas Twining, dont le portrait fut peint par Hogarth, établit, en 1710, un magasin de
thé qui fut reconstruit tout près à côté de Devereux Court, à l'enseigne Ye Golden Lyon ; au commerce du thé fut ajoutée une banque et cette année, le 20 février 1910, a été célébrée la fondation
de la maison, deux fois centenaire, de Twining & Co.
Le thé fut porté de Hollande en France.
Dans sa lettre adressée le 10 mars 1648, au Dr Spon, à Lyon, Gui Patin lui mande :
« Nous avons ici, jeudi prochain, une thèse dont plusieurs se plaignent qu'elle est fort mal faite ; en voici la conclusion : ergo, the
chinensium menti consert. Le dernier corollaire parle de ce thé, les quatre autres n'en approchent point. J'ai fait avertir le président que chinensium n'est pas latin ; que
Ptolémée, Cluvérius, Joseph Scaliger et tous ceux qui ont écrit de la Chine (qui est un mot dépravé en françois), écrivent sinenses, sinensium ou sinæ, sinarum. Ce président
badin et ignorant m'a mandé qu'il avoit bien d'autres auteurs que les miens qui disent chinenses : ses auteurs, je doute s'il y en eut jamais un bon. Ce président n'a fait cette thèse
sur cette herbe, sur le thé, que pour flatter M. le chancellier, duquel est venue la réputation de cette drogue, quæ statim evanuit cum sonitu, et de la bonté de laquelle ceux-mêmes qui
la vantent n'oseroient jurer, n'en pouvant assigner aucun bon effet. »
Dans une autre lettre du 22 mars 1648, adressée à ce même Dr Spon, Gui Patin revient sur cette thèse :
« Un de nos docteurs, qui est bien plus glorieux qu'habile homme, nommé Morisset, voulant favoriser l'impertinente nouveauté du siècle et
taschant par là de se donner quelque crédit, a fait icy respandre une thèse du thé, laquelle conclue aussi bien que ce Président à la teste bien faite. Tout le monde a improuvé la thèse ; il y a
eu quelques-uns de nos docteurs qui l'ont brûlée, et reproches ont esté faits au doyen de l'avoir approuvée. Vous la verrez et en rirez. »
M. Alfred Franklin écrit que c'est dans cette lettre du 22 mars 1648 qu'il rencontre le thé mentionné pour la première fois à Paris, et il ajoute
:
« Il importe de ne pas prendre trop au sérieux les sarcasmes de Gui Patin, ennemi déclaré de toutes les innovations, surtout en médecine. La
thèse qu'il dénigre si bien ici a pour titre : An The Chinensium menti consert ? Elle fut soutenue par le bachelier Armand-Jean de Mauvillain, qui devint doyen de la Faculté en 1666, et
elle eut pour président Philibert Morisset, qui n'était pas non plus le premier venu, puisqu'il fut élu doyen en 1660. De la phrase écrite par Patin, il reste donc seulement à retenir qu'au mois
de mars 1648, le thé était déjà apprécié à Paris. »
Gui Patin nous apprend aussi :
« Mazarin prend du thé pour se garantir de la goutte. Ne voilà-t-il pas un puissant remède contre la goutte d'un favori. »
Pendant toute la seconde moitié du XVIIe siècle, paraissent en abondance les brochures vantant les qualités de la plante chinoise. Philippe
Sylvestre Dufour, J. N. Pechlin, médecin du roi de Danemark et le médecin parisien Pierre Petit sont ses principaux avocats ; dissertations, mémoires, poèmes célèbrent les mérites d'une boisson
qu'un admirateur appellera l'Ambrosia asiatica (Gènes 1672), panacée universelle guérissant la migraine, grand remède contre la goutte et la gravelle ainsi que le prouve une thèse de
1657 : An arthritidi The Sinensium, soutenue dans une séance solennelle à laquelle le chancelier Séguier, lui-même rhumatisant, assiste en compagnie de nombreux robins eux-mêmes assez
mal en point.
Ce ne sera toutefois qu'au XVIIIe siècle que le thé sera définitivement adopté en Europe.
...Bien plus utiles, pour nous faire connaître la Chine, furent les missionnaires de Pe-king, lorsque l'arrivée de cinq jésuites envoyés en 1685
par Louis XIV, pour établir une mission française rivale de la mission portugaise, dans la capitale de l'Empire, nous procura un incontestable avantage sur les autres nations. Le retour en
France, en 1697, du père Bouvet, l'un de ces cinq jésuites, fournit une base plus solide aux recherches dont l'art chinois pouvait être l'objet ; cette même année, ce Père donna chez P. Giffart,
rue Saint-Jacques, sous le titre de L'Estât present de la Chine, un recueil de 19 planches représentant les costumes depuis l'Empereur en habit de cérémonie jusqu'au « Bonze ou Prêtre des Idoles
en habit ordinaire » ; dans les exemplaires coloriés de ce recueil, la peinture est loin d'égaler la finesse de celle des Chinois... Cet album fut peut-être le point de départ de cet engouement
pour la chinoiserie au XVIIIe siècle.
Parmi les premiers artistes qui sacrifièrent au goût du jour, il faut compter l'illustre peintre de l'Embarquement pour l'île de Cythère : Antoine Watteau, qui décora le cabinet du garde des
Sceaux Chauvelin, peignit pour le duc de Cossé quatre compositions représentant, avec des Amours et des Singes, les Saisons, et exécuta diverses figures chinoises et tartares pour le cabinet du
Roi, au château de la Muette ; cette dernière décoration comprenait trente peintures, qui furent gravées par Boucher, Jeaurat et Michel Aubert.
« Malgré leur provenance conjecturale, écrit Paul Mantz, ces Chinois de la Muette n'en ont pas moins engendré une postérité très nombreuse. La
Chinoiserie, continuée par Christophe Huet, par Peyrotte et par d'autres dont nous ne savons pas les noms, sera jusqu'à la Révolution l'amusement du XVIIIe siècle. »
Détails des Singeries de Chantilly, attribuées à Christophe Huet (1700-1759)
De la chinoiserie, on passe facilement à la singerie, et le maître dans ce genre fut peut-être Christophe Huet, mort en 1759 ; en dehors de
nombreux carrosses et quantité de chaises à porteurs, cet artiste a exécuté une foule de décorations dans divers châteaux : au château de Champs, entre le pont de Chelles et Noisiel, sur la rive
gauche de la Marne, construit dans la première moitié du XVIIIe siècle par l'architecte Chamblin pour le financier Paul Poisson, dit Bourvarlais, passé au duc de la Vallière, puis à Santerre, et
plus récemment à M. Louis Cahen (d'Anvers), Huet peignit au rez-de-chaussée un salon chinois :
« La salle de compagnie, écrit d'Argenville, est embellie de panneaux de menuiserie, dans lesquels Huet a peint des Chinois & des Chinoises ;
au plafond il y a des ornements légers entremêlés d'oiseaux & d'insectes. »
Il décora également de camaïeux bleus, représentant des pastorales chinoises, le cabinet attenant à la chambre à coucher de la duchesse de la
Vallière. Nous retrouvons Huet, à Plaisance, près Nogent-sur-Marne, chez Pâris-Duverney, où il décore un salon ; chez le Régent, au château de Bagnolet, où il peint une salle à manger ovale ;
Coypel y avait exécuté différents tableaux dont les sujets sont tirés du roman Daphnis et Chloé. C'est probablement de 1745 à 1750 que Huet exécuta une de ses décorations les plus connues, les
arabesques et les figures chinoises du Cabinet de l'ancien hôtel de Rohan, depuis le décret du 6 mars 1808 Imprimerie Nationale, construit au commencement du XVIIIe siècle par l'architecte
Delamaire, pour Armand Gaston de Rohan, évêque de Strasbourg, promu au cardinalat en 1712.
Gélis Didot dans la Peinture décorative en France au XVIIIe siècle, Paris, Charles Schmid, s. d., in-fol., a donné 2 planches en couleur de la Singerie de l'Hôtel de Rohan, et 2 planches
en couleur de la grande Singerie de Chantilly, sans compter les figures en noir.
« Toute la surface de ces boiseries et des lambris, portes comprises, et la gorge des corniches, écrit un critique, sont couvertes d'arabesques
en couleur et or, de bergeries ou de jeux dont une partie des personnages ont le costume chinois, de camaïeux, de singes, de chiens, d'oiseaux, de guirlandes de fleurs. L'habileté, l'esprit, le
vif coloris et le goût de Christophe Huet s'y sont donné carrière. »
Malgré l'opinion d'Edmond de Goncourt qui l'attribue à Antoine Watteau — l'hésitation serait bien permise en pareil cas, si Watteau n'était mort
dès 1721, alors que les peintures sont probablement de 1735, — c'est à Huet, sans doute, qu'il faut donner la Grande Singerie (Chinois et singes) du salon du premier étage qui précède la galerie
des Batailles du château de Chantilly et la Petite Singerie (singes et singesses) du rez-de-chaussée du petit Château, œuvres commandées par le duc de Bourbon.
Cet engouement pour les choses de Chine, nous les retrouvons jusque dans cet établissement, autrefois célèbre que l'on désignait sous le nom de
Bains chinois dont la disposition aurait certainement surpris les Fils du Ciel, égarés dans la capitale de la Gaule barbare.
À la fin du XVIIIe siècle, les Bains chinois, jadis placés au bas du pont de la Tournelle, étaient installés avec l'École de natation, à la pointe de l'île Saint-Louis. Il y avait également des
Bains orientaux, « situés sur le boulevard de Choiseul au coin de la rue de la Michaudière ». Ces bains orientaux prirent plus tard le nom de Bains chinois sous lequel ils ont été célèbres ; ce
coin de la rue de la Michodière portait le n° 25 du boulevard des Italiens. « L'architecture qui en est turcque, chinoise et persane, est de M. Lenoir surnommé le Romain. » Le singulier Cuisin, «
auteur de plusieurs romans », dans son ouvrage sur les Bains de Paris ou le Neptune des Dames... Dédié au Beau-Sexe, a consacré son Huitième tableau aux « Bains chinois autrefois dits orientaux
situés sur le boulevard italien » qu'il célèbre par une pièce de vers :
Quel pays merveilleux ! Sans sortir de Paris,
Dans le Palais-Royal, vous avez des Chinoises :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un orchestre chinois, arrivé de Pékin,
Exécute, en ronflant, un solo de Martin :
Mais dans les Bains chinois, c'est un autre artifice.
D'un kiosque élégant tracez-vous l'édifice ;
Sous des rochers de plâtre en amas rocailleux
D'une grotte en carton a l'aspect gracieux.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ainsi le Parisien, tout près de sa maison
Peut, la canne à la main, aborder à Canton.
Une note nous explique que
« Le café, situé au milieu de la galerie de gauche, se nommait autrefois le Café des Étrangers : depuis quelque temps il a pris le titre du Café
des Chinois. En effet, on y est servi par de très jolies femmes, costumées à l'orientale, qui vous apportent, d'une manière gracieuse, tout ce que vous pouvez désirer.... Au bas de l'escalier est
un Chinois immobile qui sert là de hallebardier...
Ce café fut le quartier général de Caïus Gracchus Babeuf et de ses complices.
On verra dans la collection des Vues pittoresques de Paris, publiée par Campion frères, rue S. Jacques, à la Ville de Rouen, deux planches nos 102 et 106, dessinées par Sergent et
gravées par Guyot, donnant la première une « Vue des Nouveaux Bains chinois, Boulevard de la Chaussée d'Antin », et la seconde, une « Vue de l'Intérieur des Bains Chinois ». Cet établissement
paraît se composer de deux ailes à deux étages avec une façade de trois fenêtres et un rez-de-chaussée, se prolongeant et se réunissant derrière au centre de la cour à un pavillon central à trois
pans, moitié d'un hexagone engagé, bâti sur des rochers et surmonté d'un léger belvédère ; au fronton de ce pavillon percé de fenêtres octogonales, des caractères chinois illisibles ; devant une
petite pièce d'eau ; du boulevard on voit ce fond, à travers une marquise portée par des piliers, de fonte apparemment, qui relie à hauteur des toits les deux ailes sur chacune desquelles flotte
une girouette portant un poisson. Édouard Fournier nous apprend que cet
« immense joujou pseudo-chinois, que le génie des étrennes semblait avoir, un beau jour, apporté de Nuremberg, et déposé au coin de la rue
Delamichodière, désolé de ne pouvoir le faire entrer chez Tempier, le marchand de jouets voisin,
n'existe plus depuis 1853 ; il a été remplacé par un vaste immeuble dont le rez-de-chaussée est occupé par la parfumerie Violet et le premier
étage par le Cercle des chemins de fer.

Claude Ruggieri, artificier du Roi, nous rappelle l'existence d'une Redoute chinoise
:
« Elle prit son nom du genre de sa décoration ; elle fut construite dans la foire Saint-Laurent, et fit son ouverture le jeudi 28 juin 1781. On y
trouvait un jeu de bague, une escarpolette orientale, un café dans un souterrain toujours frais, enfin un salon de danse. L'année suivante, il y eut de nouveaux jeux ; et, en 1783, pour célébrer
la fête du Roi, on fit une illumination en verres de couleurs. En 1784, les amusements furent les mêmes ; mais pendant l'été de 1785, la Redoute n'ouvrit que deux fois sous le nom de Pavillon
chinois. Le 25 mai, on y donna une fête extraordinaire, et elle termina ses jeux en même temps que la foire Saint-Laurent.
La balançoire était soutenue par un Chinois et une Chinoise ; Bettini l'a dessinée ainsi
que le jeu de bague.
Les jeux de bague étaient alors fort à la mode ; nous en avons cité quelques-uns ; le jeu de bague chinois entouré d'un bassin qui se
trouvait dans le jardin anglais du duc de Chartres, à Monceaux, était célèbre :
« Trois pagodes chinoises portent un grand parasol qui couvre ce jeu. Ces pagodes, appuyées sur une barre horizontale, meuvent avec le plancher
qui est sous leurs pieds. La mécanique, qui les fait tourner, est mise en mouvement par des hommes dans un souterrain pratiqué au-dessous. Des bords du plancher partent quatre branches de fer,
dont deux soutiennent des dragons sur lesquels les messieurs montent à cheval : sur les deux autres branches sont couchés des Chinois soutenant d'un bras un coussin sur lequel s'assoient les
dames ; ils tiennent d'une main un parasol garni de grelots, & de l'autre un second coussin pour poser les pieds. Aux bords du grand parasol sont suspendus des œufs d'autruche & des
sonnettes...
Au Petit Trianon, à droite, avait été élevé le jeu de bague de la Reine, de style chinois ; il a été reproduit par la Société d'édition
artistique de Paris, d'après une aquarelle de la Collection Parmentier ayant appartenu à Marie-Antoinette.
J'ai vu un projet par J. D. Dugoure de salon de jeu au milieu d'un lac, avec gondole, pavillon sur pilotis me rappelant la ville de Chang-haï avec pagode au fond. Ce projet a d'ailleurs été gravé
par Dugoure et Berthault.
Les jésuites envoyèrent de Pe-king ces éditions impériales qui font aujourd'hui l'ornement de la Bibliothèque nationale ; d'ailleurs ces
missionnaires inlassables dans leurs efforts et dans leur travail envoyaient mémoire après mémoire, et leurs manuscrits sont la base des grandes collections connues sous les titres de Description de la Chine, par Du Halde, de Lettres édifiantes, de Mémoires concernant les Chinois. La littérature
comme l'art allait puiser largement à la source nouvelle que lui offrait la Chine.
Voltaire avait lu les ouvrages de Gonçalez de Mendoza, Henning, Luis de Guzman, Semedo, Gaubil, les lettres du père Parrenin, et surtout la Description de la
Chine de Du Halde ; il s'appuyait sur leur témoignage pour défendre l'antiquité de la Chine ; il témoignait de son admiration pour Confucius en inscrivant les quatre vers suivants au bas
du portrait du philosophe gravé par Helman :
De la seule raison salutaire interprète,
Sans éblouir le monde, éclairant les esprits,
Il ne parla qu'en sage, et jamais en prophète ;
Cependant on le crut, et même en son pays.
La tragédie chinoise, le Petit Orphelin de la Maison de Tchao, dont la traduction par le père de Prémare avait été insérée par Du Halde
dans son grand ouvrage suggéra à Voltaire, sa tragédie en cinq actes, L'Orphelin de
la Chine, ainsi qu'il le marque au duc de Richelieu dans son épître dédicatoire. En août 1753, Voltaire annonçait à d'Argental qu'il travaillait à une tragédie « toute pleine
d'amour ». Pour la première fois, « ses Magots » comme il les appelle, furent représentés le 20 août 1755. Quoique les personnages de Voltaire, un Gengis-Kan, ridicule et tragique, amoureux d'une
certaine Idamé mariée à un Kamti prédestiné à jouer les Georges Dandin, soient de son invention, la pièce de L'Orphelin de la Chine mérite d'être signalée car elle est, je crois, la
première en France dont le sujet ait été emprunté à l'Extrême-Orient ; Lekain, dans le rôle de Gengis Kan, Mlle Clairon dans celui d'Idamé contribuèrent sans doute au succès relatif de cette
œuvre médiocre.
Dans son article sur la Chine inséré au Dictionnaire philosophique, Voltaire écrira :
« Nous n'avons aucune maison en Europe dont l'antiquité soit aussi bien prouvée que celle de l'Empire de la Chine. »
« Nous allons chercher à la Chine de la terre, comme si nous n'en avions point ; des étoffes, comme si nous manquions d'étoffes ; une petite herbe pour infuser dans de l'eau, comme si nous
n'avions point de simples dans nos climats. En récompense, nous voulons convertir les Chinois : c'est un zèle très louable ; mais il ne faut pas leur contester leur antiquité, et leur dire qu'ils
sont des idolâtres. »
Dans ses Fragments sur l'Histoire générale (1773) Voltaire consacrera un article à étudier Si
les Égyptiens ont peuplé la Chine, et si les Chinois ont mangé des hommes. Sa plaisanterie, en voulant être plaisante, devient lourde dans le dialogue entre le père Rigolet et l'empereur
Yong-tcheng désireux de s'instruire de la religion chrétienne et dans ce but faisant venir le frère « qui, dit-il, avait converti quelques enfants des crocheteurs et des lavandières du palais
».
Cependant dans le fatras des remarques souvent médiocres que la Chine a suggérées à son esprit caustique, Voltaire, dans une circonstance, s'est montré un véritable voyant, devançant de plus d'un
siècle les idées de la vieille Europe sur la politique générale du monde. On a souvent chez nous ridiculisé la Chine qui, entourée des Quatre Mers, forme l'Empire du Milieu autour duquel
gravitent les peuples étrangers, tributaires et barbares. À vrai dire, pendant des siècles, notre conception de l'univers, n'a pas été fort éloignée de celle des Chinois. L'Europe oubliant
qu'elle n'est qu'une partie du monde, a ignoré ou dédaigné les besoins et les aspirations des continents voisins : elle fut désagréablement surprise lorsqu'il lui fallut compter avec une Amérique
et une doctrine de Monroë qui ne lui permettaient pas de s'établir à sa guise dans les terres à sa convenance du Nouveau Monde ; le réveil fut plus brutal encore lorsqu'elle fut obligée de
s'apercevoir que ces peuples de l'Asie orientale — ces Magots — qu'elle avait pris l'habitude d'aller bombarder périodiquement pour les forcer à subir ses lois et à accepter ses drogues, étaient
gens avec lesquels il fallait désormais compter, et bon gré mal gré, les diplomates, désorientés c'est le cas de le dire, furent contraints de voir qu'il n'y a pas seulement une politique
européenne, mais qu'il existe une politique embrassant le globe entier, que chaque peuple, asiatique, américain aussi bien qu'européen, avait ses aspirations propres, que toucher aux intérêts de
l'un, c'était toucher aux intérêts du voisin, et par répercussion aux intérêts de beaucoup d'autres ; politique qui peut se traduire par : « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il
te fît ». Ces notions, dont malgré les avis d'esprits clairvoyants, on ne commença à tenir compte qu'après les guerres japonaises de 1895 et de 1904, Voltaire les avait faites siennes dès 1761
quand, à propos de la publication par Jean-Jacques Rousseau de son Extrait de Projet de paix perpétuelle de M. l'abbé de Saint Pierre — il invente un Rescrit de l'Empereur de la
Chine dans lequel je note ce passage remarquable :
« Nous avons été sensiblement affligé que dans ledit extrait rédigé par notre amé Jean-Jacques, où l'on expose les moyens faciles de donner à
l'Europe une paix perpétuelle, on avait oublié le reste de l'univers, qu'il faut toujours avoir en vue dans toutes ses brochures. Nous avons connu que la monarchie de France, qui est la première
des monarchies ; l'anarchie d'Allemagne qui est la première des anarchies ; l'Espagne, l'Angleterre, la Pologne, la Suède, qui sont, suivant leurs historiens, chacune en son genre, la première
puissance de l'univers, sont toutes requises d'accéder au traité de Jean-Jacques. Nous avons été édifié de voir que notre chère cousine l'impératrice de toute Russie était pareillement requise de
fournir son contingent. Mais grande a été notre surprise impériale quand nous avons en vain cherché notre nom dans la liste. Nous avons jugé qu'étant si proche voisin de notre chère cousine, nous
devions être nommé avec elle ; que le Grand Turc voisin de la Hongrie et de Naples, le roi de Perse voisin du Grand Turc, le Grand Mogol voisin du roi de Perse, ont également les mêmes droits, et
que ce serait faire au Japon une injustice criante de l'oublier dans la confédération générale. »
Diderot a usé de la Chine et des Chinois avec plus de modération que Voltaire et ses
jugements ne manquent pas de vérité ; dans l'article qu'il a consacré à la Philosophie des Chinois dans le Dictionnaire Encyclopédique, il écrit
:
« Ces peuples, qui sont, d'un consentement unanime, supérieurs à toutes les nations de l'Asie, par leur ancienneté, leur esprit, leurs progrès dans les arts, leur sagesse, leur politique, leur goût pour la philosophie, le disputent même dans tous ces points, au jugement de quelques auteurs, aux contrées de l'Europe les plus éclairées. »
Et encore, ce qui est parfaitement juste :
« La morale de Confucius est bien supérieure à sa métaphysique et à sa physique. »
Diderot pose même le problème de la conquête de la Chine dans sa Réfutation de l'ouvrage d'Helvétius intitulé l'« Homme » :
« On ne s'est jamais demandé, dit-il, pourquoi les lois et les mœurs chinoises se sont maintenues au milieu des invasions de cet Empire ; le
voici : c'est qu'il ne faut qu'une poignée d'hommes pour conquérir la Chine, et qu'il en faudrait des millions pour la changer. Soixante mille hommes se sont emparés de cette contrée ; qu'y
deviennent-ils ? Ils se sont dispersés entre soixante millions, c'est mille hommes pour chaque million ; or, croit-on que mille hommes puissent changer les lois, les mœurs, les usages, les
coutumes d'un million d'hommes ? Le vainqueur se conforme au vaincu, dont la masse le domine : c'est un ruisseau d'eau douce qui se perd dans une mer d'eau salée, une goutte d'eau qui tombe dans
un tonneau d'esprit de vin. La durée du gouvernement chinois est une conséquence nécessaire non de sa bonté, mais bien de l'excessive population de la contrée ; et tant que cette cause
subsistera, l'Empire changera de maîtres sans changer de constitution : les Tartares se feront Chinois, mais les Chinois ne se feront pas Tartares. Je ne connais que la superstition d'un
vainqueur intolérant qui pût ébranler l'administration et les lois nationales, parce que cette fureur religieuse est capable des choses les plus extraordinaires, comme de massacrer en une nuit
plusieurs milliers de dissidents. Une religion nouvelle ne s'introduit pas, chez aucun peuple, sans révolution dans la législation et les mœurs. Garantissez la Chine de cet événement,
répondez-moi que les enfants de quelque empereur ne se partageront point ce vaste pays, et ne craignez rien ni pour les progrès de sa population, ni pour la durée de ses mœurs. »
C'est en Chine que Jean-Jacques Rousseau cherchera le principal argument de son
Discours sur cette question : Le rétablissement des sciences et des arts a-t-il contribué à épurer les mœurs ?
« Mais pourquoi chercher dans des temps reculés des preuves d'une vérité dont nous avons sous nos yeux des témoignages subsistants ?, écrit-il.
Il est en Asie une contrée immense où les lettres honorées conduisent aux premières dignités de l'État. Si les sciences épuraient les mœurs, si elles apprenaient aux hommes à verser leur sang
pour la patrie, si elles animaient le courage, les peuples de la Chine devraient être sages, libres et invincibles. Mais il n'y a point de vice qui ne les domine, point de crime qui ne leur soit
familier ; si les lumières des ministres, ni la prétendue sagesse des lois, ni la multitude des habitants de ce vaste empire, n'ont pu le garantir du joug du Tartare ignorant et grossier, de quoi
lui ont servi tous ses savants ? Quel fruit a-t-il retiré des honneurs dont ils sont comblés ? serait-ce d'être peuplé d'esclaves et de méchants ? »
Dans la Nouvelle Héloïse, Rousseau ajoutera encore quelques touches à ce portrait déjà si peu flatté du Chinois :
« Autant de fois conquis qu'attaqué, il fut toujours en proie au premier venu, et le sera jusqu'à la fin des siècles. Je l'ai trouvé digne de son
sort, n'ayant pas même le courage d'en gémir. Lettré, lâche, hypocrite et charlatan ; parlant beaucoup sans rien dire, plein d'esprit sans aucun génie, abondant en signes et stérile en idées ;
poli, complimenteur, adroit, fourbe et fripon ; qui met tous les devoirs en étiquettes, toute la morale en simagrées, et ne connaît d'autre humanité que les salutations et les révérences. »
Et comme le philosophe de Genève n'est pas toujours conséquent avec lui-même, ailleurs, dans le Discours sur l'Économie politique, il
fera le plus bel éloge de l'administration et de la justice chinoises :
« À la Chine, le prince a pour maxime constante de donner le tort à ses officiers dans toutes les altercations qui s'élèvent entre eux et le
peuple. Le pain est-il cher dans une province, l'intendant est mis en prison. Se fait-il dans une autre une émeute, le gouverneur est cassé, et chaque mandarin répond sur sa tête de tout le mal
qui arrive dans son département. Ce n'est pas qu'on n'examine ensuite l'affaire dans un procès régulier ; mais une longue expérience en a fait prévenir ainsi le jugement. L'on a rarement en cela
quelque injustice à réparer et l'Empereur, persuadé que la clameur publique ne s'élève jamais sans sujet, démêle toujours, au travers des cris séditieux qu'il punit, de justes griefs qu'il
redresse. »
Comme on pouvait le supposer, les lectures de Montesquieu sont vastes ; il connaît non
seulement la Description de la Chine de Du Halde, mais aussi les traductions des Livres classiques chinois qui sont insérées dans ce grand ouvrage, les Lettres édifiantes, le
Journal de Lange, envoyé russe à Pe-King. De nombreux chapitres de l'Esprit des
Lois sont consacrés à la Chine. Montesquieu n'est ni un admirateur ni un dénigreur de parti pris ; à l'opinion favorable des missionnaires jésuites, il oppose les renseignements des
commerçants ou de marins comme Lord Anson ; il admire la fête du labourage et il a la sagesse de ne pas se lancer dans les lieux communs ordinaires sur la cruauté des Chinois dans un pays qui
assistera impassible au supplice inouï de Damiens. Toutefois, si les jugements de Montesquieu sont sages et pondérés, et il ne saurait en être autrement, je ne puis l'approuver quand il écrit
:
« Leur vie précaire fait qu'ils ont une activité prodigieuse, et un désir excessif du gain, qu'aucune nation commerçante ne peut se fier à eux.
Cette infidélité reconnue leur a conservé le commerce du Japon : aucun négociant d'Europe n'a osé entreprendre de le faire sous leur nom, quelque facilité qu'il y eût à l'entreprendre par leurs
provinces maritimes du nord. »
Mon expérience, qui est celle de beaucoup d'autres, est au contraire que le commerçant chinois est fort honnête.
*
Lire aussi :
- Hélène Belevitch-Stankevitch : Le goût chinois en France au temps de Louis XIV
- Le goût chinois en Europe au XVIIIe siècle. Catalogue.
- Henri Cordier : Les conquêtes de l'empereur de la Chine.
- Morgane Mouillade : La seconde tenture chinoise.
- Jardins anglo-chinois, sur le site de l'INHA.
Albums de reproductions sur le site images d'art :