Jean-Baptiste Du Halde : Description de l'empire de la Chine

Tome second
A Paris, chez P. G. LEMERCIER, Imprimeur-libraire, rue Saint-Jacques, au livre d'Or, 1735.
Extraits : Cérémonies dans les devoirs de civilité - Une princesse à marier

Table sommaire des articles du second tome
De la monarchie chinoise. De l’autorité de l’empereur, des sceaux de l’empire, de ses revenus, de son palais, de ses équipages.
De la forme du gouvernement de la Chine, des différents tribunaux, des mandarins. Du gouvernement militaire, des forces de l’empire, des forteresses, des gens de guerre, de leurs armes, & de
leur artillerie. De la police. Des douanes. Des postes.
De la noblesse. De la fertilité des terres, de l’agriculture. De l’adresse des artisans, & de l’industrie du menu peuple,
Du génie & du caractère de la nation chinoise. De la physionomie. Des modes, des maisons, & des meubles. - De la magnificence. Des ouvrages publics.
Des cérémonies. Des devoirs de civilités. Des présents.
Des prisons & des châtiments. De l’abondance.
Des lacs, des canaux, & des rivières. Des barques, des vaisseaux.
De la monnaie. Du commerce. Du vernis. De la porcelaine. Des soieries.
De la langue chinoise. De la prononciation. Abrégé de grammaire.
Du papier, de l’encre, des pinceaux, de l’imprimerie, & de la reliure des livres.
De quelle manière on fait étudier les jeunes Chinois.
De la littérature chinoise : Des King, l’Y king, le Chu king, le Chi king, le Tchun tsiou, le Li ki. Des livres classiques ou canoniques du second ordre, Vie de Cong fou tsee, ou
Confucius. Ta hio, Tchong yong, Lun yu, Meng tsee, Hiao king, Siao hio.
De l’éducation de la jeunesse. Des cinq devoirs. De la vigilance qu’on doit avoir sur soi-même. Règles pour bien gouverner son cœur, pour apprendre à composer son extérieur, pour le vêtement,
pour le repas. - Exemples par rapport à ces maximes, tirés de l’antiquité & des auteurs modernes.
Recueil impérial contenant les édits, les déclarations, les ordonnances, & les instructions des empereurs des différentes dynasties, les remontrances & les discours des
plus habiles ministres. - Extraits d’œuvres de Ouang yang ming. - Lié niu, ou Femmes illustres.

Il n’y a rien où la nation chinoise paraisse plus scrupuleuse, qu’aux cérémonies & aux
civilités dont elle use : elle est persuadée qu’une grande attention à s’acquitter de tous les devoirs de la vie civile, est capable plus que toute autre chose, d’ôter aux esprits une certaine
rudesse, avec laquelle on naît, d’inspirer de la douceur, & de maintenir la paix, le bon ordre, & la subordination dans un État : c’est, disent les Chinois, par la modestie & la
politesse dans la société civile, que les hommes se distinguent des bêtes féroces.
Parmi leurs livres, qui contiennent ces règles de civilité, il y en a un, où l’on en compte plus de trois mille différentes. Tout y est prescrit dans le détail : les saluts ordinaires, les
visites, les présents, les festins, tout ce qui se pratique en public, ou dans le particulier, sont plutôt des lois, que des usages introduits peu à peu par la coutume.
Cette police des civilités publiques se réduit presque toute, à régler la manière dont on doit s’incliner, se mettre à genoux, se prosterner une ou plusieurs fois, selon le temps ou le lieu,
selon l’âge & la qualité des personnes, surtout quand on se visite, quand on fait des présents, ou qu’on donne à manger à ses amis.
Les étrangers qui sont obligés de se conformer à ces usages, sont d’abord étonnés de ces fatigantes cérémonies. Les Chinois qui y sont élevés dès l’enfance, loin de s’en rebuter, s’en font un
mérite, & croient que c’est faute d’une semblable éducation, que les autres nations sont devenues barbares.
Et afin qu’avec le temps on ne se relâche point dans l’observation de ces usages, il y a un tribunal à Peking, dont la principale fonction est de conserver les cérémoniaux de l’empire.
Ce tribunal est si rigoureux, qu’il ne veut pas même que les étrangers y manquent. C’est pour cela qu’avant que d’introduire les ambassadeurs à la cour, la coutume est de les instruire en
particulier pendant quarante jours, & de les exercer aux cérémonies du pays, à peu près comme on exerce nos comédiens, quand ils doivent représenter une pièce sur le théâtre.

On raconte que dans une lettre que le grand duc de Moscovie écrivait autrefois à l’empereur
de la Chine, il priait Sa Majesté de pardonner à son ambassadeur, si faute de bien savoir les coutumes de l’empire, il faisait quelque incongruité ; le Li pou, qui est le tribunal dont je parle,
lui répondit galamment en ces termes, que les Pères de Peking traduisirent fidèlement par ordre de l’empereur. Legatus tuus multa fecit rustice. Votre ambassadeur a fait paraître en beaucoup de
choses de la grossièreté.
Cette affectation de gravité & de politesse paraît d’abord ridicule à un Européen, mais il faut bien qu’il s’y fasse, à moins qu’il ne veuille passer pour incivil & grossier. Après tout,
chaque nation a son génie & ses manières, & il n’en faut pas juger par les préventions de l’enfance, pour approuver, ou pour condamner ses mœurs & ses usages. Si en comparant les
coutumes de la Chine, avec les nôtres, nous sommes tentés de regarder une nation si sage, comme une nation bizarre ; les Chinois à leur tour, selon les idées particulières qu’ils se sont formées,
nous regardent aussi comme des barbares ; on se trompe de part & d’autre ; la plupart des actions humaines sont indifférentes d’elles-mêmes, & ne signifient que ce qu’il a plu aux peuples
d’y attacher dès leur première institution.

’est ce qui fait que souvent ce qu’on regarde dans un pays comme une marque d’honneur, est
regardé dans un autre comme un signe de mépris. En bien des endroits, c’est faire un affront à un honnête homme que de lui prendre la barbe ; en d’autres, c’est témoigner qu’on a de la vénération
pour lui, & qu’on veut lui demander quelque grâce. Les Européens se lèvent & se découvrent pour recevoir ceux qui les visitent ; les Japonais au contraire ne se remuent point, & ne se
découvrent point, mais se déchaussent seulement, & à la Chine c’est une incivilité grossière de parler tête nue à une personne. La comédie & les instruments de musique sont presque
partout une marque de joie, cependant on s’en sert à la Chine dans les funérailles.
Sans donc ni louer, ni blâmer des usages qui choquent nos préjugés, il suffit de dire que ces cérémonies, toutes gênantes qu’elles nous paraissent, sont regardées des Chinois comme très
importantes au bon ordre & au repos de l’État : c’est une étude que de les apprendre, & une science que de les posséder : on les y forme dès leur plus tendre jeunesse, & quelque
embarrassantes qu’elles soient, elles leur deviennent dans la suite comme naturelles.
Mais aussi tout étant réglé sur cet article, chacun est sûr de ne manquer à aucun devoir de la vie civile. Les Grands savent ce qu’ils doivent à l’empereur & aux princes, & la manière
dont il faut qu’ils se traitent les uns les autres : il n’y a pas jusqu’aux artisans, aux villageois, & aux gens de la lie du peuple, qui n’observent les formalités que prescrit la politesse
chinoise, & qui n’aient ensemble des manières douces & honnêtes. On le connaîtra par le détail où je vais entrer de ces cérémonies.
Il y a certains jours où les mandarins viennent en habit de cérémonie saluer l’empereur, & quand même il ne paraîtrait pas en public, ils saluent son trône, & c’est de même que s’ils
saluaient sa personne. En attendant le signal pour entrer dans la cour du tchao, (c’est la cour qui est devant la salle du trône), ils sont assis chacun sur son coussin dans la cour qui est
devant la porte méridionale du palais ; cette cour est pavée de briques, & propre comme une salle ; les coussins sont différents, suivant le rang des mandarins.
Ceux qui ont droit de coussin, car tous ne l’ont pas, le portent en été de soie qui se distingue par les couleurs ; & c’est surtout le milieu du coussin qui fait la différence du rang ; &
en hiver, de peaux qui se distinguent par le prix. Dans cette grande multitude, où il & semble que devrait régner la confusion & le tumulte, tout est admirablement réglé, & se passe
dans le plus grand ordre : chacun connaît sa place & à qui il doit céder : on ne sait ce que c’est que de se disputer le pas.
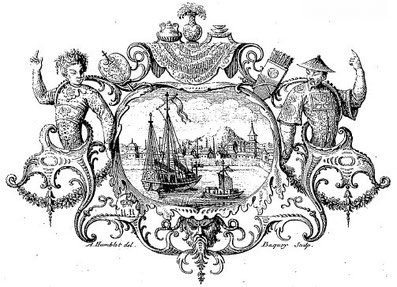
Hiao vou, un des empereurs de la dynastie Song, sachant que les princesses qu’on mariait, se
rendaient insupportables dans les familles où elles entraient, chercha les moyens d’y remédier. Il en prit un entr’autres assez singulier. Ayant destiné une de ses filles à Kiang min, fils de
Kiong chin, que sa vertu & ses services avaient élevé aux plus grands honneurs, il ordonna secrètement qu’on dressât au nom de Kiong chin une forte représentation, où l’on mît dans tout son
jour la conduite de ces princesses, & dont la conclusion fût qu’il s’excuserait de recevoir pour épouse celle qu’on lui présentait. L’écrit en effet fut dressé & présenté à l’empereur. Le
voici tel qu’il est rapporté dans Tang king tchuen.

Prince, Votre Majesté a eu la bonté de me destiner la princesse Ling hai. C’est une grâce
peu commune, & que je n’avais aucun lieu d’attendre. Cependant je ne puis dissimuler que j’ai reçu cet ordre avec autant de trouble & de tristesse, que de reconnaissance & de respect.
Mon indignité personnelle, encore plus que ma naissance, m’éloigne d’une si haute alliance. Ce qui me convient, c’est une personne du commun, & non pas une princesse. Les gens de ma sorte,
quoique peu riches, ont à peine pris le bonnet, qu’ils sont mariés. Ils en sont quittes pour quelques présents de peu de valeur, & l’on n’en voit point de si pauvres, qu’ils aient peine à
contracter une alliance honnête & proportionnée, dans laquelle ils vivent heureux & contents. Au contraire je fais réflexion que ceux qui ont épousé des princesses, ont vécu, du moins la
plupart, dans le chagrin & dans l’amertume. C’est pourquoi, bien que je sache estimer comme je dois, l’honneur que me fait Votre Majesté, je suis si éloigné de m’en applaudir, que si je ne
pouvais m’en défendre, je crois que je cesserais de vivre. Pardonnez, Grand roi, à ma simplicité & à ma franchise. Je suis fondé à penser & à parler ainsi sur bien des exemples, que notre
histoire me fournit. Sous les Tsin on vit Ouang tun, Hoen ouen, & Tchin tchang, épouser chacun une princesse. C’étaient gens issus de familles très anciennes, également illustres &
puissantes. Ces trois hommes avaient aussi de très belles qualités & un mérite reconnu. Cependant quel fut le fruit de ces alliances ? Ouang tun & Hoen ouen, auparavant les plus braves
& les plus estimés de tous les jeunes seigneurs de la cour, s’abâtardirent à l’abri de la faveur que leur procurait ce mariage, ils vécurent dans une indolence peu séante à leur rang, &
moururent dans le mépris. Pour Tching tchang le joug lui parut si pesant, qu’il contrefit le fol pour s’en délivrer. Depuis on a vu Tse king se brûler les pieds, pour éviter une pareille alliance
; Ouang yen, tout délicat qu’il était, se jeter tout nu au travers des neiges, & fuir celle à laquelle on l’avait lié ; Holi, qui égalait en beauté Long kong, se précipiter de désespoir dans
un puits ; Lie tchuang, se frotter exprès les yeux, jusqu’à devenir presque aveugle ; Yn tchong, s’exposer aux derniers supplices, & ne les éviter qu’avec peine. Ce n’est pas que ces derniers
manquassent de sens & de résolution : mais la qualité & l’autorité de leurs princesses les accablait : ils ne pouvaient porter leurs plaintes à l’empereur, la porte leur était fermée :
ils avaient à dévorer seuls les derniers chagrins : & leur condition était bien pire que celle des derniers esclaves.
Pouvoir aller & venir, visiter ses amis & les recevoir chez soi, c’est une liberté commune à tout honnête homme. A-t-on épousé une princesse ? C’est
madame qui va & vient à sa fantaisie : point de temps marqué pour son retour : plus de règle dans la maison. Il faut que le mari renonce à traiter jamais ses amis, & presque à tout
commerce avec ses parents. Si quelquefois la princesse de bonne humeur, s’avise de le traiter un peu moins mal, d’abord une vieille nourrice fronce les sourcils, une bonzesse la seconde, toutes
deux représentant à madame, qu’elle ne sait pas tenir son rang, & qu’elle gâte tout. Elle a de plus à sa suite une vile troupe d’eunuques, qui n’ont ni esprit, ni dextérité, ni politesse, qui
font tout au hasard, & sans raison, qui parlent à tort & à travers, sans examiner ce qu’ils disent. Voilà le conseil de la dame. La nourrice prétend que son âge lui donne droit de haïr à
mort quiconque entamera son crédit. La bonzesse fait la savante, & dit tant de choses sur l’avenir, qu’il est impossible que le hasard n’en vérifie une partie. A ces deux compagnes
ordinaires, survient quelquefois une vieille diseuse de bonne aventure, surtout à la fin des repas, pour en attraper les restes. C’est au pauvre mari de prendre patience : encore heureux s’il
n’avait rien de plus fâcheux à souffrir.

Un de ses grands embarras, c’est de prendre son parti pour voir madame, ou souvent, ou rarement. Il ne sait comment s’y prendre pour contenter en ce point
les caprices de sa princesse. Se présente-t-il souvent ? on refuse de l’admettre : l’admet-on ? il ne sort pas quand il veut. Laisse-t-il madame là ? Elle se croit méprisée & devient
furieuse. Prend-il congé après l’avoir vue ? Il va, dit-elle, voir quelque autre. Pour madame, elle sort à son gré, & revient quand il lui plaît, quelquefois bien avant dans la nuit,
quelquefois même au point du jour. Tantôt elle passe la nuit à jouer des instruments : tantôt elle est tout le jour les bras croisés devant un livre. Sa vie à proprement parler n’est qu’une suite
de caprices. Nos rits ne défendent point d’avoir quelques concubines. On n’est point censé par là faire injure à son épouse. Si cette épouse est une princesse, il ne faut pas y penser, elle se
croirait outragée, & ne le pourrait souffrir. Au moindre bruit, à la moindre apparence, au moindre soupçon, on voit sortir de l’appartement de madame quelque jeune esclave effrontée, qui
vient espionner le mari. S’il reçoit une visite, & que la conversation dure un peu de temps, les vieilles viennent écouter pour tout redire à madame. Ce sont des soupçons
étranges.

Enfin, ce qui rend encore plus insupportables ces princesses mariées çà & là, c’est qu’elles se vont voir souvent. L’entretien dans ces visites roule
toujours sur les maris. Son extraction, ses manières, sa conduite, tout y est mis sur le tapis. Elles se donnent mutuellement des leçons de fierté & de jalousie : & quand quelqu’une de
son fond serait raisonnable, & aurait un bon naturel, elle devient bientôt semblable aux autres. Aussi ceux qui jusqu’ici ont épousé des princesses, auraient bien voulu s’en dispenser. Ceux
qui n’ont pu l’éviter, s’en sont presque tous fort mal trouvés. Le pauvre Ouang tsao surtout, en a été un triste exemple. Quoique ce fût un grand homme, également savant & brave, il fut pour
une bagatelle indignement livré aux tribunaux, & mourut honteusement. Ton noan mourut de pur chagrin & dans la fleur de l’âge. Tant d’autres ont eu à peu près le même sort, qu’il serait
trop long de les rapporter.
De plus, quand nous prenons une femme, ce que nous nous proposons principalement, c’est d’en avoir des enfants. Rien de plus contraire à cette fin, qu’une jalousie outrée : & l’on a vu par
expérience, que ceux qui ont épousé des princesses, outre tous leurs autres chagrins, ont eu la plupart celui de mourir sans postérité. Qui suis-je moi, pour me flatter de pouvoir éviter toutes
ces disgrâces ? Je n’ai donc garde d’y exposer & ma personne & ma famille. Ceux qui ont subi ce joug, y ont presque tous succombé. Si quelques-uns s’y sont soumis sans réplique, &
l’ont souffert avec patience, c’est que vu les dispositions de la cour, ils ne pouvaient & n’osaient y faire passer d’abord leurs excuses, ni ensuite y porter leurs plaintes. Pour moi j’ai le
bonheur de me trouver sous un prince éclairé, juste, débonnaire, qui n’a point d’autre règle de ses actions que la pure & droite raison, & qu’aucune affection ne préoccupe ; Ainsi je lui
décharge mon cœur.
Grâces à Votre Majesté ma famille est suffisamment élevée ; mon principal soin doit être de la soutenir dans l’état où elle est, & d’en prévenir la décadence. C’est ce que j’ose espérer de
pouvoir faire sous un règne si heureux. Que si je puis espérer avec le temps de grands emplois & de plus hauts titres, je suis bien aise d’y parvenir par mon désintéressement, par mes
talents, par mon assiduité, & mes services : je vous avoue franchement, grand roi, qu’il serait peu de mon goût de les devoir à l’alliance, dont vous pensiez m’honorer. Au reste, ma vue, en
vous exposant ma peine, n’est pas seulement de vous découvrir mes vrais sentiments, & de pourvoir à ma propre sûreté ; c’est aussi de vous faire connaître les maux que de semblables alliances
causent actuellement dans d’autres familles. Je supplie Votre Majesté d’examiner ce qui en est, mais surtout de m’en dispenser. Laissez, je vous en conjure, laissez les petits oiseaux voltiger
gaiement avec leurs semblables. Laissez les vermisseaux multiplier en paix leur espèce & tout honorable que m’est votre choix, daignez, s’il vous plaît le révoquer. Que si Votre Majesté
refuse d’exaucer mon humble prière, je me couperai plutôt les cheveux, je me mutilerai moi-même, ou m’enfuirai au-delà des mers.
L’empereur ayant lu cet écrit, qui s’était fait par son ordre, s’en servit pour faire aux princesses des réprimandes, & s’en divertit en particulier.


















